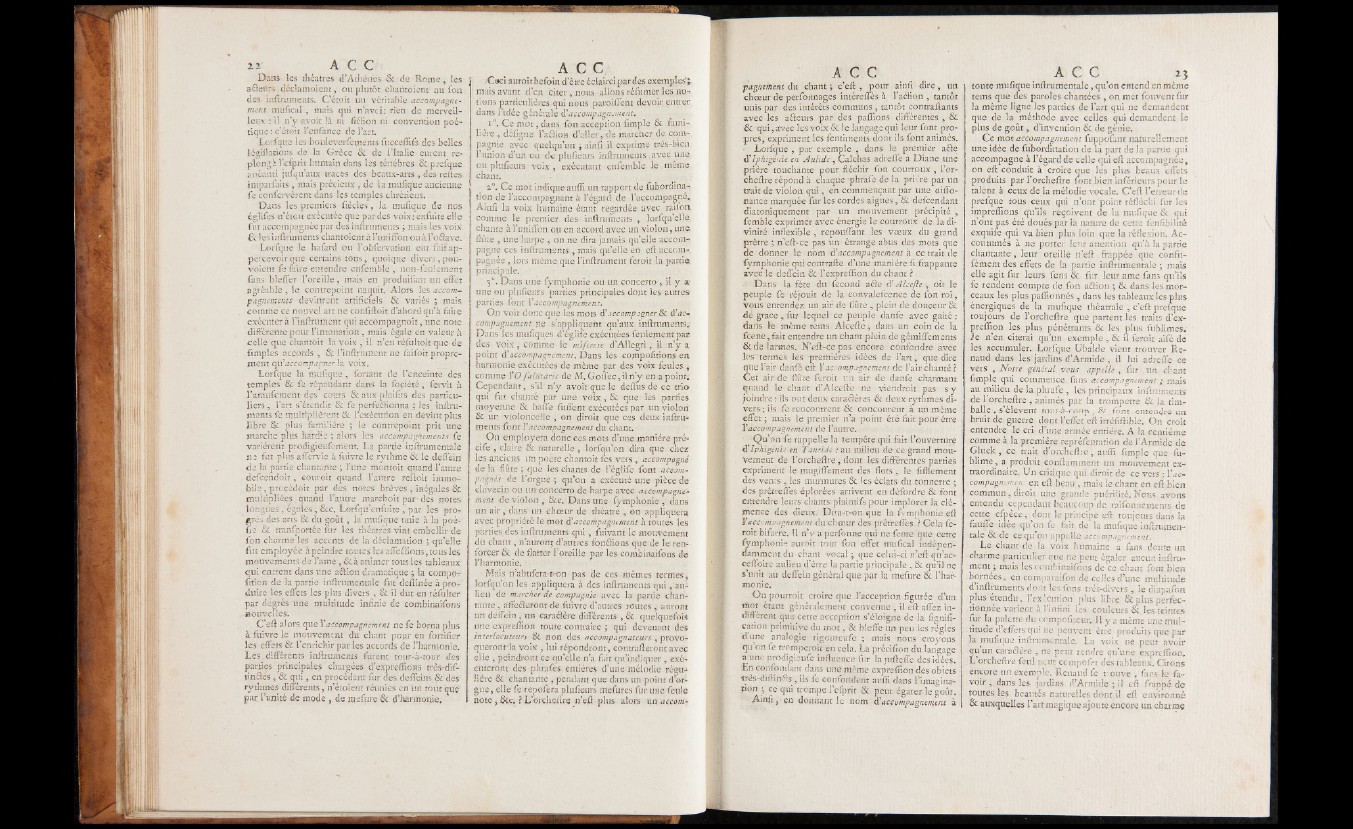
2 2 A C C
Dans les théâtres d’Athènes & de Rome, les
aÔeitrs déclamoient, ou plutôt chaùtoient' au fon
des infirumeiits, C ’étoit un véritable accompagnement
mufical, mais qui n’avck rien de merveilleux
: il n’y avoir là ni fi&ion ni convention poétique
: c’étoit l’enfance de l’art.
Lorfque les bouleverfements fuccefîifs des belles
légiflations de la Grèce 8c de l ’Italie eurent replongé
l’efprit humain dans les ténèbres & -prefque
anéanti jufqu’aux tracts des beaux-arts , des refies,
imparfaits , mais précieux , de la .müfiquë ancienne
fe confervèrent dans les temples chrétiens.
Dans les premiers fie clé s , la mufique de nos
églifes n’étoit exécutée que par des voix: enfuite elle
fut accompagnée par des inffruments ; mais les voix
êc les inffruments chantoient à l’unhTon ou à l’oélave.
Lorfque le hafard ou l’obfervation eut fait ap-
percevoir que certains tons, quoique divers, pourvoient
fe faire entendre enfembïe , non-feulement
fans hlefier l’oreille, mais en produifant un effet
agréable , le contrepoint naquit. Alors les accompagnements
devinrent artificiels & variés ; mais
comme ce nouvel art ne confiff oit d’abord qu’à fais e
exécuter à rinffrument qui accompagnoit, une note
différente pour l’intonatiôn , mais égale en valeur à
celle que chantoit la voix , il n’en réfultoit que de
fimples accords , & rinffrument ne faifoït proprement
qu’accompagner la voix,
Lorfque la mufique, for tant de l’enceinte des
temples 8c fe répandant dans la foçiété, fervit à
l ’amiifement des cours & aux plaifirs des particuliers
, l’art s’étendit & fe perfectionna ; les, inffru-
ments fe multiplièrent 8c l’exécution en devint plus
libre & plus familière ; le contrepoint prit une
marche plus hardie ; alors lès accompagkements fe
varièrent prodigieufement. La partie inffrumentale
lie fut plus affervie à fuivre le rythme 6c le deffein
de la partie chantante ; l’une montoit quand l’autre
defeendoit, courait quand l’autre refloit immobile
, prcçédoit par des notes brèves , inégales 6c
multipliées . quand l’autre marehoit par- des notes
longues j égales, 6cc. Lorfqu’enfuite ,'par les pro-
présides arts 6c du g oû t, la mufique unie à la poé-
fie 8c tranfportée fur les théâtres vint embellir de
fon charme les accents de la déclamation ; qu’elle
fut employée à peindre toutes les affeéfions, tous les
mouvements de l’ame , 6c à animer tous les tableaux
qui entrent dans une a&ion dramatique ; la compo?
fiticn de la partie- inffrumentale fut deflinée à pro?'
duire les effets les plus divers , 6c il dut en réfiilter
par degrés une multitude infinie de combinaifons
Bouvelles.
C ’eff alors que l’accompagnement ne fe borna plus
à fuivre le mouvement du chant pour en fortifier
les effets 6c l’enrichir par les accords de l’harmonie.
L e s . différents inffruments furent tour-à-tour des
parties principales chargées d’expreflions très-dif-
tinâes, 8c qui , en procédant fur des-deffeins 6c des
rythmes différents, n’étoient réunies en un tout que
paç. l’unité de mode , de mefure 6ç d’harmonie.
ACC,
?€@ci auroitbefoin d’être éclairci par des exemples';
mais avant d’en citer, nous allons réfumèr les no-«
fions particulières qui nous paroiffent devoir entrer
dans 1 idée générale $ accompagnement.
i°. Ce mot, dans fon acception fimple 6c familière
, défigne l’aéïion d’aller, de marcher de compagnie
avec quelqu’un ; ainfi il exprime très-bien
i’ uiiion d’un ou de plufieurs inffruments, avec une
ou plufieurs v o ix , exécutant enfembïe le même
chant.
2.°. Ce mot indique auffi un rapport de fubordina-
tion de l’accompagnant à l’égarcl de l’accompagné»
Ainfi la voix humaine étant regardée avec raifort
comme le premier des inffruments , lorfqu’elle,
chante à l’iiniffon ou en accord avec un violon, une
flûte , nne'harpe , on ne dira jamais qu’elle accompagne
ces inffruments , mais qu’elle en eff accompagnée
, lors même que l’inffrument feroit la parties
principale.
3°. Dans une fymphonie ou un concerto , il y æ
une ou plufieurs parties principales dont les autres-
parties font l’accompagnement.
On voit donc que les mots accompagner
compagnement ne s’appliquent qu’aux inffruments.
Dans les mufiques d’eglife exécutées feulement par
des voix , comme le rniferere d’A llegri, il n’y a
point dé accompagnement. Dans les çompofitions en
harmonie exécutées de même par des voix feules ,
comme l’O fa lut aris de M. Goffec, il n’y en a point*
Cependant, s’il n’y avoir que le deflus de ce trio
qui fut chanté par une voix , 8c que les parties
moyenne & baffe fuffent exécutées par un violon
& un violoncelle, on dirait que ces deux inffruments
font Y accompagnement gIîi chant.
On employera donc ces mots d’une manière pré-
cife , claire 8c naturelle , lôrfqu’on dira que chez
le$ anciens un poète chantoit fes vers , accompagné
de là flûte ; que les chants de l’églife font accompagnés
de l orgne ; qu’on a exécuté une pièce de
clavecin ou un concerto de harpe avec accompagnement
de violon , 8cc. Dans une fy mphonie , dans
un air, dans un choeur de théâtre , on appliquera
avec propriété le mot à’accompagnement à toutes les
parties,des inffruments q u i, fuivant le mouvement
du chant, n’auront d’autres fondions que de le renforcer
,6c de flatter l’oreille par les. combinaifons de
l’harmonie.
Mais n’abufera-trap pas 'de ces mêmes termes,
lorfqu’on les appliquera à des inffruments qui ,'au-
lieu de marcher d,e compagnie -avec la partie chantante,
affederont de fuivre d’autres routes, auront
un deffein , un caradère différents , & quelquefois
une expreflion toute contraire ; qui devenant des
interlocuteurs $C non des accompagnateurs , provo-
queronrla voix , lui répondront, contrafferont avec
elle , peindront ce qu’elle n’a fait qu’indiquer , exécuteront
des phrafés entières d’une mélodie régin
Hère 8c chantante , pendant que dans un point d*or-
gue, elle fe repofera plufieurs mefures fur une feule
note, & c . ? L ’orcheffre n’eff plus alors un accompagnertient
du chant; c’eff , pour ainfi dire, un
choeur de perfonnages intéreues à l’adion , tantôt
unis par des intérêts communs , tantôt contraffants
avec les adeurs par des pallions différentes , 6c
8c qui, apvec les voix 6c le langage qui leur font propres,
expriment lès fentiments dont ils font animés.
Lorfque , par exemple , dans le premier ade
d’ Iphigénie en Julide , Calchas adreffe à Diane une
prière touchante pour fléchir fon courroux, l’or-
cheffre répond à chaque phrafe de la prière par un
trait de violon qui , en commençant par une diffo-
nance marquée fiu* les cordes aigues, 6c defeendant
diatoniquement - par un mouvement précipité ,
femble exprimer avec énergie le courroux de. la divinité
inflexible , repouffant les voeux du grand
prêtre ; n’eff-ce pas un étrange abus des mots que
de donner le nom d’accompagnement à ce trait de
fymphonie qui contrafte d’une manière fi frappante
avec le deffein 6c l’expreflion du chant ?
Dans la fête du fécond ade cY AL-e fie -, où le
peuple fè réjouit de la convalefcence de fon roi,
vous entendez un air de flûte , plein de douceur 6c
dé grâce , fur lequel ce peuple danfe avec gaîté :
dans le même tems Alccffe ; dans un coin de la
fcene, fait entendre un chant plein de gémiffements
6c de larmes. N’eff-ce pas encore confondre avec
1rs termes les" premières idées de l ’art, que dire
que l’air danfé eff Yaccompagnement de l’air chanté ?
Cet air de flûte feroit un air de danfe charmant
quand le chant d’Alcefte ne viendrait pas- s y
joindre : ils ont deux caradères 6c deux rythmes divers;
ils fe rencontrent 8c concourent à un même
effet ; mais le premier n’a point été fait pour être
Y accompagnement de l’autre.
Q u’on fe rappelle la tempête qui fait l’ouverture
d Iphigénie en Tauride : au milieu de ce grand mouvement
de l’orcheffre , dont les differentes parties
expriment le mugiffement des flots , le, fifffement
des vents , les murmures 6c. les éclats du tonnerre *
des prêtreffes éplorées arrivent en défordre 6c font
entendre leurs chants plaintifs pour implorer la clémence
des dieux. Dira-t-on que la fvmphonie eff
l 'accompagnement du choeur des prêtreffes ? Cela feroit
bifarre. Il n’v a perfonne qui ne fente que cette
fymphonie auroit tout fon effet mufical indépen-
dammentdu-chant vocal ; que celui-ci n’eff qu’ac-
ceffôire aulieu d’être la partie principale , 8c qiril ne
s’unit au deffein général que par la mefure 6c l’harmonie.
On pourroit croire que l’acception figurée d’un
mot étant généralement convenue , il eff affez indifférent
que cette acception s’éloigne de la lignification
primitive du mot, & bleffe un peu les règles
dune analogie rigoureufe ; mais nous croyons
qu on fe tromperait en cela. La précifion du langage
a une prodigieufe influence fur la juffeffe des idées.
En confondant dans une même expreflion des objets
très-diffinéls , ils fe confondent auffi dans l’imagina'-
ïion ; ce qui trompe l’efprit 6c peut égarer le goût.
Ainfi, en donnant le nom d’accompagnement à
toute mufique inffrumentale, qu’on entend en même
tems que des paroles chantées , on met fouventfur
la même ligne les parties de l’art qui ne demandent
que de la méthode avec celles qui demandent le
plus de g oû t, d’invention 6c de génie.
Ce mot accompagnement fuppofant naturellement
une idée de fubordination de la part de la partie qui
accompagne à l’égard de celle qui eff accompagnée,
on eff conduit à croire que les plus beaux effets
produits par l’orcheftre font bien inférieurs pour le
talent à ceux de la mélodie vocale. C ’eff l’erreur de
prefque tous ceux qui n’ont point réfléchi fur les
impreflions qu’ils reçoivent de la mufique 8c qui
n’ont pas été doués par là nature de cette fenfibilité
exquile qui va bien plus loin que la réflexion. Accoutumés
à ne porter leur attention qu’à la partie
chantante, leur oreille n’eff: frappée que confu-
fément des effets de la partie inffrumentale ; mais
elle agit fur leurs fens 8c fur leur ame fans qu’ils
fe rendent compte de fon a&ion ; 8c dans les morceaux
les plus paflionnés , dans les tableaux.les plus
énergiques de la mufique théatrale , c’eft prefque
toujours de l’orcheffre que partent les traits d’ex-
preflion les plus pénétrants 6c les plus fublimes»
J e n’en citerai quun exemple , 6c il feroit aifé de
les accumuler. Lorfque übalde vient trouver Renaud
dans les jardins d’Armide, il lui adreffe ce
vers , Notre général vous appelle , fur un chant
fimple qui commence, fans accompagnement y mais
au milieu de la phrafe , les principaux inffruments
de l’orcheffre , animés par la trompette 6c la tim-
balle , s’élèvent tout-à-coüp , 8c font entendre un
bruit de guerre dont l’effet eff irréfiffible. On croit
entendre, le cri- d’une armée entière. A la centième
comme à la première repréfentatiôn de l’Armide de
Gluck , ce trait d’orcheftre, auffi fimple que fu-
blime, a produit. conffamment un mouvement extraordinaire.
Un critique qui dirait de ce vers : Yac-
compagnemen: en eff beau , mais le chant en eff bien
commun, dirait une grande puérilité. Nous avons
entendu cependant beaucoup de raifonnemenrs de
cette efpèce, dont le principe eff toujours dans la
fauffe idée qu’on fe fait de la mufique inffmmen-
tale 6c de ce qu’on appelle accompagnement.
Le chant de la voix humaine a fans doute un
charme particulier que ne peut égaler aucun infiniment
; mais les combinaifons de ce chant font bien
bornées, en comparaifon de celles d’une multitude
d’inftruments dont les fon s très-divers , le diapafon
plus étendu, l’exécution plus libre 6c plus perfectionnée
varient à l’infini les couleurs 6c les teintes
fur la palette du cempofiteur. Il y a même une multitude
d’effets~qui ne peuvent être produits que par
la mufique inffrumentale. La voix ne peut avoir
qu un caraâère , ne peut rendre qu’une expreflion.
L’orcheffre feul peut ccmpofer des tableaux. Citons
encore un exemple. Renaud fe r ouve , fans le fa-
v o ir , dans les jardins d’Armide ; il eff frappé de
toutes les beautés naturelles dont il eff environné
8c auxquelles l’art magique ajoute encore un charmç