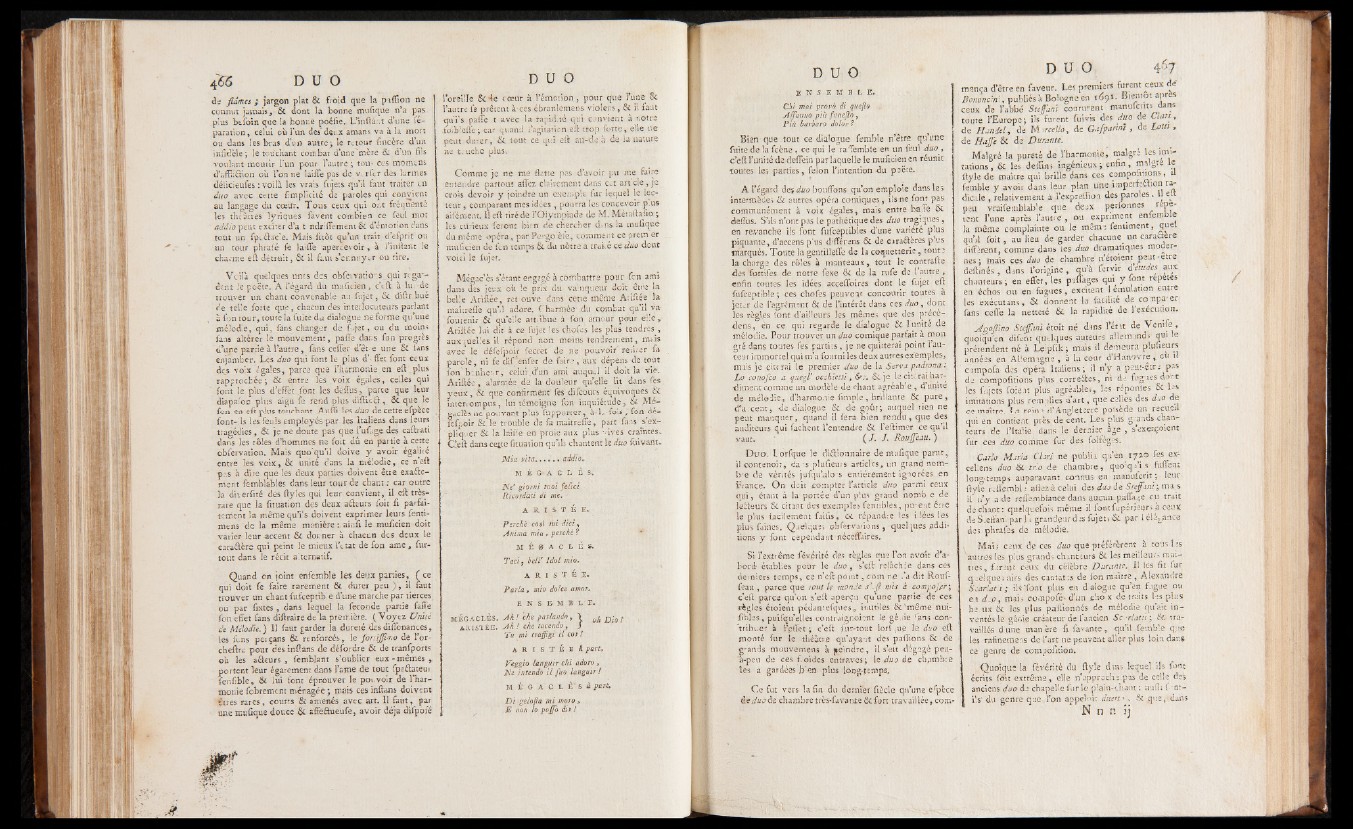
de fiâmes ; jargon plat & froid que la pafiàon ne
connut jamais, & dont la bonne mufique n’a pas
plus bfcloin que la bonne poéfie. L’inftânt d’une réparation
, celui où l’un des' deux amans va à la mort
ou dans les bras d’un autre; le retour fincëre d’un
infidèle; le touchant combat d’une"mère & d’un fils
voulant mourir l'un pour l’autre; tou' ces momens
d’affiiétion ou l’on ne laifie pas de rftr des larmes
délicieufes : voilà les vrais fujets qu’il faut traiter en
duo avec cette {implicite de paroles qui convient
au langage du coeiïr. Tous ceux qui ont fréquenté
les théâtres lyriques favent combien ce feul mot
addio peut exciter d’a t ndriflement & d’émotion dans' _
tout un fpt&acle. Mais fitôt qu’un trait d’efprit on
un tour phiafé fê laiffe apercevoir, à l’in fiant le
charme eft détruit, & il faut s'ennuyer ou rire.
Voilà quelques unes des obfeivarions qui regardent
le poète. A l'égard du mufiçien, e’tft à lu de
trouver un chant convenable an fujet, & diftr.bué
ce telle forte que, chacun des interlocuteurs parlant
à fon tour, toute la fuite du dialogue ne forme qu’une
mélodie, qui, fans changer de R je t , ou du moins
fans altérer le mouvement, pâlie dans fon progrès
d’une partie à l’autre, fans ceffer d’êt e une & lans
enjamber. Les duo qui font le plus d \ ffet font ceux
des voix égales, parce que l’harmonie en eft .plus
rapprochée; & entre les voix égales, celles qui
font le plus d’effet /ont les deflus, parce que leur
diapafoc plus aigu fe rend plus diftieft., & que le
fon en eft plus touchant. Aufii les duo de cette efpèce
font-ils les feuls.employés-par les Italiens dans leurs
tragédies, & je ne doute pas que l’ufage des caftrati
dans les rôles d’hommes ne foit du en partie à cette
obfervation. Mais quo'qu’il doive y avoir égalité
entre les voix, & unité dans la mélodie, ce n’eft
pris à dire que les deux parties doivent être exactement
femblables dans leur tour de chant ; car outre
lia diverfité des ftyles qui leur convient, il eft très-
rare que la fituatien des deux aéteurs foit fi parfaitement
la même qu’ils doivent exprimer leurs fenti-
mens de la même manière u ainfi le muficien doit
varier leur accent & donner à chacun des deux le
caraCtère qui peint le mieux l’ctat de fon ame, fur-
tout dans le récit alternatif.
Quand on joint enfemble les deux parties, ( ce
qui doit fe faire rarement & durer p eu ), il faut
trouver un chant fufceprible dune marche par tierces
ou par fixtes, dans lequel la fécondé partie faffe
fon effet fans diftraire de la première. (Voyez Unité
de Mélodie.) Il faut garder la dureté dès diffonances,
les fens peiçans & renforcés, le fortijfimo de l’or-
cheftre pour des inftans de défordre & de tranfports
où les aCteurs , femblant s’oublier eux - mêmes y
portent leur égarement dans l’ame de tout fpeCtateui
fenfible, & lui font éprouver le pouvoir de l’harmonie
fobrement ménagée ; mais ces inftans doivent
êtres rares, courts & amenés avec art. 11 faut, par
une mufique douce & affe&ueufe, avoir déjà difpofé
l’oreille & 4e coeur à l’émotion, pour que l’une &
l’autre fe prêtent à-ces ébranlemens violens, & ii faut
qui's paüfe t avec la rapid.té qui convient à notre
iôibleftè; car quand i’agitaùcn eft trop forte, elle ne .
peut durer, & tout ce qui eft aiï-be a de la nature
ne true he pluSi-
Comrne je ne me flatte pas d’avoir pu me faire
entendre partout allez clairement dans cet art c-le, je
crois devoir y joindre un exemple fur lequel le lecteur
, comparant mes idées , pourra les concevoir p.us
. aifément. 11 eft tiré de l’Oiyinpiade de M. Métaftafio ;
; les curieux feront bhn de chercher dms la mufique
du même opéra, par Pergo èle, comment cé prem ôr
mufseien de fen temps Si. du nôtre a trai.é ce duo dent
voici le lujet.
Mégac’ès s’étant engagé à combattre pour fen ami
dans des jeux où le prix du vainqueur doit être la
belle Ariftée, ret ouve dans cette même Ariftée 1»
maîtreffe qu’il adore, Charméexiu combat qu’il va
foutenir & qu’elle attribue à fon amour pour elle,
Ariftée lui dit à ce fujet les chofes les plus tendres
auxquelles il répond non. moins tendrement, mars
avec le défefpoir fecret de ne pouvoir' retirer fa
parole, ni fe dif’enfer de fair.?, aux dépens de tout
fon'bmheur, celui.d’un ami auqod il doit la vie.
Ariftée, alarmée de la douleur quelle lit dans fes
yeux, & que confirment fes difeours équivoques 6c
interrompus, lui témoigne fon inquiétude, & ,Mé-
gaelèsne pouvant plus fupporte?, à-1..-fois, fon défefpoir
& le trouble de fa maîtreffe, part fans ^’expliquer
& la laine en proie aux plus -rives craintes,.
Cleft dans cette fituation qu’ils chantent iQ duo fuivant»
Mia vita, . . . . . addio, . ■
M £ G> A C L È s.
Tie* giorni taoi felïci
Ricordati di me. '
A B. 1 S T É E.
Perché coal mi did,
Anima, mia, perché ?
M E 8 A C L È *.
Tad3 belP Idol mio,
A R I S T É E*
Parla, mio d'olce amor.
E N S E- M B L'E» ,
MÊGACLÈSv Ah! che parlando, \ ^ DlQt
AR1STÉE. Ah ! che tacendo, ƒ
Tu mi traffigi il cor t
A R I S T É ï l part,
Veggio languir chi adoro,
isle in ten do il fuo languir!
M É G À C L È' S è p a r t ,
Di gelofia mi moro ,
^ E non lo pojfo dir !
E N S E M B L E .
Chi mai provó di quefio
Affaniio più fitnèjlo,
Piu barbaro dolor ?
Bien que tout ce dialogue femble n’être qu’une
fitite de la fcène , ce qui le raTemble en un feul duo ,
c’eft l’unité de deffein par laquelle le muficieii en reunit
toutes les parties, félon l’intention du peëre.
A l’égard de$ duo bouffons qu’on emploie dans les
intermèdes & autres opéra comiques, ils ne font pas
communément à voix égales, mais entre baffe &
deffus. S’ils n’ont pas le pathétique des duo tragiques,
en revanche fis font fufceptibles d’une variété plus
piquante, d’accens p'us différsns & de cmélères plus
marqués. Toute la gentilleffe de la coquetterie, tout?
la charge des rôles à manteaux, tout le contrafte
des ‘fbttifes de notre fexe & de la rufe de 1 autre,
enfin toutes les idées acceffoires dont le fujet eft
fufceptible ; ces chofes peuvent concourir toutes a
jeter de l’agrément & de l’intérêt dans ces duo, dont
les règles 'ont d’ailleurs les même; que des précédons,
en ce qui regarde le dialogue 6c l'unité de
mélodie. Pour trouver un duo comique parfait à mon
gré dans toutes fes partiis, je ne quitterai point l’auteur
irpmortel qui m’a fourni les deux autres exemples,
mais je citerai le premier duo de la Serva padrona:
Lo conofco a quegl’ occhictti 3 &. je le citerai hardiment
comme un modèle- de chant agréable , d’unite
de mélodie, d’harmonie (impie, brillante & pure,
d’a/cent, de dialogue & de goût; auquel rien ne
peut manquer, quand il fera bien rendu, que des
auditeurs qui fâchent l’entendre & l’eftimer ce qu’il
vaut. ' (/. J. Roujfeau.)
Duo. Lorfque le dictionnaire de mufique parut,
fi contenoir, dats plufieurs articles, un grand nom- :
Ire de vérités jufqualo s entièrement ignorées en
Fiance. On doit compter l’article duo parmi ceux
oui, étant à la portée d’un plus grand nomb e de
lecteurs & citant des exemples fennbles, pire ut erre
le plus facilement failis, 6c répandre les ilées les
plus f.iines. Quelques ebfervasions , quelques additions
y font cependant néceffaires.
Si l’extrême févérité des règles que l’on avoît d’abord
établies pour le duo, s’gft relâchée dans ces
derniers temps, ce n’eft point, com re .’a dit Rouf-
feau , parce que tout Iç monde s9 f i mis à comyofir ;
c’eft parce qu’on s eft aperçu qu’une partie de ces
règles étoient pédantefques, inutiles &.’même nui-
fiblas, puifqu’elles contraignoient le gê.ùe fan s contribuer
à l’pffet ; c’eft fur-tout lorl,;ue le duo eft
monté fur le théâtre qu’ayant des pallions & de
g-ands mouvemens à peindre, Il s’eu dégagé peu-
"à-peu de ces f.oides entraves; le duo de chambre
les a gardées bien plus long-temps.
Ce fut vers la fin du dernier fiècle qu’une espèce
èeduo de chambre très-favante & fort travaillée, cornmsnça
d’être en faveur. Les premiers furent ceux de
Bononc'ml, publiés à Bologne en 1691. Bientôt apres
ceux de l’abbé S té fa n i coururent manufents dans
toute l’Europe; ils furent fuivis des duo de Clan,
de Handel, de M trcello, de Gafparinl , de Loin ,
de Hajfe & de Durante.
Malgré la pureté de l’harmonie,' malgré les iml-
tâtions, & les deffin> Ingénieux; enfin, maigre le
ftyle de maître qui brille dans ces comportions, u
femble y avoir dans leur plan une .imperfection radicale
, relativement à l’expreftio.i des paroles. U elt
peu vraifemblable que deux perfonnes répètent
l’une après l’autre , ou expriment enfembl^
la même complainte ou le même fentiment, que
qu’il foit, au lieu de garder chacune un caractère
différent, comme dans les duo dramatiques modernes;
mais ces duo de chambre n’étoient^ peut-etre
deftinés, dans l’origine, qu’à fervir à'études aux
chanteurs ; en effet, les paffages qui y font répétés
en échos ou en fugues, excitent I émulation entre
les .exécutans, ôi. donnent la facilite de co npa er
fans celle la netteté & la rapidité de l’exécution.
Agofiino Stejf.mi étoit né dans l’étit de Venife »
quoiqu'on difenc quelques auteurs allemand; qui le
prétendent né à Le':pfik; mais îl demeura pluheurs
années en Allemagne , à la cour d’Hanovre v eu il
compofa des opéra Italiens; il n’y a peut-être pas
de compofitions plus correctes, ni de fugues dort
les fujets foie.at plus agréables, les réponles & 1-^
imitations plus remplies d’art, que celles des duo de
ce maître. La reine d’Angleterre poisede un recueil
qui en contient près de cent. Les plus grands chanteurs
de l’Italie dans le dernier^ âge , s’exerçoient
fur ces duo comme fur des folféges.
Carlo Maria Clari ne publia qu’en 1710 fes ex-
cellens duo & tr.o de chambre, quoqa’i s fuflent
long-temps auparavant connus en manuferit ; leur
ftyle rcffembl ; aflez à celui des duo de Steffani‘9 ma s
il n’y a de reffembiance dans aucun, p.affage eu trait
de chant: quelquefois même il fontfupérjeurs à ceux
de S.effau, par f i grandeur des fujet» & par 1 élétance
de» phrafes de mélodie.
. Mai; ceux de ces duo que préférèrent à tous les
autres les plus grands chanteurs & les meilleurs mai-
, très, furent ceux du célèbre Durante, Il !c-s fit fur
quelque; airs des cantates de fon maître , Alexandre
Scarlat.i ; ils'font plus en d alogue qu’en fugue ou
e i d.:.o f mai ; compofé' d’un cho x de traits les plus
bs ux & lés plus pafiionnés de mélodie qu’ait inventés
le génie créateur de l'ancien S c ’datir, & travaillés
d une man ère ft lavante, qu’il femble que
les rafinemens de l’art ne peuvent aller plus loin dans
ce genre de compofition.
Quoique la levé ri té du ftyle dms lequel ils font
écrits foit extrême, elle n’approche pas de celle des
anciens duo de chapelle fur lo plain-chant : aufii { -nt-
i'.s’ du genre que .l’on appelait duett.->. & que, dans
N n n ij