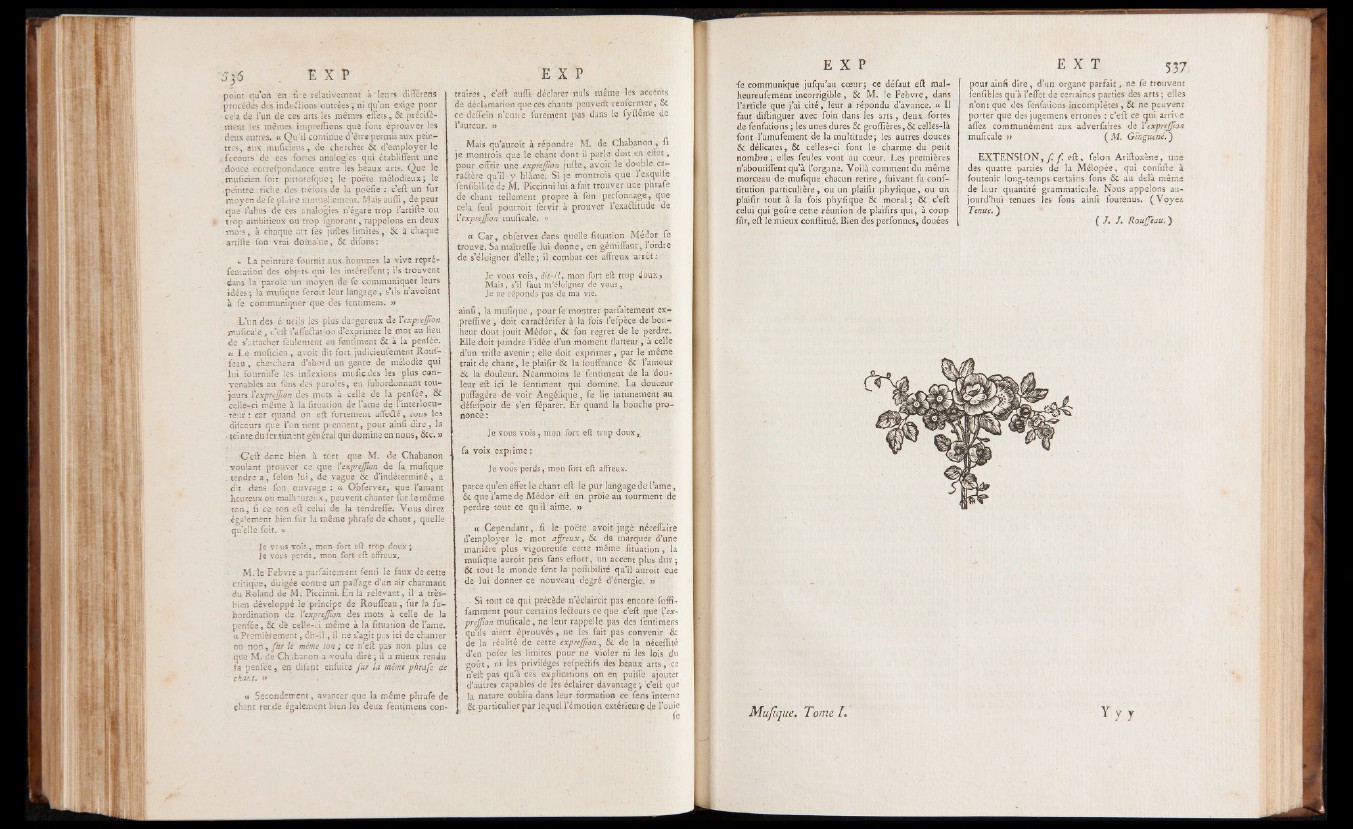
point qu’on en tire relativement à 'leu r s différens
procédés des indu&ions outrées, ni qu’on exige pour
cela de l’un de ces arts les mêmes effets, & précifé-
.mènt les mêmes impreflions que font éprouver les .
deux autres. « Q u ’il continue d ’être permis aux peintres,
aux muficiens, de chercher & d’employer le
.. fecours de ces fortes analogies qui établiflent une
douce correfporidance entre les beaux arts. Qu e le
muficien foit pitrorefque ; le poëte mélodieux ; le
.peintre riche des tréfors de la poëfie : c’eft un fur
moyen de fe pLire mutuellement. Mais aufïi, de peur
que l’abus de ces analogies n’égare trop l’artifte ou
trop ambitieux ou trop ignorant, rappelons en deux
mots, à chaque art fes- juftes limites., & à chaque
artifte fon vrai domaine, & difons:
« La peinture fournit .aux hommes la vive, repré-
fentation des objets qui les intérefTent; iis trouvent
dans la parole un moyen de fe communiquer leurs
idées; la mufique feroit leur langage, s’ils-n’avoient
à fe communiquer que des lentimens. »
L ’un des écueils les plus dangereux de Yexprefon
muficale , c’eft Taffedation d’exprimer le mot au lieu
de s’attacher feulement au fentiment & à la penféè.
« L e muficien , avoit dit fort judicieüfement Rouf-
feau , cherchera d’abord un genre de mélodie qui
lui fournifle les inflexions mu fie îles les plus convenables
au fens des paroles, en fubordonnant toujours
YexpreJJien des mots à celle de la penfée, &
celle-ci même à la fituation de l’ame de l’interlocu-
teur : car quand on eft fortement a f fe â é , tous les
difeours que l’on tient piennent, pour ainfi.dire , la
- teinte du fer.timînt général qui domine en nous, & c . »
- Ç e f t donc bien à tort que M. de Chabanon
. voulant prouver ce que YexpreJJion de la. mufique
.tendre a , félon lui^ de vague & d’indéterminé, a
dit dans fon. ouvrage : « Obfervez , que l’amant
heureux ou malheureux, peuvent chanter fur le même
to n , f i.e e ton eft celui de la tendreffe. Vous direz
également bien fur la même phrafe de ch an t , quelle
quelle foit. »
Je veus vois, mon fort eft trop .doux;
Je vous perds, mon fort eft affreux.
M .le Febvre a parfaitement fenti le faux de cette
critique, dirigée contre un paffage d’un air charmant
du Roland de M . Piccinni. En la relevant, il a très-
bien développé le principe de RoufTeau, fur la fu-
bordination de YexpreJJion des mots à celle de la
penfée, oCde çelle-d même à la fituation de lame,
a P remièrement, d it- il, il ne s’agit pas ici de chanter
ou n o n , fur le meme ton; ce n’eft pas non plus ce
que M. de Chabanon a -voulu dire ; il a mieux rendu
l'a pen fée, en difant enfuite far lu même phrafe de
- çhdnt. n ,
» Secondement, avancer que la même phrafe de
çhant rende également bien les deux fentjmens cont
ra ires , c’eft aufïi déclarer nuis même les accents
de déclamation que ces chants peuverft renfermer, &
ce deffein n’eritre furemént pas dans le fyfteme de
l’auteur. »
Mais qu’auroit à répondre M. de Chabanon, fi
je montrois que le chant dont il parle doit .en effet,
pour offrir une exprejjion jufte, avoir le double caractère
qu’il y blâme. Si je montrois que l’exquife
Yenfibilitéde M. Piccinni lui a fait trouver une phrafe
de citant tellement propre à fon perfonnage, que
cela, feul pourroit fervir à prouver l’exaétitude de
YexpreJJion muficale. ».
<t C a r , obfervez dans quelle fituation Médor fe
trouve. Sa maîtreffe lui donne, en gémiffant, l’ordre
de s’éloigner d’elle; il combat cet affreux arrêt:
Je vous vois, dit-il, mon fort eft trop doux3
-Mais, s’il faut m’éloigner de vous, .
' 'Je ne réponds pas de ma vie.
ainfi, la mufique, pour fe montrer parfaitement ex-
preflive , doit caraétérifer à la fois l’efpèce de bonheur
dont jouit M éd o r , & fon regret de le perdre.
Elle doit joindre L'idée d’un moment flatteur, à celle
d’un trifte avenir ; elle doit exprimer, par le même
trait de chant, le.plaifir & la fouffrance & l’amour
&. la douleur. Néanmoins le fentiment de la douleur
eft ici le fentiment qui domine. La douceur
paffagère de-voir A ngéliqu e, fe lie intimement au
défefpoir de s’en féparer. Et quand la bouche prononce
;
Je vous vois , mon fort eft trop doux,;
fa voix exprime:
Je vous perds, mon fort eft affreux.
parce qu’en effet le chant eft le pur langage de l’ame,
& que l’ame de Médor eft en proie au tourment de
perdre tout ce q u il aime. »
« Cependant, fi le poëte avoit jugé néceffaire
d’employer le mot affreux, & de marquer d’une
manière plus vigoureufe cette même fituation, la
mufique auroit pris fans effort , un accent plus dur ;
& tout le monde fént la poffibilité qu’il auroit eue
de lui donner ce nouveau degré d’énergie. »
. Si tout ce qui précède n’éclaircit pas encore fuffi-
famment pour certains leéteurs ce que c’eft que YexpreJJion
muficale, ne leur rappelle pas des fenti mens
qu’ils aient éprouvés, né les fait pas convenir &
de la réalité de cette exprejjion, & de la nécefîité
d’en pofer les limites pour ne violer ni les lois pu
g o û t , ni les privilèges refpeéïifs des beaux arts, ce
n’eft pas qu’à ces explications on en puifle ajouter
d’autres capables de les éclairer davantage ; c’eft que
la nature oublia dans leur formation ce fens interne
& particulier par lequel l’émotion extérieurs ô,e fouie
•fe communique jufqu’au coeu r; ce défaut eft mal-
heureufement incorrigible, & M. Je Feb vre, dans
l’article que j’ai c i té , leur a répondu d’avance. « Il
faut diftinguer avec foin dans les arts, deux. Tort.es
de fenfations ; les unes dures & groflières, & celles-là
font l’amufement de la multitude; les autres douces
& délicates, & celles-ci font le charme du petit
nombre ; elles feules vont au coeur. Les premières
n’aboutiffent qu’à l’organe. Voilà comment du même
morceau de mufique chacun retire, fuivant fa conf-
titution particulière, ou un plaifir phy fique, ou un
plaifir tout à la fois phyfique & moral ; & c’eft
celui qui goûte cette réunion de plaifirs qui, à coup
fur, eft le mieux conftitué. Bien des perfonnes, douées
pour ainfi d ire , d’un organe p a rfait, ne fe trouvent
fenfibles qu'à l’effet de certaines parties des arts ; elles
n’ont que des fenfations incomplètes , & ne peuyent
porter que des jugement erronés : c’eft ce qui arrive
allez communément aux adverfaires de YexpreJJion
muficale n (M . Gïnguené.)
E X T E N S IO N , f . f . e f t , félon Ariftoxène, une
des quatre parties de la M élopée, qui confifte à
foutenir long-temps certains fons & au delà même
de leur quantité grammaticale. Nous appelons aujourd’hui
tenues les fons ainfi foutenus. (V o y e z
Tenue. )
( J. J. R o u f eau. )
Mufique. Tome /. y y