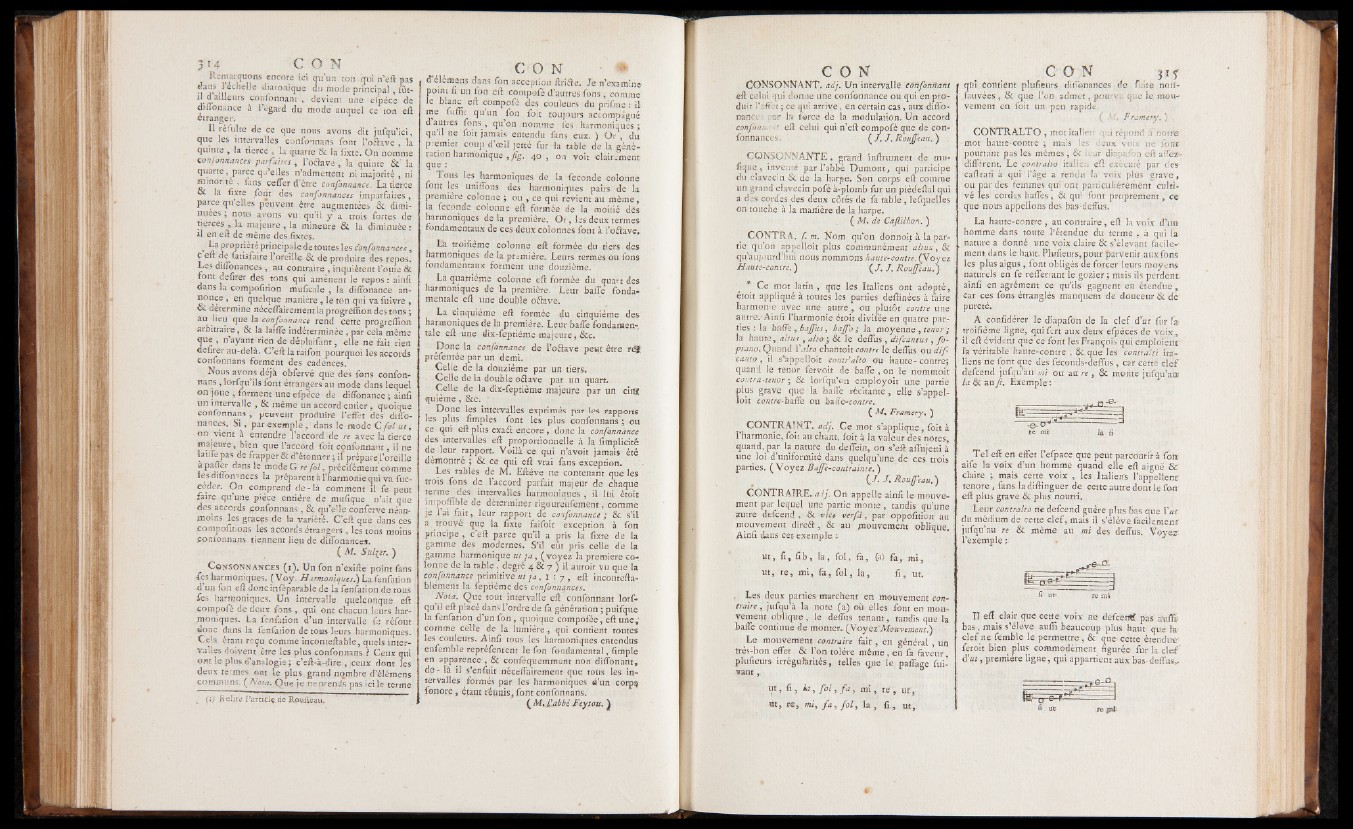
314 C O N
Remarquons encore ici qu’un ion..qui n’eft pas
clans l'échelle diatonique du mode p rinc ipa l, fut-
il d ailleurs confonnant , devient une efpèce de
diflonance à l ’égard du mode auquel ce ton eft
etranger.
I l résulte de ce que nous avons dit jufqu’ic i,
que les intervalles confonnans font l’o fta v e , la
quinte , la tierce , la quarte & la fixte. O n nomme
conformances parfaites , l ’o â a v e , la quinte & ' la
q ua rte, parce qu’elles n’admettent ni majorité , ni
minorité , fans ceffer d’être confonnance. La tierce
& la fixte font des confonnances imparfa ites,
parce qu elles peuvent être augmentées & diminuées
; nous avons vu qu’il y a trois fortes de
tiçrces 9 la majeure , la mineure & la diminuée:
i l en efl de même des fixtes.
, propriété; principale de toutes les confonnances,
? e“ fatisfaire l’oreille & de produire des repos.
Le s diflonanees , au contraire , inquiètent l’ouie St
fon t defirer des tons qui amènent le repos : ainfi
dans la compofition muficale , la diflonance annonce
, en quelque manière, le ton qui va fuivre ,
- détermine néceflairement la p rogréflion des tons ;
au lieu que la confonnance rend cette progréflion
arbitraire, & la laifle indéterminée, par cela même
que , n ayant rien de déplaifant, elle ne fait rien
defirer au-delà. C ’eft la raifon pourquoi les accords
confonnans forment des cadences.
Nous avons d éjà obfervé que des fens confonnans
, lorfqu’ils font étrangers au mode dans lequel
©n joue , forment une efpèce de diflonance ; ainfi
un intervalle , & même un accord en tie r , quoique
confonnans , peuvent produire l’efîet des diffo-
nanees. S i , par e x em p le , dans le mode C fo l u t ,
on vient a entendre l’accord de re avec ia tierce
majeu re, bien que l’accord foit confonnant, il ne
laifle pas de frapper & d’étonner ; i f prépare’l’oreille
apaffer dans le mode G re fo l, précifément comme
les diflonanees la préparent à l’harmonie qui v a fuc-
céder. On comprend d e - là comment il fe peut
faire qu’une pièce entière de mufique n’ait que
des accords ponfonnans, & qu’elle conferve néanmoins
les grâces de la variété. C ’e f l que dans ces
eompofitions les accords étrangers , les tons moins
£onionnans tiennent lieu de diflonanees.
(A L Suider. )
C o n so n n a n c e s ( i ) . Un fon n’exifle point fans
fe s harmoniques. (V o y . Harmoniques.) La fenfation i
d ’un fon efl donc inféparable de la fenfation de tous ;
fes harmoniques. Un intervalle quelconque efl
compofé de deux fons , qui ont chacun leurs harmoniques.
La fenfation d’ un intervalle fe réfout
donc dans la fenfation de tous leurs harmoniques.
C e la étant reçu comme inconteflable, quels intervalles
doivent être les plus confonnans,? Ceux qui
ont le plus d’analogie ; c’eft-à-dire-, ceux dont les
deux termes ont le p lu s . grand nombre d’élémens
communs. (Nota. Q u e je ne prends pas ici le terme
l f*r) fielife l’article de Rouffeau.
C O N
d elemens dans fon acception flrifle. Je n’examine
point fi un fon efl compofé d’autres fo n s , comme
le blanc eft compofé des couleurs du prifme : il
me fufnt qu un fon foit toujours accompagné
d autres fons , qu’on nomme fes harmoniques ;
qu’il ne foit jamais entendu fans eux. ) O r , du
premier coup^d oeil jetté fur la table de la génération
harmonique , fig. 40 , on voit clairement
qué :
T o u s les •, harmoniques de la fécondé colonne
font les unifions des harmoniques pairs.'de la
première colonne ; ou , c e qui revient au m êm e ,
la fécondé colonne efl formée de la moitié des
harmoniques de la première. O r , les deux termes
fondamentaux de ces deux colonnes font à l’o fla v e,
L a troifième colonne eft formée du tiers des
harmoniques de la première. Leurs termes ou fons
fondamentaux forment une douzième.
L a quatrième colonne efl formée du quart des
harmoniques de la première. Leur baffe fondamentale
eft une double oélave.
La cinquième eft formée du cinquième des
harmoniques de la première. Leur bafle fondamentale
eft une dix-feptième majeure, & c .
D o n c la confonnance de l’o â a v e peut être rdl;
préfentée par un demi.
C e lle de la douzième par un tiers.
C e lle de la double o&avë par un quart.
C e lle de la dix-feptième majeure par un cirtl
q u ièm e , & c . *
D o n c les intervalles exprimés par les rapports
les plus Amples font les plus confonnans ; ou
ce qui eft plus e x a â encore , donc la confonnance
des intervalles eft proportionnelle à la fimplicitê
de leur rapport. V o ilà ce qui n’avoit jamais été
démontré ; & ce qui eft vrai fans exception.
Les tables de M. Eftève ne contenant que les
trois fons de l’accord parfait majeur de chaque
terme des intervalles harmoniques , il liii étoit
impoflîble de déterminer ri goure u fement, comme
je l’ai f a i t , leur rapport de confonnance ; & s’il
a trouyé que la fixte faifoit exception à fon
principe , c ’eft parce qu’il a pris la fixte de la
gamme des modernes. S’ il eut pris ce lle de la
gamme harmonique ut ja , ( v o y e z la première cor
lonne de la table , degré 4 & 7 ) il auroit vu que la
confonnance primitive ut jat l : 7 , eft incontefta-
blement la feptiême des confonnances.
Nota. Q u e tout intervalle eft confonnant lorf-
qu il eft placé dans l’ordre de fa génération ; puifque
la fenfation d’un fon , quoique comp ofée , eft une,'
comme ce lle de la lumière, qui contient toutes
les couleurs. Ainfi tous les harmoniques entendus
enfemble repréfentent le fon fondamental, fimple
en apparence , & conféquemmen-t non diflonant,
d e - là il s’enfuit néceflairement que tous les intervalles
formés par les harmoniques d’un corp$
fo n o r e , étant r'éuais; font confonnans.
( M. l'abbé Feytou. ^
C O N
CONSONN A NT. adj. Un intervalle confondant
eft celui qui donne une confonnance ou qui en produit
l’effet, ce qui arrive, en certain cas, aux dîflTo-
nances par la force de la modulation. Un accord
çonfonru' it eft celui qui n’eft compofé que de confonnances,
( J. J. Rouffeau. )
CONSGNNANTE, grand infiniment de mufique
, inventé par l’abbé Dumont, qui participe
du clavecin & de la harpe. Son corps eft comme
un grand clavecin pofé à-plomb fur un piédeftal qui
a des cordes des deux côtés de fa table', lefquelles
on touche à la manière de la harpe.
( M. de Cajliihon . )
CON TR A , f. 1ii. Nom qu’on donrioit à la partie
qu’on appelloit plus communément altus, &
qu’au]ourd’hui nous nommons haute-contre. (Voyez
Haute-contre. ) ( J. J. Rouffeau. )
* Ce mot latin , que lés Italiens ont adopté,
etoit appliqué à toutes les parties deftinées à faire
harmonie avec une autre., ou plutôt contre une
autre.’Ainfi l’harmonie étoit divifée en quatre parties
: la bafle , baffus, baffo ; la moyenne , ténor ;
la haute, altus , alto ; & le deflus , difeantus , fo-
prano. Quand Y alto chantoit contre le defliis ou d i f
canto , il s’appelloit co-nir’atto ou haute-contre;
quand le renor fervoit de bafle , on le nommait
contra-tenor ; & lorfqu’on employoit une partie
plus grave que la bafle récitante, elle s’appelloit
contre-baffe ou baffe-contre.
( M. Framery. )
^ CONTRAINT, adj. C e mot s’applique, foit à
I harmonie, foit au chant, foit à la valeur des notes,
quand, par la nature du deflein, on s’eft afltijetti à
une loi d’uniformité dans quelqu’une de ces trois
parties. ( V oyez Baffe-contrainte. )
LJ- J» Rouffeau.')
CONTRAIRE, alj. On appelle ainfi le mouvement
par lequel une partie monte , tandis qu’une
autre defeend , & vice verfâ, par oppofition' au
mouvement dire#, & au gouvernent oblique.
Ainfi dans cet exemple, 1
u t , f i , f ib , la , fol, fa, (a) fa,, mi-,
ut, re, mi-, fa, fo l , la , f i , ut.
4 Les deux parties marchent en mouvement contraire
, jufqu’à la note (a) où elles font en mouvement
oblique , le deflus tenant, tandis que la
bafle continue de monter, (yoyez'Mouvement.)
Le mouvement contraire fa it , en général , un
très-bon effet & l’on tolère même , en fa faveur,
plufieurs irrégularités, telles que le paflage fui-
vant y
u t, fi , la, f o l , f a , mi , re , ut,
ut, re, mi, f a , fo l , la,, fi., ut,.
C O N 3iy
« qtii contient plufieurs diflonanees de fuite nori-
fauvées , & que l ’on adm e t, pourvu que le mou--
vement en foit un peu rapide.
( M. Framery.') .
C O N T R A L T O , mot italien qui réj ond à noire-
mot haute-contre ; mais les deux vo ix ne fon t
pourtant pas les mêmes , & leur diapafon eft afle’z?-
différent. L e contralto italien eft exécuté par des
caftrafi à qui l’âge a rendu la vo ix plus g r a v e ,
ou par des femmes qui ont particuliérement cu ltiv
é les cordes baffes , & qui font proprem en t, ce
que nous appelions des bas-deflus.
La haute-contre , au contraire, ëft la v o ix d’un
homme dans toute l’étendue du terme . à qui la
! nature a donné une vo ix claire & s’élevant facile-'
ment dans le haut. Plufieurs, pour parvenir aux fons
les plus aigus , font obligés de forcer leurs moyens
naturels en fe refferrant le gozier ; mais ils perdent
ainfi en agrément ce qu’ils gagnent en éten d u e ,
car ces fons étranglés manquent de douceur & de
pureté.
A confidérer le diapafon de la c le f drut fur J»
troifième ligne, quife rt aux deux efpèces de v o ix ,
il eft évident que ce font les François qui emploient
là véritable haute-contre , & que les contralti italiens
ne font que des feconds-defîiis , car cette c le f
defeend jufqu’àu rai o u au re , & monte ju fqu ’a »
la & au fv.. Exemples
. ^rcr*------- — ---------d
nu là &‘ 1
T e l eft en effet l’efpace que peut parcourir à fon
aife la vo ix d’un homme quand elle eft aiguë &
claire mais cette v o i r , les Italiens l ’ap pellent
tenore , fans la d iftinguer de cette autre dont le fon
eft plus grave & plus nourri.
Leur contralto ne defeend guère plus Bas que Yuf
du médium de cette c l e f , mais il s’é lè v e facilement
jufqu’au re & même au mi des deflus. V o y e z -
l’exemple i
rf-e-c£
fi' ut- re mi;
I l eft clair que cette v o ix iife defcertlî pas' Suffi
bas , mais s’élève auffi beaucoup plus haut que ta
c le f n e femble le p ermettre, & que cette étendue'
feroit bien plus commodément figurée fur la c le f '
d’a ï , première lig n e , qui appartient aux bas de ffus .
f îu t »