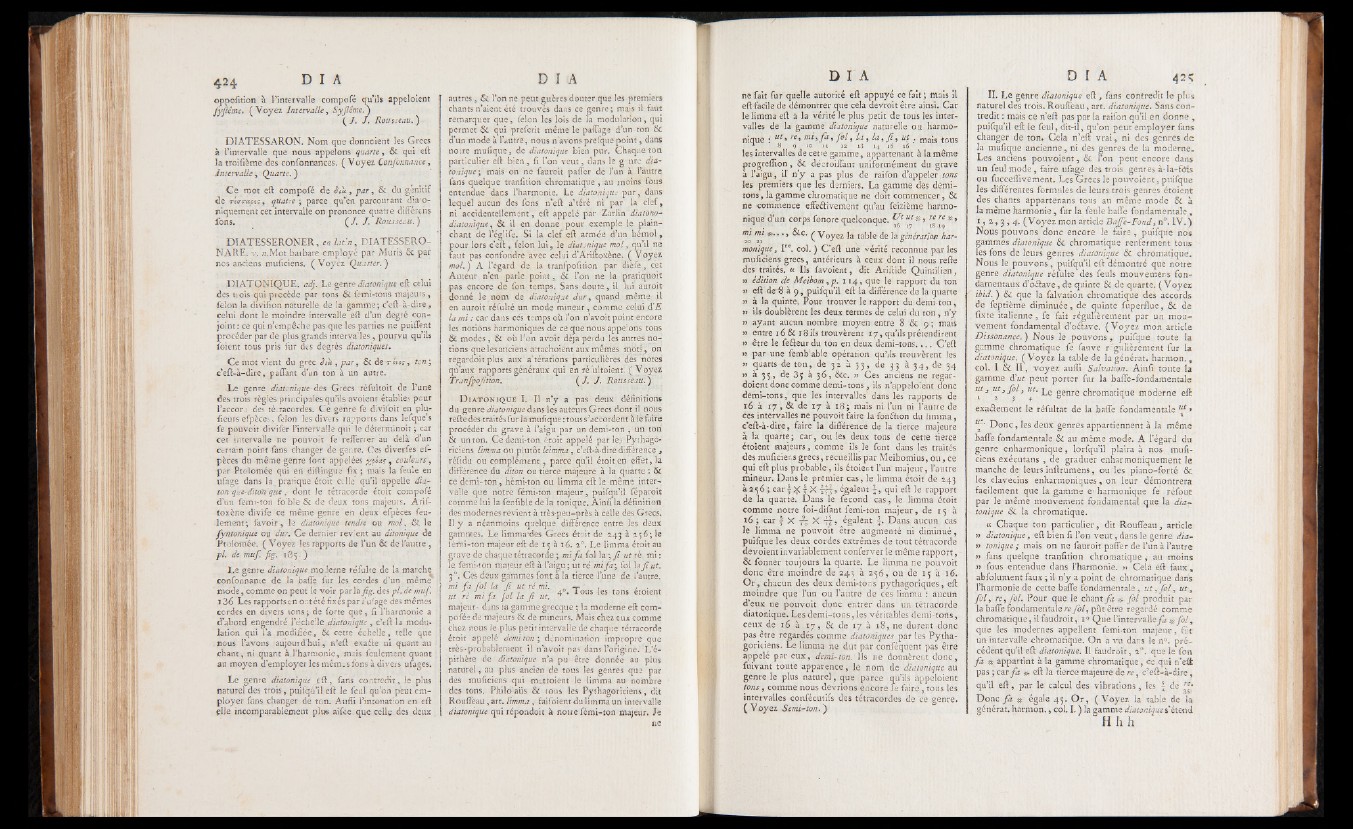
4 2 4 D I A
oppofition à l’intervalle compofé qu’ils appeloient
fyflême. (V oyez In te rv a lle , S yfiêm e.)
( /. J. Rousseau. )
DIATESSARON. Nom que donnoient les Grecs
2 l’intervalle que nous appelons q uarte, & qui eft
la troifième des confonnances. (V o y e z Conformance,
In te rv a lle , Quarte. )
Ce mot eft compofé de iïiu, par, & du génitif
de réo-trupeç, quatre ; parce qu’en parcourant dia'o-
niquement cet intervalle on prononce quatre différens
ions. f J . J . R o u s sea u .)
DÎATESSERONER, en h t m , DIATESSERO-
NARE. v. «.Mot barbare employé par Mûris & par
nos anciens muficiens. (V o y e z Q u a rter.)
DIATONIQUE, Le-genre diatonique eft celui
des trois qui procède par tons & femi-tons majeurs,
félon la divifion naturelle de la gamme; c’eft-à-dire,
celui dont le moindre intervalle eft d’un degré conjoint:
ce qui n’empêche pas que les parties ne puiffent
procéder par de plus grands intervalles., pourvu qu’ils
foient tous pris fur des degrés diatoniques.
Ce mot vient du grec JV« , p a r , & de roW> ton',
c’eft-à-dire, paffant d’un ton a un autre.
Le genre diatonique des Grecs réfultoit de l’une
des trois règles principales qu’ils avoient établies peur
Faccorj des té.racordes. Ce gènre fe divifoit en plu-
fieurs efpèces, félon les divers rapports dans lefquels
fe poüvoit divifer l’intervalle qui le déterminoit ; car
cet intervalle ne pouvoit fe refferrer au delà d’un
certain point fans changer de genre. Ces diverfes espèces
du même genre for.f appelées xplus , couleurs,
par Ptolomée qui en diftingus fix ; mais la feule en
ufage dans la pratique étoit celle qu’il appelle d ia -
tomque-diton q u e dont le tétracorde étoit compofé
d’un fémi-ton foible & de deux tons majeurs. Arif-
toxène divife ce même genre en deux efpèces feulement;
favoir, le diatonique tendre ou m o l, & le
fyntonique ou dur. Ce dernier revient au ditonique de
Ptolomée. (V oy e z les rapports de l’un & dç l’autre ,
fl. de m u f. fig . 1Ô5.)
Le genre diatonique mo Jerne réfulte de la marche
confonnante de la baffe fur les cordes d’un même
mode, comme on peut le voir parla fig. des p l.d e m uf.
136 Les rapports en ont été fixés par i’ufage des mêmes
cordes en divers tons; de forte que, fi l’harmonie a
d’abord engendré l’échelle diatonique, c’eft la modulation
qui l’a modifiée, & cette échelle, telle que
nous l’avons aujourd’hui, n’eft exaéte ni quant au
chant, ni quant à.l’harmonie, mais feulement quant
au moyen d’employer les menu s fons à divers ufages.
Le genre diatonique e ft, fans contredit, le plus
naturel des trois, puifqu’il eft le feul qu’on peut employer
fans changer de ton. Aufli l’intonation en eft
elle incomparablement plus aifëe que celle des deux
D I A
autres, & l’on ne peut guères douter que les premiers
chants n’aient été trouvés dans ce genre ; mais il faut
remarquer que, félon les lois de la modulation, qui
permet & qui preferit même le paffage d’un ton &
d’un mode à l’autre, nous n ’avons prefque point, dans
notre mufique, de diatonique bien pur. Chaque ton
particulier eft bien, fi l’on veut, dans le g- lire diatonique',
mais on ne fauroit paffer dè l’un à l’autre
fans quelque tranfition chromatique, au moins fous
entendue dans l’harmonie. Le diatonique pur, dans
lequel aucun des fons n’eft a’téré ni par la clef,
ni accidentellement, eft appelé par Zarlin diatono-
diatonique, & il en donne pour exemple le plain-
chant de l’églife. Si la clef eft armée d’un bémol,
pour lors c’eft, félon lui, le diatonique mol, qu’il ne
faut pas confondre avec celui d’Ariftoxène. ( Voyez
mol.) A l’égard de la tranfpofition par dièfe, cet
Auteur n’en parle point, .& l’on ne la pratiquoit
pas encore de fon temps. Sans doute, il lui auroit
donné le , nom de diatonique dur, quand même il
en auroit réfulte un mode mineur, comme celui d\E
la mi : car dans cés temps où l’on n’avoit point encore
les notions harmoniques de ce que nous appelons tons
& modes , & où l ’on avoit déjà perdu les antres notions
que les anciens attachoiènt aux mêmes mots , on
regardoit plus aux a'térations particulières dès notes
qu’aux rapports généraux qui en réfultoient; (V oy e z
Tranfpofition. ( J. J. Rousseau. )
D iatonique I. Il n’y a pas deux définitions
du genre diatonique dans les auteurs Grecs dont il nous
refte des traités fur la mufique : tous s’accordent à le faire
procéder du grave à l’aigu par un demi-ton , un ton
& un ton. Ce demi-ton, étoit appelé par le? Pythagoriciens
limma ou plutôt lèimma, c’eft-à-dire différence ,
réfidu ou complément, parce qu’il étoit en effet, la
différence du diton ou tierce majeure à la quarte : &
ce demi-ton, hémi-ton ou limma eft le même intervalle
que notre fémi-ton majeur, puifqu’il féparoit
comme lui la fenfible de la tonique. Ainfi la définition
des modernes revient à très-peu-près à celle des Grecs.
Il y a néanmoins quelque différence entre les deux
gammes. Le limma‘des Grecs étoit de 243 à 256; le
lémi-ton majeur eft de 15 à 16. 20. Le limma étoit au
grave de chaque tétracorde ; mi fa fol la ; f i ut ré mi :
le femi-ton majeur eft à l’aigu; ut ré mifa\ fol la f i ut.
30. Ces deux ga'mmes font à la tierce l’une de l’autre.
mi fa fol la (i ut ré mi. „ T ' , , .
> ■ • r r i ut re mi fa fol l1a Jri ut,. ~4 • * ous les tons etoient
majeur- dans ia gamme grecque ; la moderne eft com-
pofée de majeurs & de mineurs. Mais chez eux comme
chez nous le plus petit intervalle de chaque tétracorde
étoit appelé demi-ton ; dénomination impropre que
très-probablement il n’avoit pas dans rorigine. L ’épithète
de diatonique n’a pu être donnée au plus
naturel, au plus ancien de tous les genres que par
des muficiens qui mtttoient le limma au nombre
'des tons. Philo’aüs & tous les Pythagoriciens, dit
Rouffeau, art. limma , faifoient du limma un intervalle
diatonique qui répoadoit à notre fénfi-ton majeur. Je
D 1 A D I A 42Ç
ne fait fur quelle autorité eft appuyé ce fait; mais il
eft facile de démontrer que cela devroit être ainsi. Car
le limma eft à la vérité le plus petit de tous les intervalles
de la gamme diatonique naturelle ou harmonique
: ut» rei mlt f a 9 f ° l * la , la, f i , ut . ma;s tous
les intervalles de cette gamme, appartenant à la même
progreflion, & déeroiffant uniformément du grave
à l’aigu, if n’y a pas plus de rai fon d’appeler tons
les premiers que les derniers. La gamme des demi-
tons , là gamme chromatique ne doit commencer, &
ne commence effe&ivemenî qu’au feizième harmonique
d’un corps fonore quelconque. re^re
*20 'ii *9 ^ C* ( Voyez la table de la génération harmonique,
Ire. col. ) C ’eft une vérité reconnue parles
muficiens grecs, antérieurs à ceux dont il nous refte
des traités. « Ils favoient, dit Ariftide Quintilien,
» édition de Meibom, p. 1 1 4 , que le rapport du ton
v eft deR à 9 , puifqu’il eft la différence de la quarte
« à la quinte, Pour trouver le rapport du demi-ton,
» ils doublèrent les deux termes de celui du ton, n’y
» ayant aucun nombre moyen entre 8 & 9’; mais
» entre 16 & 18ils trouvèrent 17 , qu’ils prétendirent
» être le feéèeur du ton en deux demi-tons.. . . C ’eft
» par une fèmb’able opération qu’ils trouvèrent les
» quarts de ton, de 32 à 33, de 33 à 34, de 34
» à 33, de 35 à 36, &c. v Ces anciens ne regar-
doient donc comme demi-tons , ils n’appeloient donc
demi-tons, que les intervalles' dans les rapports de
16 à 1 7 , & de 17 à 18; mais ni l’un ni l’autre de
ces intervalles ne pouvoit faire la fonction du limma,
c’eft-à-dire, faire la différence de la tierce majeure
à la quarte; car, ouïes deux tons de cette tierce
étoient majeurs, comme ils le font dans les traités
des muficiens grecs, recueillis par Meibomius, ou, ce
qui eft plus probable, ils étoientSgùffîmajeur, l’autre
mineur. Dans le premier cas, le limma étoit de 243
à 256 ; car f^ C fX fy f , égalent J , qui eft le rapport
de la quarte. Dans le fécond cas, le limma étoit
comme notre foi-difant femi-ton majeur, de 13 à
16 ; car f X te X f f ? égalent f . Dans aucun cas
le limma ne pouvoit être augmenté ni diminué,
puifque les deux cordes extrêmes de tout tétracorde
dévoient invariablement conferver le même rapport,
& fonner toujours la quarte. Le limma ne pouvoit
donc être moindre de 243 à 256, ou de 13 à 16.
O r , chacun des deux demi-tons pythagoriques, eft
moindre que l’un ou l’autre de ces limma : aucun
d’eux ne pouvoit donc entrer dans un tétracorde
diatonique. Les demi-tons, les véritables demi -tons,
ceux de 16 à 1 7 , & de 17 à 18, ne durent donc
pas être regardés comme diatoniques par les Pythagoriciens.
Le limma ne dut par conféquent pas être
appelé par eux, demi-ton. Ils ne donnèrent donc,
fuivant toute apparence, le nom de diatonique au
genre le plus naturel, que parce qu’ils appeloient
tons, comme nous devrions encore le faire, tous les
intervalles confécutifs des tétracordes de ce genre.
(V o y e z Semi-ton.f
II. Le genre diatonique e ft, fans contredit le plus
naturel des trois. Rouffeau, art. diatonique. Sans contredit
: mais ce n’eft pas par la raifon qu’il en donne ,
puifqu’il eft le feul, dit-il, qu’on peut employer fans
changer de ton. Cela n’eft vrai, ni des genres de
la mufique ancienne, ni des genres de la moderne.
Les anciens pouvoient, & l’on peut encore dans
un feul m ode, faire ufage des trois genres à-la-fois
ou fuçceflivement. Les Grecs le pouvoient , puifque
les différentes formules de leurs trois genres étoient
des chants appartenans tous au même mode & à
la même harmonie, fur la feule baffe fondamentale ,
1 , 2 , 3 ,4 . (V oyez mon article Baffe-Fond, n°. IV. )
Nous pouvons donc encore le faire , puifque nos
gammes diatonique & chromatique renferment tous
les fons de leurs genres diatonique & chromatique.
Nous le pouvons, puifqu’il eft démontré que notre
genre diatonique réfulte des feuls mouvemers fondamentaux
d’oclave, de quinte & de quarte. (V oy e z
ibid. ) & que la falvation chromatique des accords
de feptième diminuée, de quinte fuperflue, & de
fixte italienne , fe fait régulièrement par un mouvement
fondamental d’oâave. (V o y e z mon article
Dissonance. ) Nous le pouvons , puifque toute la
gamme chromatique fe fauve régulièrement fur la
diatonique. (V oy e z la table de la générât, harmon.,
col. I & I I , voyez aufli Salvation. Ainfi toute la
gamme d'ut peut porter fur la baffe-fondamentale
ut, ut, fo l, ut. genre chromatique moderne eft
exactement le réfultat de la baffe fondamentale ut >
u- Donc, les deux genres appartiennent à la même
baffe fondamentale & au même mode. A l’égard du
genre enharmonique, lorfqu’il plaira à nos muficiens
exécutans , de graduer enharmoniquement le
manche de leurs inftrumens, ou les piano-forté &
les clavecins enharmoniques, on leur démontrera
facilement que la gamme e- harmonique fe réfout
par le même mouvement fondamental que la diatonique
& la chromatique.
« Chaque ton particulier, dit Rouffeau, article
» diatonique, eft bien fi l’on v eu t, dans le genre dia-
» tonique ; mais on ne fauroit paffer de l’un à l’autre
» fans quelque tranfition chromatique , au moins
» fous entendue dans l’harmonie. » Cela eft faux ,
abfolument faux ; il n’y a point de chromatique dans
l’harmonie de cette baffe fondamentale, ut, fo l, ut,
fo l, re, fol. Pour que le chant fa » fol produit par
la baffe fondamentale re fo l, put être regardé comme
chromatique, il faudroit, i° Que l’intervalle^« * fo l,
que les modernes appellent femi-ton majeur, fût
un intervalle chromatique. On à vu dans le n°. précédent
qu’il eft diatonique. Il faudroit, 20. que le fou
fa ss appartînt à la gamme chromatique , ce qui n’eft:
pas ; car fa eft la tierce majeure de re, c’eft-à-dire,
qu’il eft, par le calcul des vibrations, les \ de re*
Donc fa x ' égale 43. O r , (V o y e z la table de la
générât, harmon., col. I. ) la gamme diatonique s’étend
H h h