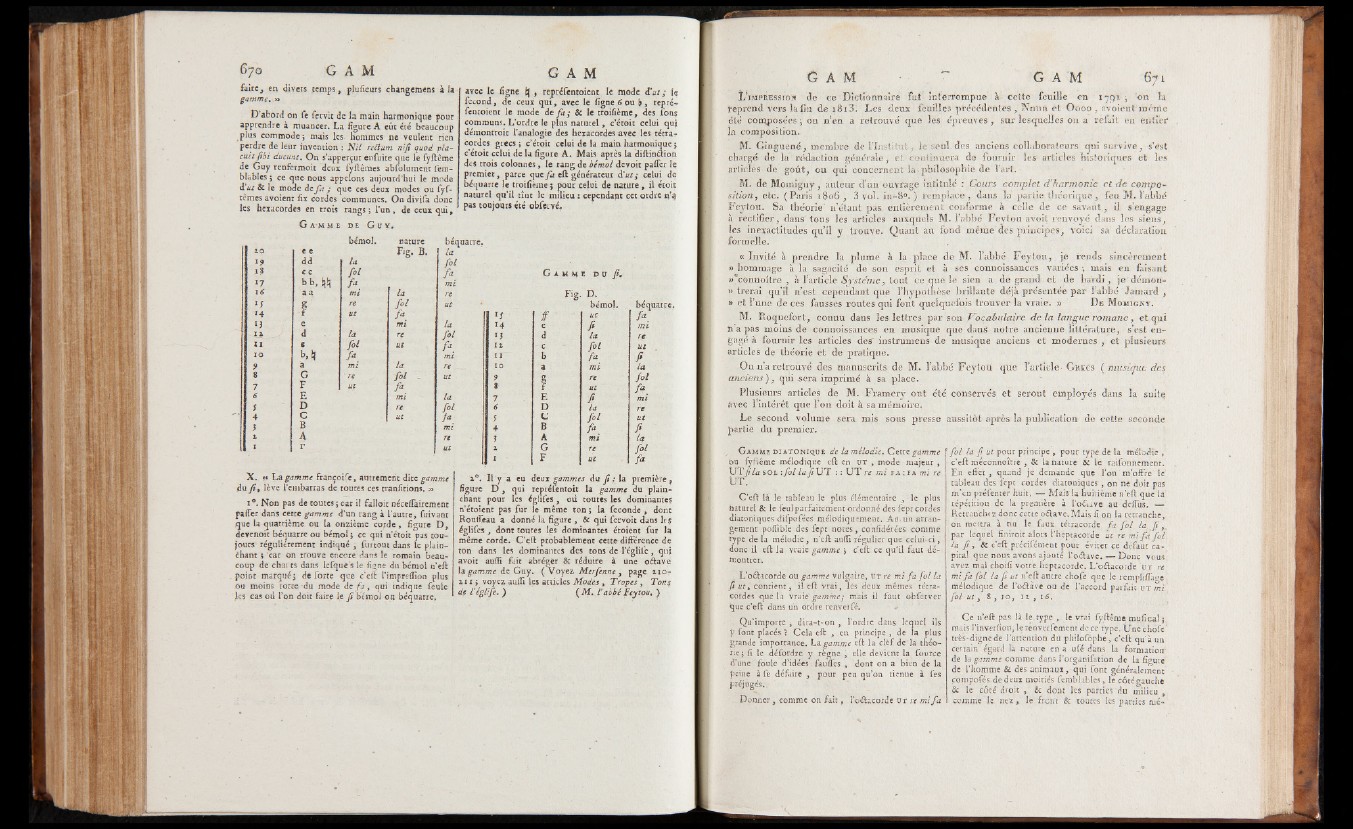
f a i r e j en dive rs t em p s , plufîcurs ch angemens à la
gamme. »
D ’ab ord on fe fe rv it de la main ha rmonique pour
apprendre à muancer. L a figure A eût été beaucoup
plus com m od e j mais les hommes n e v eu len t rien
perd re de leur in v en tion : N il reélum nifi quod pla-
cu.it fibi ducunt. O n s’apperçut enfuite q ue le fyftême
de G u y ren fermo it deux fy ftêm e s ablblumenc fem -
b lables j c e q u e nous appelons au jou rd ’hui le mode
à.'ut & le m od e de fa y q u e ces deux modes ou f y f têmes
avoienc f ix co rd es communes . O n d iv jfa donc
les hcxacorde s en tro is ran g s j l 'u n , d e ceux q u i ,
G a m m e de G u y .
av ec le ligne \\ , repré fentoient le m ode à*ut y le
f é c o n d , de ceux q u i , av ec le lign e 6 ou , repréfentoient
le mode de fa ; & le tro ifièm e , des ion?
communs. L ’o rdre le plus n a tu r e l, c ’é to it ce lu i qu i
démontroit l ’an a lo g ie des hexacordes a v e c les tétra -
cordes g rec s } c’ éroit ce lu i de la main ha rmonique j
c’étoit ce lu i de la figure A . M a is après la diftintftion
des trois colonnes , le ra n g de bémol d e v o it pafier le
p r em ie r , parce que fa e f t géné rateur à’ut; ce lu i de
béquarre le troifième ; pour ce lu i de nature , il écoit
naturel qu ’ il t în t le m ilieu : cependant cc t o rdre n?4
pas toujours été ob fe rv é .
b ém o l. nature béqu arre.
ZQ e e fig. B. la
I ? d d l a f o l
l8 c c f o l j g l
1 7 b b , j f f a. mi
1 6 a a mi la re
*5 g re f o l ut
1 4 f ut f*.
U c mi la
x z d la re f o l
XI c f o l ut fitt
10 M fit mi
9 a mi la re
8 G ‘ re f o l . ut
7 F üt § |
6 E mi la
I D re f o l
4 C ut f a
J B mi
z A re
1 r ut
G amme du fi.
F ig . D .
X . « ha gamme f ra n ç o i fe , autrement dite gamme
du f i, lè v e l’embarras de toutes ces tranlitions. ?»
i ° . N o n pas de toutes j ca r il fa llo it néceflairement
pa fier dans c e tte gamme d’un ran g à l ’au tr e , fuivanr
q u e la qu a trièm e ou la o n z ièm e c o r d e , figure D ,
de v en o it béquarre ou bémo l ; ce q u i n’étoit pas toujou
rs régu lièrement indiqué , fu r tou t dans le pla in -
chant » ’car on tro u v e encore dans le romain beau co
u p d e ch a r ts dans le fq u e ’s le lign e du b ém o l n’eft
p o in t marqué $ de force q ue c ’e ft i’impre filon plus
o u moins fo r te -d u mode de f a , qu i indique feu le
les cas o ù l’o n doit faire le fi b ém o l ou b équarre.
x ° . I l y a eu deux gammes du fi : 1a première ?
figure D , q u i repréfentoit la gamme du plain -
chant pour les é g l i f e s , o ù toutes les dominante?
n’éto ien t pas fu r le même to n 5 la fécondé , dont
R o u fie au a donné la f ig u r e , & qu i fe rv o it dans h s
é g life s , d on t toutes les dominantes étoient fu r la
même cord e. C ’e ft probablement cette- différence de
ton dans les dominantes des tons de l ’é g l i f e , qu i
a v o it aufli fa it ab réger & réduire a une o é fa v e
la gamme d e G u y . ( V o y e z Mcrfcnne , pa ge z 1 Or
z i 1 ; v o y e z aufli les articles Modes , Tropes , Tons
dç iéglife. ) (M. f abbé Feytou. )
I j impression de ce Dictionnaire fut interrompue à cette feuille en 17 9 1 ; on la
Reprend vers la fin de ï 8 i 3 . L e s deux feuilles précédentes , Nirnn et Oooo , avoient même
été composées j on n’en a retrouvé que les ép reu ve s , sur lesquelles 011 a refait en entier
la composition.
M. G in guen é> membre de l’In s titu t, le seul.des anciens collaborateurs qui su rv iv e , s’ést
chargé de la rédaction g énéra le, e t continuera de fournir les articles historiques et les
articles de g oû t, ou qui concernent la . philosophie de T a i t.
M. de M on iign y , auteur d’un ouvrage intitulé : Cours complet d'harmonie c l de composition,
etc. (Paris 1806 , 3 vol. in-8°. ) remplace , dans la partie th éor iqu e , feu M. l ’abbé
Feytou. Sa théorie' n’étant pas. entièrement conforme à celle de ce savant , il s’engage
à rectifie r, dans tous les articles auxquels M. l ’abbé F e y tou avoit renvoyé dans les s iens,
les inexactitudes qu’il y trouve. Quant au fond même des p rincipes, voici sa déclaration
formelle.
« Invité à prendre la plume à la place de M. l’abbé F e y to u , je rends sincèrement
# hommage à la sagacité de son esprit et à ses connoissances variées mais en faisant
»*conüoître , à l’article Sys tèm e, tout ce que le sien a de grand et de hardi , je demon-
» trerai qu’il n’est cependant que l ’hypothèse brillante déjà présentée par l ’abbé Jamard ,
» et l ’une de ces fausses routes qui font quelquefois trouver la vraie. » D e Momigny.
M. Roquefort, comiù dans les lettres par son Vocabulaire d e là langue romane, et qui
n’a pas moins de connoissances en musique que dans notre ancienne littérature, s’est engagé
à fournir les articles des' instrumens de musique anciens e t modernes , et plusieurs
articles de théorie et de pratique.
On n’a retrouvé des manuscrits de M. l ’abbé F e y tou que l ’article G recs ( musique des
anciens ) , qui .sera imprimé à sa place.
Plusieurs articles de M. Framery ont été conservés et seront employés dans la suitq
Rvec l’intérêt que l ’on doit à sa mémoire.
L e second volume sera mis sous presse aussitôt après la publication de cette seconde
partie du premier.
ï G amme d ia t o n iq u e de la mélodie. Cette gamme
du fyftême mélodique eft en u t , mode majeur *
U T fi la so l : fo l la / /U T : : U T re mi fa : fa mi re
U T .
C ’eft là le tableau le plus élémentaire , le plus
haturel & le feul parfaitement ordonné des fept cordes
diatoniques difpofées mélodiqucment. Au.un arrangement
pofiible des fept notes, confîdérées comme
type de la mélodie, n’eft aufli régulier que celui-ci,
donc il eft la vraie gamme j c’eft ce qu’il faut démontrer.
L’o&acorde oti gamme vulgaire, ut re mi fa fo l la
fi ut, contient, il eft vrai, lés deux mêmes técra-
cordes que la vraie gamme; mais il faut obfervèr
que c’eft dans un ordre renverfé.
Qu’importe * dira-t-on , l’ordre dans lequel ils
ÿ font placés ? Cela eft , en principe , de la plus
grande importance. La gamme eft la clef de la théorie
j fi le défordre y règne , elle devient la fource
d’une foule d’idées . faufles , dont on a bien de la
peine à fe défaire , pour peu qu’on tienne à les
préjugés..
Donner, comme on fait, l’oékcorde ut re mi fa
fo l là fi ut pour principe , pour type de la mélodie ,
c’eft méconnoître , & la nature &t le raifonnement.
En effet, quand je demande que l'on m’offre le
tableau des fept cordes diatoniques , on ne doit pas
m’en préfènrer huit. — Mais la huitième n’eft que la
répétition de la première à i'oéiave au deflus. —
Retranchez donc cette oétave. Mais fi on la retranche,
on mettra à nu le faux tétracorde fa fo l la f i
par lequel finiroit alors î’heptacorde ut re mi fa fo i
La f i , & c’eft précifément pour éviter ce défaut capital
que nous avons ajouté i’oéfavc. — Donc vous
avez mal choifi votre heptacorde. L'oétacorde 'ü t re
mi fa fo l la fi ut n’eft autre chofe que le rempliflage
mélodique de l’oéfàve ou de l’accord parfait u t mi
fo l u t, 8 , 1 0 , I Z , l 6 .
Ce n’eft pas là le type , le vrai fyftême mufical ;
mais l’inverfion, le renverfement de ce type. Une chofe
très-digne de l’attention du philofôphe, c’eft qu'à un
certain égard la nature en a ufé dans la formation'
de la gamme comme dans i ’organifation de la figure
de l’homme & des animaux, qui font généralement
compofés de deux moitiés femblables, le côté gauche
& le côté droit , & dont les parties du milieu ,
comme le nez, le front & toutes les parties mé