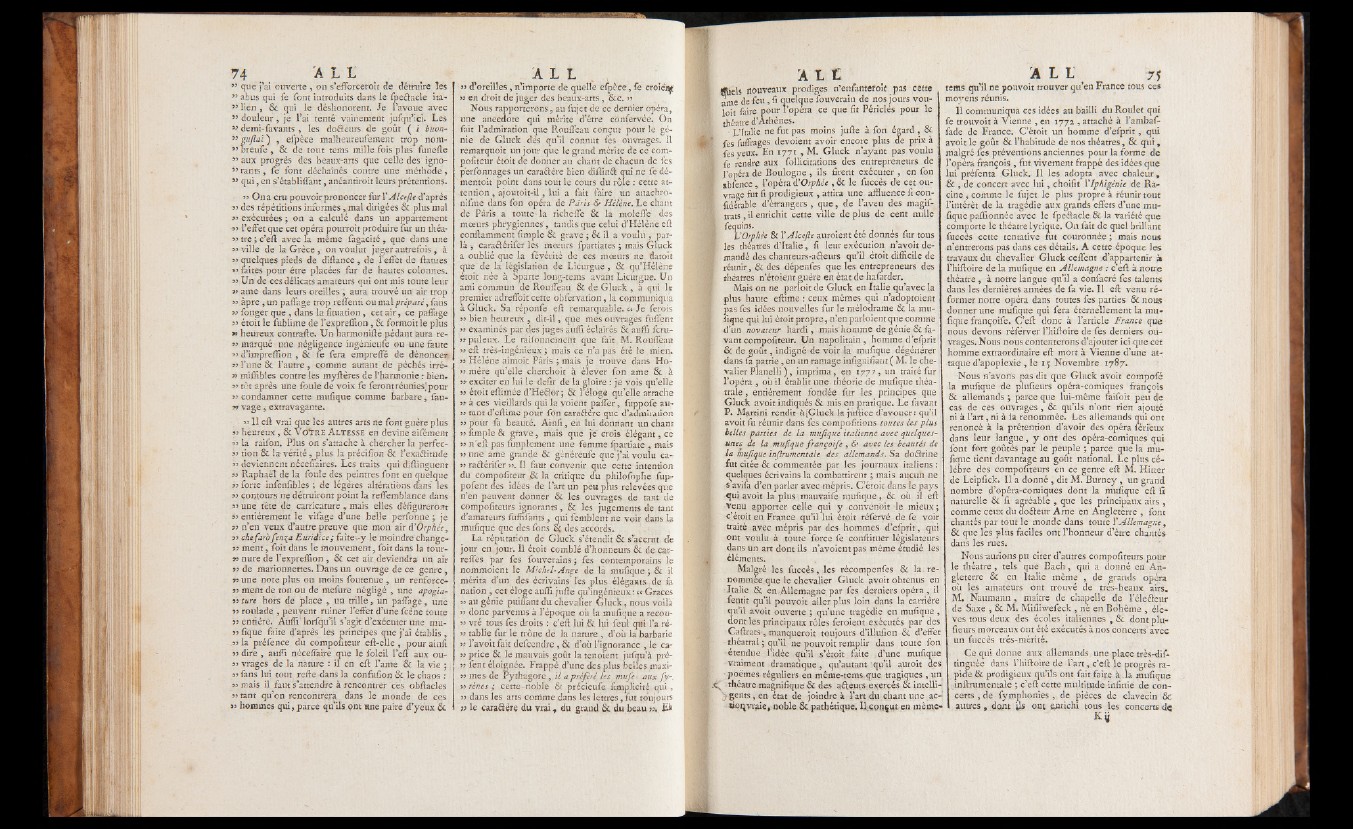
74 A L L
35 que j’ai ouverte , on s'efforcerait de détruire les
33 abus qui fe font introduits dans le fpeâaéle ita-
33 lien , 6e qui le déshonorent. Je Pavoue avec
33 douleur, je l’ai tenté vainement jufqu’ici. Les
33 demi-favants , les doâeurs de goût ( i biion-
33 gujlai ) , efpèce malheureufement trop nom-
33 breufe, & de tout tems mille, fois plus funerte
33 aux progrès des beaux-arts que celle des igno-
33 rants, fe font déchaînés contre une méthode,
33 qui, en s’êtabliflant, anéantiroit leurs prétentions.
» On a cru pouvoir prononcer fur Y Alcefie d’après
JJ des répétitions informes , mal dirigées 8c plus mal
33 exécutées ; on a calculé dans un appartement
95 l’effet que cet opéra pourrait produire fur un théa-
»? tre ; c’eft avec la même fagacité , que dans une
>9 ville de la Grèce , on voulut juger autrefois , à
55 quelques pieds de diflanee , de l’effet de fiâmes
»J faites pour être placées far de hautes colonnes.
99 Un de ces délicats amateurs qui ont mis toute leur
» ame dans leurs oreilles, aura trouvé un air trop
99 âpre , un palfage trop reflenti ou mal préparé, fans
99 fonger que , dans la fituation, cet air , ce partage
99 étoit le fublime de l’expreflion, 8c formoit le plus
»» heureux contrafle. Un harmonirtè pédant aura re-
»9 marqué une négligence ingénieufe ou une faute
99 d’impreflion , & fe fera emprefle de dénoncer
?5 l’une & l’autre , comme autant de péchés irré-
9> miâibles contre les myflères de l’harmonie : bien.
>9 tôt après une foule de voix fe feront réunies] pour
99 condamner cette mufique comme barbare, fau-
99 v a g e , extravagante.
5911 efl vrai que les autres arts ne font guère plus
59 heureux, & Vo*fre A ltesse en devine aifément
« la raifon. Plus on s’attache à chercher la perfee-
39 tion & la vérité, plus la précifion & FexaéHtude
39 deviennent nécefîaires. Les traits qui dirtinguent
33 Raphaël de la foule des peintres font en quelque
99 forte infenfibles ; de légères altérations dans' les
39 contours ne détruiront point la reffemblance dans
99 une tête de carricature , mais elles défigureront
a» entièrement le vifage d’une belle perfonne ; je
39 n’en veux d’autre preuve que mon air d'Orphée,
39 chefarofien^a E u r id ic e ; faîtes-y le moindre change-
9? m en t, foit dans le mouvement, foit dans là tour-
99 nure de l’expreflion , 8c cet air deviendra un air
93 de marionnettes. Dans un ouvrage de ce genre,
99 une note plus on moins foutenue , un renforce-
99 ment de ton ou de mefure négligé , une apogia-
99 ture hors de place , un t r i l le u n partage, une
39 roulade , peuvent ruiner l’effet d’une fcène toute
99 entière.' Aurti1 lorfqu’il s’agit d’exécuter une mu-
99 fique faîte d’après les principes que j’ài établis r
99 la préfence du compofiteur ert-elle , pour ainfi
99 dire , aurti néceflaire que le foleil l’eft aux ou-
39 vrages de la nature : il en ert l’ame & la vie ; j
99 fans lui tout rerte, dans la confufion & le chaos :
39 mais il faut s’attendre à rencontrer cës obrtaeles
39 tant qu’on rencontrera dans le monde de ce.s
>9 hommes qui,parce qu ils ont isuie paire d’yeux &
A L L
3> d’oreilles, n’importe de quelle efpèce, fe croient
39 en droit de juger des beaux-arts, 8cc. 9?
Nous rapporterons, au fujet de ce dernier opéra,
une anecdote qui mérite d’être eonfervée. On
fait l’admiration que Rourteau conçut pour le génie
de Gluck dès qu’il connut fes ouvrages. Il
remarquoit un jour que le grand mérite de ce com-
pofitéur étoit de donner au chant de chacun de fes
pèrfonnages un caractère bien dirtinâ: qui ne fe dé-
mentoit point dans tout le cours du rôle : cette attention
, ajoutoit-il, lui a fait faire un anachro-
iiifnié dans fon opéra de P,îris~& Hélène. Le chant
de Paris a toute- la richerte & la molefle des
moeurs phrygiennes',, tandis que celui d’Hélène ert
conftamment fimple & grave ; & il a voulu , parla
-, caraâérifer les moeurs fpartiates ; mais G1 nck
a oublié que la févérité de ces moeurs ne dàtoît
que de la législation de Licurgue , & qu’Hélène
étoit née à Sparte long-tems avant Licurgue. Un
ami commun de Rourteau & de Gluck , à qui le
premier adreffoit cette obfervation, la communiqua
à Gluck. Sa réponfe ert remarquable. « Je ferais
33 bien heureux ,. dit-il, que mes ouvrages fudènt
>9 examinés par des juges aurti éclairés & aurti fcru-
33 puleux. Le raifônnement que fait M. Rourteau
>3 ert très-ingénieux ; mais ce n’a pas été le mien.
J3 Hélène aimoit Paris ; mais je trouve dans Ho-
39 mère qu’elle eherchoit à élever fon ame & à
>3 exciter en lui le defir de la gloire : je vois qu’elle
33 étoit ertimée d’Heélor; 8c l’éloge qu’elle arrache
>3 à ces vieillards qui la voient paffer, fuppofe au-
>3 tant d’ertime pour fon cara&ère que d’admiration
33 pour fa beauté. Ainfi., eh lui donnant un chant
33 fimple & grave, mais que je crois élégant, ce
33 n’ert pas Amplement une femme fpartiate , mais
33 une ame grande 8c générèufe que j’ai voulu ca-
33 radérifer sj. Il faut convenir que cette intention
du compofiteur ,8c la critique du philofophe fup-
pofent des idées de l’art un peu plus relevées que
n’en peuvent donner 8c les ouvrages de tant de
compofiteurs ignorants, 8c les jugements de tant
d’amateurs fufmams qui femblent ne voir dans la
mufique que des fons 8c des accords.
La réputation de Gluck s’étendit 8c s’accrut de
jour en jour. Il étoit comblé d’honneurs 8c de carrelles
par fes fouverains ; fe s contemporains le
nommoient le Michel-Ange de là mufique ; & il
mérita d’un des écrivains les plus, élégants de fa
nation , cet éloge aurti jurte qu’ingénieux: et Grâces
33 au génie puirtant du chevalier Gluck, nous voilà
33 donc parvenus à l’époque où la mufique a recou-
33 vré tous fes droits : c’ert lui .& lui feul qui l’a ré-
33 tablie fur le trône de la nature , d’où la barbarie
39 l’avoit fait defeendre , & d’où l’ignorance , le ca-
33 price & le mauvais goût la tenoient jufqu’à pré-
33 fent éloignée. Frappé d’une des plus belles maxi-
99 mes de Pythagore , .il a préféré les mufti aux fy-,
y> rênes; cette noble & précieufe, frmplicité qui ,
33.dans les arts comme dans les lettres, fut toujours
i p le caractère du vrai, du grand 6c du beau 93,
A l z
llh e ls n o u v e a u x p ro d ig e s n’ e n fa n te fo ît pas c e tte
ame de f e u , fi Qu elque fo u v e ra in d e n o s jo u r s v o u -
lo it faire p o u r l ’o p é ra c e q u e fit P é r ic lè s p o u r le
I théâtre d’A th èn e s . I . _ , * i , o
- L ’ Italie n e fu t p a s m o in s ju ft e a Io n é g a rd , oc
I. fes fufîrages d é v o ie n t a v o i r en c o r e p lu s d e p r ix à
i fes y e u x . E n 1 7 7 1 , M . G lu c k n ’a y a n t p a s v o u lu
1 fe rendre au x fo llic ita tio n s de s en trep ren eu r s d e
B j ’opéra d e B o u lo g n e , ils firen t e x é c u te r , e n fo n I a b fe n c e , l’o p é ra d'Orphée , 8c le fu c c è s d e c e t 011- 1 v rag e fut fi p ro d ig ieu x , attira u n e afHuence fi c o n - I i fidèrable d’étran g e r s , q u e , d e l ’a v e u d e s m a g if-
I t ra t s , il en r ich it c e tte v i l le d e p lu s d e c e n t m ille j
■ L faquins. . , ,
VOrphée & YAlcefie auroient été donnes fur tous
les théâtres d’Italie, fi leur exécution n’avoit de- I mandé des chanteurs-aâeurs qu’il étoit difficile de
I réunir, & des dépenfes que les entrepreneurs des
I théâtres n’étoient guère en état de hafarder.
Mais on ne parloit de Gluck en Italie qu’avec la
plus haute eftime : ceux mêmes qui n’adoptoient
i pas fes idées nouvelles fur le mélodrame & la mu- .
I fique qui lui étoit propre , n’en parlaient que comme
d’un novateur hardi, mais homme de génie & Lavant
compofiteur. Un napolitain , homme d efprit !
& de goût, indigné de voir la mufique dégénérer .
dans fa patrie, en un ramage infignifiaiit ( M. le chevalier
Planelli ) , imprima, en 1 7 7 7 , un traité fur
l’opéra , où il établit une théorie de mufique théa- ;
; traie., entièrement fondée fur les principes que
Gluck avoit indiqués & mis en pratique. Le favant
P. Martini rendit à [Gluck la jurtice d’avouer: qu’il
avoit fu réunir dans fes compofitions toutes les plus
i belles parties de la mufique italienne avec quelques-
unes de la mufique françoife , & avec les beautés de
la mufique infirumentale des allemands. Sa doctrine
fut citée & commentée par les journaux italiens :
• quelques écrivains la combattirent ; mais aucun ne
? s avifa d’en parler avec mépris. C ’étoit dans le pays
qui avoit la plus mauvaife mufique, & où il ert
venu apporter celle qui y convenbit le mieux ;
i c’étoit en France qu’il lui étoit réfervé de fe voir
[• traité avec mépris par des hommes d’efprit, qui
[ ont voulu à toute force fe conrtituer législateurs
I dans un art dont ils n’avoientpas même étudié les
[ éléments.
Malgré les fuccès, les réçompenfes 8c la. renommée',
que le chevalier Gluck avoit obtenus en
Italie 8c en Allemagne par fes derniers opéra , il-
fentit qu’il pouvoit aller plus loin dans la carrière
qu’il avoit ouverte ; qu’une tragédie en mufique ,
dont les principaux rôles feroient exécutés par des
Caftr ats-, manqueroit toujours d’illufion 8c d’effet
théâtral ; qu’il ne pouvoit remplir dans toute fon
-étendue l’idée qu’il s’étoit faite d’une mufique
vraiment dramatique, qu’autant qu’il auroit des
poëmes réguliers en même-tems que tragiques , un
^ • théâtre magnifique 8c des aéleurs. exercés oc intelli-;
A gents ^ en état de joindre à l’art fiu chant une .ac-
tioi^yraie, noble 8c pathétique. Ibçpnçut en même«
A L L y?
tems qu’il ne pouvoit trouver qu’en France tous ces
moyens réunis.
Il communiqua ces idées au bailli du Roulet qui
fe trouvoit à Vienne , en 177a , attaché à l’ambaf-
fade de France. C ’étoit un homme d’e fp rit, qui
avoit le goût 8c l’habitude de nos théâtres, 8c qui,
malgré fes préventions anciennes pour la forme de
l’opéra françois , fut vivement frappé des idées que
lui préfenta Gluck. Il les adopta avec chaleur #
8c , de concert avec lu i , choifit Y Iphigénie de Racine
* comme le fujet le plus propre à réunir tout
l’intérêt de la tragédie aux grands effets d’une mufique
partionnée avec le fpe&acle 8c la variété que
comporte le théâtre lyrique. On fait de quel brillant
fuccès cette tentative rut couronnée ; mais nous
n’entrerons pas dans ces détails. A cette époque les
travaux du chevalier Gluck ceffent d’appartenir à
l’hiftoire de la mufique en Allemagne : c’ert à notre
théâtre , à notre langue qu’il a confacré fes talents
dans les dernières années de fa vie. Il ert venu réformer
notre opéra dans toutes fes parties 8c nous
donner une mufique qui fera éternellement la mufique
françoife. C ’ert donc à l’article France que
nous devons réfërver l’hirtoire de fes derniers ouvrages.
Nous nous contenterons d’ajouter ici que cet
homme extraordinaire ert mort à Vienne d’une attaque
d’apoplexie , le 15 Novembre 1787.
Nous n’avons pas dit que Gluck avoit compofé
la mufique de plufieurs opéra-comiques françois
8c allemands ; parce que lui-même raifoit peu de
cas de ces ouvrages, 8c qu’ils n’ont rien ajouté
ni à l’art, ni à fa renommée. Les allémands qui ont
renoncé à la prétention d’avoir des opéra lériëux
dans leur langue, y ont des opéra-comiques qui
font fort goûtés par le peuple ; parce que la mufique
tient davantage au goût national. Le plus célèbre
des compofiteurs en ce genre ert M. Hitter
de Leipfick. Il a donné , dit M. Burney , un grand
nombre d’opéra-comiques dont la mWique ert fi
naturelle 8c fi agréable , que les principaux airs ,
comme ceux du do&eur Arne èn Angleterre , font
chantés par tout le monde dans toute Y Allemagne,
8c que les plus faciles ont l’honneur d’être chantés
dans les rues.
Nous-aurions pu citer d’autres compofiteurs pour
le théâtre , tels que Bach, qui a donné en Angleterre
8c en Italie même , de grands opéra
où les amateurs ont trouvé de très-beaux airs.
M. Naumann , maître de chapelle de l’éleélèur
de Saxe , 8c Mi Mifliwefeck , né en Bohême , élevés
tous deux des écoles italiennes , 8c dont plufieurs
morceaux ont été exécutés à nos concerts avec
un fuccès trés-mérité.
Ce qui donne aux allemands une place très-dif-
tinguée dans Thiftoire de l’art ,.c’eft Je progrès rapide
8c prodigieux qu’ils ont fait faire àyvla mufique
inftrumentale ; c’eft cette multitude infinie de concerts
, de fymphonies , de pièces de clavecin 8c
autres, dont ils ont enrichi tous les concerts d<
m