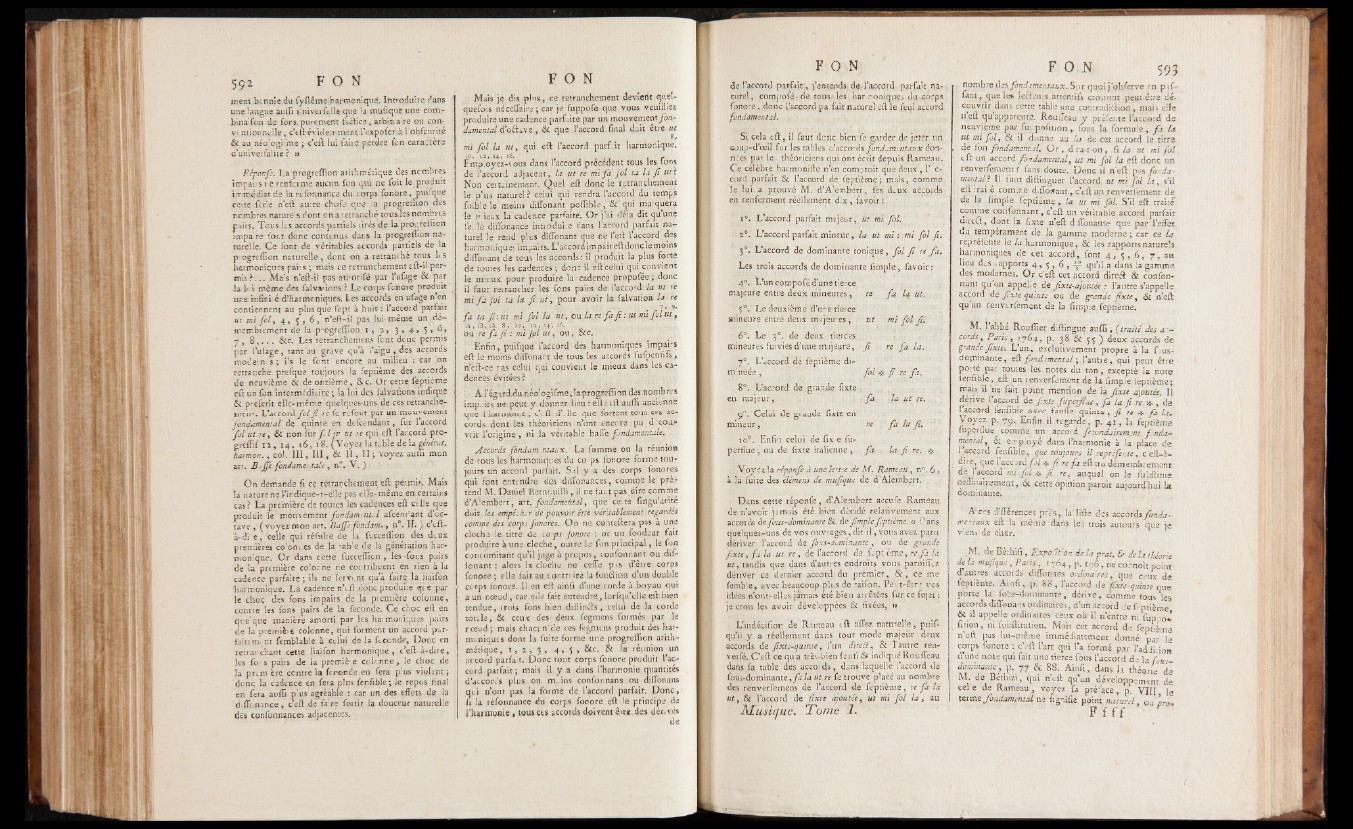
592 F O N
ment brnniedu fyftême;hartnôniquè. Ihtroduîre dans
une langue au fil univerféile qup la muüquè. une com-
binalfon de fors, purement faélice, arbitra-re ou con-
v< ntiônneile, c’d l évidemment l’expofer;à lohfcurité
6 au néo’ogi'me ; c’eft lui faire.perdre fcn caractère
d’univerfalité? »
Fèpor.fc. La progreflion arithmétique des nombres
impairs re renferme aucun, fon qui ne foit le produit
irr médiat de la réfonnance du corps fonore, puisque
cette prie n’eft au:re chofe que :a progreflion des
nombres n.ature's dont on a retranché tous.les nombres
paiis. Tous les accords partiels tirés de la progreflion
impa re font donc contenus dans la progreflion naturelle.
Ce font de véritables accords partiels de la
progreflion naturelle, dent on a retranché tous les
harmoniques pair s ; mais ce retranchement eft-il perm
is ? ... Ma:s n’eft-il pas au'orifé par l’ufage & p*r
la. k i même des falva'ions ? Le corps fonore produit
une infini é d’harmoniques. Les àc-cords enufage n’en
contiennent au plus que fept à huit : l’accord parfait
ut mi fo l, 4 , 5> 6 , n’eft-il pas lui-même un démembrement
de la p-ogrefîïon i , 2 , 3 * 4 »
7 , 8 , . . . &c. Les retrahehemens font denc permis
par l’ufage, tant'aü grave qu’à i’aigu, des accords
modem.s; ils le font encore au milieu : car on
retranche prefque toujours la feptième des accords
de neuvième & de onzième, &c. Or cette, feptième
eft un fon intermédiaire ; la Ici des falyations indique
& preferît elle-même quelques-uns-de ces retrançhe-
roen*. L’accord fo l f i re le .réfout par un mouvement
fondamental de quinte en dépendant, fur l’accord
fol ut~re\ & non fur f i l jv ut te qui eft l’accord pro-
greffif 12 , 14, 16, 18. ( Voyez la table de h générât,
hatmon. , col. I I I , I I I , & I I , I I ; voyez aufii mon
art. Bojfe fondamentale, n°. V . ) -
On demande fi ce retranchement eft permis Mais
la nature ne Pindique-t-elle pas elle-même en certains
cas? La première de toutes les cadences eft celle que
produit le mouvement fondanunt-l afçendant d octave
, ( voyez mon art. Baffe fondatn., n°. II. ) c’tft-
à-di e , celle qui réfalie de la fveceflion des deux
premières co’om.es de la tab'e. de la génération harmonique.
Or dans cette fucceffiun , les -focs pairs
de la première colonne r,e contribuent en rien a la
cadence parfaite; ils ne fervent qua. faire, la. liqifon
harmonique. La cadence n’tft.dqoc produite que parle
choc des fons impairs dé la pieçiiere colonne,
contre les fons pairs de la fécondé. Ce cHqc eft en
qire’que manière amorti par les harmoniques pairs
de la premièie colonne, qui forment un accord psr-
faitenv. nt femblable à celui de la Pccnde, Donc en
retrarchant cette liaifon harmonique, c’eft-à-dire,
les fo? s pairs de la premiè e colonne, le choc de
la pr^m ère centre la fécondé en fera plus violent ;
donc la cadence en fera plus fenfible; le repos final
en fera auffi p’us agréable : car un des effets de la
diflbnance, c’eft de fa re fortir la douceur naturelle
des confonnances adjacentes.
F O N
Mais jç dis plus, ce retranchement devient quelquefois
néceflaire ; car je fuppofe- que vous veuilliez
produire une cadence parfaite par un mouvement fonr
damental d’oéUve , & que l’accord final doit être ut
mi fol la ut, qui eft l’accord parf .it harmonique.
Employez-vous dans l’accord précédent tous les Tons
de l’accord adjacent, la ut re mi fa fol ta la f i wr?
Non certainement. Quel eft donc le retranchement
le p’us naturel? celui qui rendra l’accord du temps
folbie le moins diiîonânt poftible, & ’ qui manquera
le ir ieux là cadence parfaite. Or j’ai déjà dit qu’une
fed'e dîflbnance introduiie cans l’accord parfait naturel
le rend plus diffonant que ne l’èit l ’accord dès
harmoniques impairs. L’accord impair eft doncle moins
diffonant de tous les accords: il produit la plus forte
de' toutes les cadences ; donc il eft celui qui convient
le. mieux pour produire la; cadence propofee ; -donc
il faut; retrancher les fous pairs de. l’accord la ut re
mi fa fol ta la f i ut, pour avoir la faivation la re
fa ta fi: ut mi fo l la ut, ou la re fa f i : ut mi fol ut,
i i , i‘3 , i5. 8 , io , Ï2 , , 14> V ' V
Ou re f i f i : mi Jpl ut, o u , & c .
Enfin, puifque l’accord des harmoniques impairs
eft le moins diffonant de tous les accords fufpenufs,
n’eft-ce fàs celui qui convient le mieux dans les cadences
évitées?
A régfrd.du.néa’ogifme, la progreflion des nombres
impairs ne peut y donner, lieu :• elle eft aufli ancienne
que l ftarmbme; c’eft d’.lle que fortent tous ces accords
dojit les théoriciens n’ont encore pu d cou*
vrir l’origine , ni la véritable bafte. fondamentale.
Accords fondam.ntaux. La femme ou la reunion
de rous les harmoniques du co ps fonore forme toujours
un accord parfait. S'il y a des .corps fonores
qui fpnt entendre^ dés 'diftonances, co,mme le' prétend
M. Daniel Berncuilli,, il ne faut pas dire comme
d’Aleriibert, art. fondamental, que ' ce; te fingu'arité
doit les empêcher de pouvoir être véritablement regardés
comme des 'corps fonore.s. On ne conteftera. pas a une
clocha le titre de coips Jonore : or un fondeur fait
produire à une cloche, outre le fon principal, le fon
concomitant qu’il juge à propos, confonnant ou diffonant
: alors la cloche ne ceffe pis d’être corps
fonore ; elle fait au contraire la fonélion d’un double
corps fonore. Il en eft ainfi d’une corde à boyau qui
a un noeud, car eile fait entendre, lorfqu’elle eft bien
tendue, trois fons bien diflinéîs, celui de la corde
totale, & ceux des deux fegmens formés par le
roeud ; mais chacLn'de ces fegmens produit des harmoniques
dont la fuite forme une progreflion arithmétique,
1 , 2 , 3, 4*5» & c* & Itr réunion un
accord parfait. Donc tout corps fonore produit l’accord
parfait; mais il y a dans l’harmonie quantités
d’accôrès plus ou nu ins confomans ou diffonans
qi.i n’ont pas la forme de l’accord parfait. Donc ,
fi la réfonnance du corps fonore eft le principe de
l’harmonie, tous ces accords doivent êire des dérivés
de
de l’accord parfait , j,’entends do l’agçord parfait naturel,
compofér de tous les harmoniques du-.corps
fonore, donc l’accord parfait naturel eft le feu 1 accord
fondamental.
Si cela eft, il faut donc bien fe garder de jeter un
eoup-d’oeil fur les tables c’accords fondamentaux données
par le,, théoriciens qui ont écrit depuis Rameau.
Ce célèbre harmonifte n’en comptoit que deux, 1’ c-
cord parfait & l’accord de. feptième ; mais, comme
le lui. a prouvé M. d’Â ’ecnbërt, fes d*.ux accords
en renferment réellement dix , favoir :
i°. L’accord parfait majeur, ut ml fol.
20. L’accord parfait mineur, la ut mi : mi fol fi.
30. L'accord de dominante tonique, fo l f i re fa .
Les trois accords de dominante fimple, favoir:
40. L’un compoféd’uné tierce
majeure entre detrx mineures, re fa la ut.
5°. Le deuxième d’n re tierce
mineure entre deux ma jeu-es, ut mi fo l fi:
6°. Le 3 e. de deux tierces
mineures fuivies d’une majeure, ß re fa la.
70. L’accord de feptième diminuée
, fol * fi f.e fa.
8°. L’accord de grande fixte.
en majeur ,. f a fa, ut re.
9°. Celui de grande fixte en
mineur, re fa la fi.
io°. Enfin celui de fix e fu-
perflue, ou de fixte italienne, fi • la .fi rr. &
Voyez la réponfe à une le'tre de M. Rameau, n°. 6 ,
à la fuite des élèmens de rpufique de d’Aleinbprr.
Dans cette réponfe, d’Alembert accufe Rameau
de n’avoir jamais été bien décidé relativement aux
accords de fous-dominante & de fimple feptième. « Dans
quelques-uns de vos ouvrages, dit-il, vous avez paru
dériver l’accord de fous-lominante, ou de grande
fixte, fa la ut re, de l’accord de feptième, re fa la
ut, tandis que dans d’autres endroits vous paroifttz
dériver ce dernier accord du premier, & , ce me
femble, avec beaucoup plus de raifon. Peut-être vos
idées nonlrelles jamais été bien arrêtées fur ce fujet :
je crois les avoir développées & fixées, »
L’indécifior. de Rnmeau tft affez naturelle, puif-
qu’il y a réellement dans tout mode majeur deux
accords de fixte-quinte,T'un direél, & l’autre ren-
verfé. C’eft ce qu’a très-bien fenti & indiqué Rouffeau
dans fa table des accords, dans laquelle l’accord de
fous-dominante, fa là ut re fe trouve placé au nombre
des renverfemens de l'accord de feptième, re fa la
ut, & l’accord de fixte ajoutée, ut mi fol la , au
Musique. Tome 1.
nombre des fondamentaux. Sur quoi j ’obferve en paf-
fant, que le« leéteurs attentifs croiront peut-être découvrir
dans cette table une contradiélion, mais elle
n eft qu apparente. Rouiïèau y préfente l’accord de
neuvième par fuppofition , fous la formule, fa la
ut mi fo l, & il donne au la de cet accord le titre
de l'on fondamental. O r , d.ra-t-oir, fi la ut mi fol
tfb un accord fondamental, ut ml fol la eft donc un
renverfement ? fans doute. Donc il n’eft pas fondamental?
\\ faut diftinguer l’accord ut mi fol la, s’il
ell trai e comiT.e d.flouant., c’eft un renverfement de
de la fimple feptième, la ut mi fol. S’il eft traite
comme confonnant, c’eft un véritable accord parfait
diceef , dont la fixte n’eft d ftonante que par l’effet
du tempérament de la gamme moderne ; car ce la
reprefente le la harmonique, & les rapports naturels
harmoniques de cet accord, font 4 , 5 , 6 , 7 , a»
lieu des 1 apports 4 , 5 ,6 , qu’il a dans la gamme
des modernes. Or c'éft cet accord direâ & confon-
nant qu on .appelle .de fixte-ajbutée : l’autre s’appelle
accord :dë fixte quinte . ou de grande fixte, & n’eft
qu’un renverfement de la fimple feptième.
M. l’-abbé Rouflier diftingue auffi, ( traité des accords,
Paris, 1764, p. 38 & 5 7 ) deux accords de
P)rande fixtey L’un, exclulivement propre à la f;us-
d opinante, eft fondamental-, l’autre, qui peut être
porté par routes tes notes du ton, excepté la note
iepfibje,,eft ,un renverfement de la fimple feptième;
*r';aîê ^ ne f?st point mention de là fixte ajoutée. Il
dçnvé l’accord de fixte fuperfiue, fa la f i re , de
1.accord fenfible avec fauffe quinte , f i re & fa la.
Voyez p. 79.; Enfin il regarde, p. 41 , la feptième
fujperfiue comme un accord fezondairemznt fondamental,
& employé dans l’harmonie à la place de
1 accord fenfible, que toujours il repréfente, c’eft-àr-
dire, que i accord fol & f i re fa eft un démembrement
dejaccord m i . f o l f i re, auquel on le fuoftitue
orairàjrement, & cette opinion paroit aujourd'hui la
dominante.
Aces différences près, la lifte des accords fondamentaux
eft la meme dans les trois auteurs que je
vlen» de citer.
.M- de Béthifi , Expofit'on de la prat. & de la théorie
de U mujiqùc, Paris , 1764, p. 196, ne connoît point
d’autres accords diffonans ordinaires, que ceux de
feptième/ Ainfi, pi 88 , l’accord de fixte-quinte que
porte là fou^-dominante, dérive, èomme tous les
accords diffonans ordinaire?, d’un accord de feptième
& il appelle ordinaires ceux où il n entre ni ftippc*
firion, ni fubftkution. Mais cet accord de feptième
n’eft pas lui-même immédiatement donné par le
corps fonore: cYft l’art qui l’a formé par l’addidon
d’une note qui fait une tierce fous l’accord de la fous-
dominante , p. 77 & 88. Ainfi, dans la théorie de
M. de Betiiïzi, qui n eft qu’un développement de
cel'e de Rameau, voyez fa préface, p. VIII le
terme fondamental ne lignifie point naturel, ou i-o-
F f f f p ‘