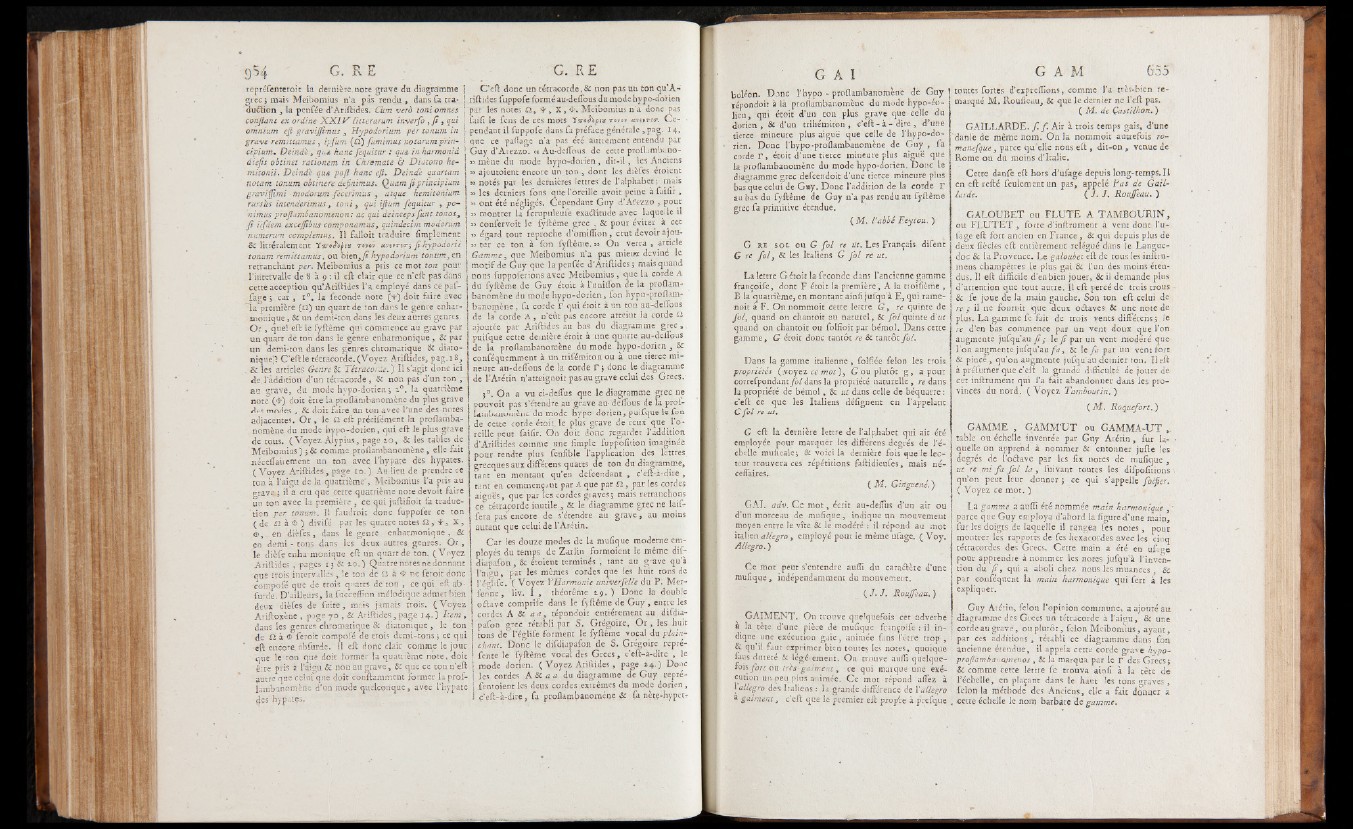
954 G.
repréfenteroit la dernière, note grave du diagramme j
grec j mais Meibomius n'a pas rendu , dans fa et a- !
duéïion , la penfée d'Ariftides. Cîim vero torti omnes
confiant e x ordine X X I V iilttra rum inverfo 3f i , qui I
om n ium efi graviffimus 3 Hypodorium per to n um in \
grave remittamus , iv fum (42) fum im u s notarum p'rin- i
cipiuin. Deinde., que, hanc feq u itu r : que in harmoniâ
diefis ob tin et rationem in Ckremate & D ia to n o he-
m ito n ii. D e in d e que p o fi hanc efi. D e in d e quartam
n o tam tonum obtinere definimus. Qitam fip r in c ip ium
gravi(Jimi - fnodorum fec eri/nus 3 atque hemitofuïïm
rursiis in ten d erimu s, to n i 3 qui ifium feq u itu r , p o -
nimus profiambanomenon : ac qui deinceps fu n t tonos3
f i iifd em excejfibus componamus, quindecim modorum
numerum complemus. Il falloit traduire Amplement
& littéralement Y■sroê'opsss t »»«v uviiTtr-, f i hypodorii
to n um rem ittam u s, ou bien3f i kypodorium to n um 3 en
retranchant per. Meibomius a pris ce mot to n pour
f intervalle de 8 à 9 : il eft clair que ce n'eft pas dans
cette acception qu’Ariftides f a employé dans ce paf-
fage 5 car 3 i ° . la fécondé note (ÿ) doit faire avec
~la première (42) un quart de ton dans le genre enharmonique
, & un demi-ton dans les deux autres genres.
O r , quel eft le fyftême qui commence au grave par
un quart de ton dans le genre enharmonique, & par
un demi-ton dans les genres chromatique & diatonique]?
C’eftle tétracorde. (Voyez Ariftides, pag.iS^
. & les articles Genre 8t Tétracorde.) Il s’agit donc ici
de.l’addition d’un tétracorde, & non pas d’un ton ,
au grave, du mode hypo-doricn; i ° . la quatrième
note (<$) doit être la proflambanomène du plus grave
des modes , & doit faire un ton avec l’une des notes
adjacentes. Or , le 42 eft précifément la proflamba-
• pomène du mode hypo-dorien, qui eft le plus grave
de tous. (Vo y e z Aiypius, page 2.0, & les tables de
Meibomius) 5 & comme proflambanomène, elle fait
néceflaiieoeent un ton avec l'hypate des hypates.
( Voyez Ariftides, page 10.) Au lieu de prendre ce
ton à l’aigu de la quatrième", Meibomius l’a pris au
tfrave; il a cru que cette quatrième note devoit faire
un ton avec la première , ce qui juftifîoit fa traduc-
J tien per to n um . Il faudroit donc fuppofer ce ton
(d e 42 à è> ) divifé par les quatre notes 42, X,
«P, _ en dièfes , dans le genre enharmonique, &
en demi - tons dans les deux autres, genres. O r ,
■ le dièfe enha monique eft un quart de ton. (Voyez
Ariftides , pages 13 & ^ o . ) Quatre notes ne donnant
que trois intervalles ,.’e ton de 42 à <I> ne feroit donc
-compofé que de trois quarts de ton , ce qui eft ab-
furde. D’ailleurs, la fucceffion mélodique admet bien
deux dièfes de fuite, mais jamais trois. (V oyez
Ariftoxène , page 70 , & Ariftides, page 14. ) h e m J
dans les genres chromatique Sx diatonique , le ton
de 42 à $ feroit compofé de trois demi-tons j ce qui
eft encore, abfurde. 11 eft donc clair comme le jour
que le ton que doit former la quatrième note, doit
être pris à l'aigu & non au grave, & que ce ton n’eft
jiutre que celui que doit conftamment former la prof-
jambanomène d’un mode quelconque, avec l'hypate
des hypates.
G . R E
C ’eft donc un tétracorde,& non pas uti ton qu’A -
riftides fuppofe formé au-deffous du mode hypo-doïien
par les notes 42, ^ , X , <S>. Meibomius n’a donc pas
faifi le fens de ces mots Yiraé'ôpi* rovov avivrea-, Ce- •
pendant il fuppofe dans fa préface générale, pag. 14,
que ce paflage n’a pas été autrement entendu par
Guy d’Arezzo. cc Au-déflous de cette proflambuno-
» mène du mode hypo-dorien, dit-il, les Anciens
sa ajoutoient encore un ton , dont les dièfes étoient
33 notés par les dernières lettres de l’alphabet ; mais
33 les derniers fons que l’oreille avoit peine à faifir ,
33 ont été négligés. Cependant Guy d’Afezzo , pour
33 montrer la fcrupuleufe exactitude avec laquelle il
33 confervoit le fyftême grec , & pour éviter à cet
33 égard tout reproche d’omiflion, crut devoir ajou-
33 ter ce ton à fon fyftême. 33 On verra , article
Gamme, que Meibomius n’a pas mieux deviné le
motif de Guy que la penfée d’Ariftides 5 mais quand
nous fuppoferions avec Meibomius , que la corde A
du fyftême de Guy étoit à l’unilTon de la proflambanomène
du mode hypo-dorien, fon liypo-proflam-
banomène, fa corde r qui étoit à un ton au-deflous
de la* corde A , n’eût pas encore atteint la corde 42
ajoutée par Ariftides au bas du diagramme grec ,
puifque cette dernière étoit à une quarte au-deflous
de la proflambanomène du mode hypo-dorien , &
conféquemment à un trifémiton ou à une tierce mineure
au-deflous de la corde r 5 donc le diagramme
de 1-Àtétin fi’atteignoic pas au grave celui des Grecs.
5°. On a vu ci-dcfîus que le diagramme grec ne
pouvoit pas s’étendre au grave au- deflous de la prof-
iambanomène du mode hypo-dorien, puifque le fon
de cette corde étoit. le plus grave de ceux que l’oreille
peut faifir. On doit donc regarder l’addition
d’Ariftides comme une (impie fuppoficion imaginée
pour rendue plus fenfible l’application des lettres
grecques aux différens quarts de ton du diagramme,
tant en montant qu’en defeendant , c’eft-à-dire ,
tant en commençant par A que par 42, par les cordes
aiguës, que par les cordes giaves; mais retranchons
ce tétracorde inutile , Sx le diagramme grec ne laifr
fera pas' encore de s’étendre au grave, au moins
autant que celui de l’Arétin.
Car les douze modes de la mufique moderne employés
du temps de Zarlin formoient le même dif-
diapafonI & étoient terminés , tant au grave qu’à
I l’aigu, par les mêmes cordes que les huit tons de
| l’éclife. ( Voyez \ Harmonie univerfelle du P. Mer-
j fenne , liv. I , théorème 19. ) Donc la double
j oCtave comprifc dans le fyftême de Guy , entre les
| cordes A & a a , répondoit entièrement au difdia-
I pafoh grec rétabli par S. Grégoire, O r , les huit
tons de l’églife forment le fyftême vocal du plain-
I chant. Donc le difdiapafon de S. Grégoire repré-
] fente le fyftême vocal des Grecs, c’eft-à-dire , le
j mode dorien. ( Voyez Ariftides , page 14.) Donc
j les cordes K Sx. a a du diagramme de Guy repré-
j fentoient les deux cordes extrêmes du mode dorien,
1 ç’eft-à-dire, fa proflambanomène & fa nète-hypeç-r
G A l
boléon. Donc l’hypo - proflambanomène dé Guy 1
ïépondoit à là proflambanomène du mode hypo-éo-
lien, qui étoit d’un ton plus grave que celle du
dorien , & d’un trihémiton , c’eft - à - dire , d’une
tierce mineure plus aiguë que celle de l’hypo-do-
ricn. Donc l’hypo-proflambanomène de Guy , fa
cord e r , étoit d’une tierce mineure plus aiguë que
la proflambanomène du mode hypo-dorien. Donc le
diagramme grec defeendoit d’une tierce mineure plus
bas que celui de Guy. Donc l’addition de la corde r
au bas du fyftême de Guy n’a pas rendu au fyftême
grec fa primitive étendue,
(AL l'abbé Eeytou. )
G re sol ou G fo l re Ht. Les Français difent
G re fo l3 Sx les Italiens G fo l re ut.
La lettre G étoit la fécondé dans l’ancienne gamme
françoife, dont F étoit la première , A la troifièrrie ,
R la quatrième, en montant ainfi jufqu’à E, qui rame-
lioit à F. On nommoit cette lettre G , re quinte de
fo l} quand on chantoit au naturel, & fo l quinte à'ut
quand on chantoit ou folfîoit par bémol. Dans cette
gamme, G étoit donc tantôt re & tantôt fol.
Dans la gamme italienne, folfîée félon les trois.
propriétés (yoyez ce mot ), G ou plutôt g , a pour
correfpondant fo l dans la propriété naturelle , re dans
la propriété de bémol, & ut dans celle de béquarre :
c’eft ce que les Italiens défignent en l’appelant
G fo l re ut.
G eft la dernière lettre de l’aîpiiabet qui ait été
employée pour marquer iès_ différens degrés de l’échelle
roufîcalej & voici la dernière fois que le lecteur
trouvera ces répétitions faftidieufes, mais né-
ceffaires.
( M. Ginguenê. )
GAI. adv. Ce mot, écrit au-deflus d’un air ou
d’un morceau de mufique, indique un mouvement
moyen entre le vîte & le modéré : il répond au mot
italien allegro, employé pour le même ufage. ( Voy.
Allegro.')
Ce mot peut s’entendre aufli du caraftère d’une
mufique, indépendamment du mouvement.
( J. J. Roujfeau. )
GAIMENT. On trouve quelquefois cet adverbe
a la tête d’une pièce de mufique françoife : il indique
une exécution gaie, animée fans l’être trop ,
& qu’il faut exprimer bien toutes les notes, quoique
fans dureté & légèrement. On trouve aufli quelquefois
fort ou très-gain:ent, ce qui marque une exécution
un peu plus animée. Ce mot répond aflez à
1 allegro des Italiens : la grande différence de Xallegro
a gainent, c’eft que le premier eft propre à prefque
G A M 635
toutes fortes d’expreffions, comme l’a très-bien remarqué
M. Roufleau, & que le dernier ne l ’eft pas.
( M. de Çastilhon. )
GAILLARDE, f . f . Air à trois temps gais, d’une
'danfe de même nom. On la nommoit autrefois ro-
manefque 3 parce qu’elle nous, eft , dit-on , venue de
Rome ou du moins d’Italie.
Cette danfe eft hors d’ufage depuis long-temps. II
en eft refté feulement un pas, appelé Pas de Gaillarde.
{ J . J. Roujfeau. )
GALOUBET ou FLUTE A TAM BO URIN,
ou F L U T E T , forte d’inftrument à vent dont l’u-
fage eft fort ancien en France, & qui depuis plus de
deux fiècles eft entièrement relégué dans le Languedoc
& la Provence. Le galoubet eft de tous les inftru-
rnens champêtres le plus gai & l’un des moins étendus,
Il eft difficile d’en bien jouer, & il demande plus
d’attention que tout aucre. Il eft percé de trois trous -
Sx fe joue de la main gauche. Son ton eft celui de
re / il ne fournit que deux oétaves & une note de
plus. La gamme fe fait de trois vents différens j le
re d’en bas commence par un vent doux que l’on
augmente jufqu’au f i ; le f i par un vent modéré que
l ’on augmente jufqu’au fa 3 & le fa par un vent fort
& pincé, qu’on augmente jufqu’au dernier ton. Il eft
à préfuiïier que c’eft la grande difficulté de jouer de
cet inftrument qui l’a fait abandonner dans les provinces
du nord. ( Voyez Tambourin. )
( M.. Roquefort. )
GAMME , GAMM’U T ou GAMMA-UT
table ou échelle inventée par Guy Arécin, fur la- •
quelle on apprend à nommer & entonner jufte les
degrés de l’oétave par les fix notes de mufique 3
ut re mi fa fo l la , fuivant toutes les difpofitions \
qu’on peut leur donner j ce qui s’appelle folfier.
( Voyez ce mot. )
La gamme a aufli été nommée main harmonique 3 ’
parce que Guy employa d’abord la figure d’une main,
fur les doigts de laquelle il rangea fes notes, pour
montrer les rapports de fes hexacordes avec les cinq
cétracordes des Grecs. Cetre main a été en ufaoe
pour apprendre à nommer les notes jufqu’à l ’invention
du f i y qui a aboli chez nous les muances 8c
par conféquent la main harmonique qui fert à les
expliquer.
Guy Arétin, félon l’opinion commune, a ajouté au
diagramme des Grecs un tétracorde à l’aigu, & une
corde au grave, ou plutôt, félon Meibomius, ayant,
par ces additions , rétabli ce diagramme dans fon
ancienne étendue, il appela cette corde grave hypo-
proflàmb;anomenos, & la marqua par le r des Grecs 5
& comme cette lettre Ce trouva ainfi à la tête de
l’échelle, en plaçant dans le haut les tons graves,
félon la méthode des Anciens, elle a fait donner à
cette échelle le nom barbare de gamme.