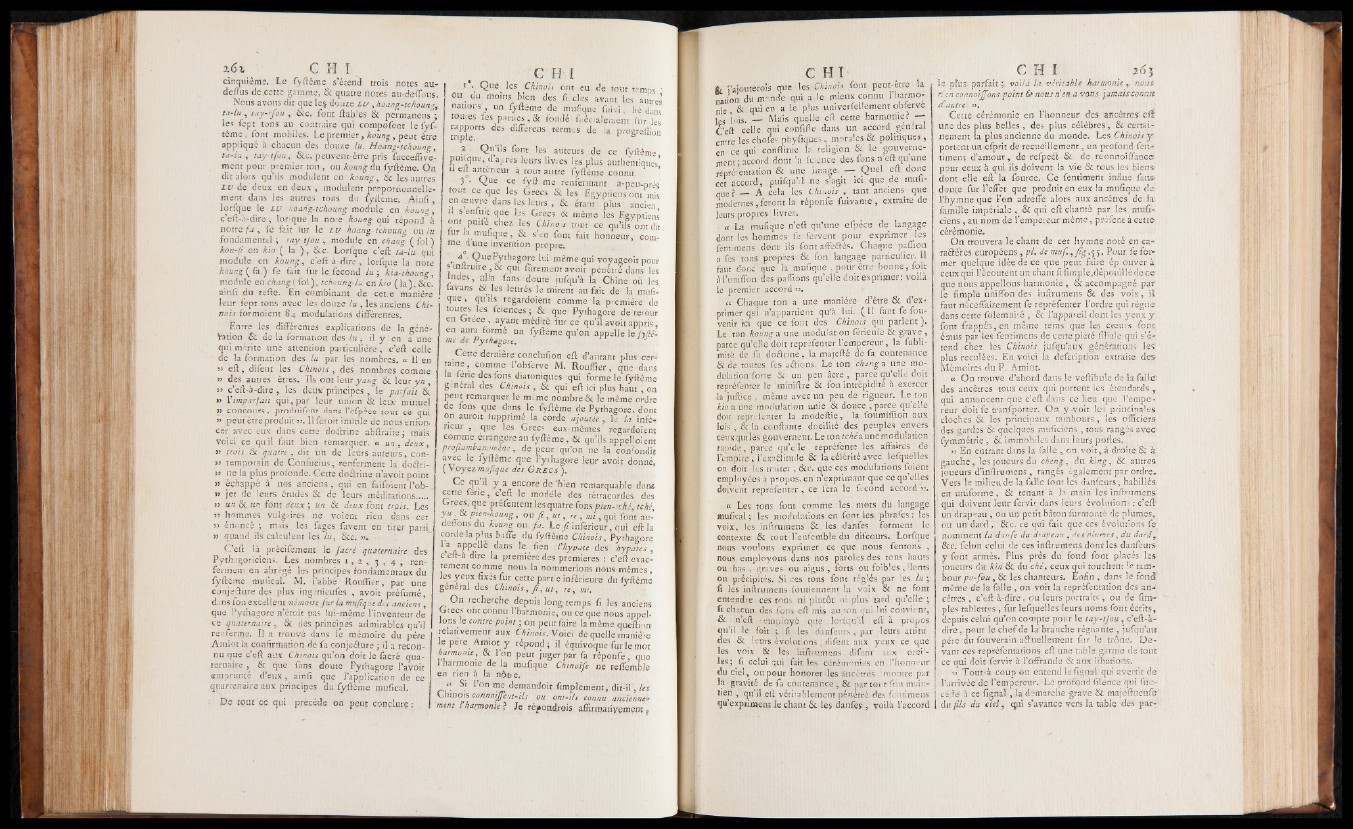
z 6 z C H I
cinquième. l e fyftême s’étend trois notes au-
deiîus de .cette gamme, 8c quatre notes au-deflbus.
Nous avons dit que les douze l u , hoang-tchoun?.
tà-lu , tay-tfou , &c. font ftables & permanent;
les fept tons au contraire qui compofent le fy ftême
, font mobiles. Le premier , koung, peut être
appliqué à chacun des douze lu. Hoang-tchoung,
ta-lu , tay-tfou, &c. peuvent'être pris ïuccelfive-
ment pour premier ton, ou koung du fyftême. On
dit alors qu’ils modulent en koung, 8c les autres
l u de deux en deux , modulent proportionnellement
dans les autres tons du fyftême. A in fi,
lorfque le l u hoang-tchaung module en kouna #
c’eft-à-dire, lorique la note koung qui répond à
notre fa , fe fait lur le l u hoang tchoung ou lu
fondamental ; tay-tfou , module en chang ( fol )
kou-fi en kio ( la ) , 8cc. Lorfque c’eft ta-lu qui
module en koung, c’eft à-dire , lorfque la note
koung ( fa ) fe fait fur le_ fécond lu ; kia-thoung,
module en chang [ iol), tchoung-Lu en kio ( la ) , 8cc.
ainfi du refte. En combinant de cette manière
leur fept tons avec les douze lu , les anciens Chinois
formoient 84 modulations différentes.
Entre les différentes explications de la génération
8c de la formation des lu , il y en a une
qui mérite une attention particulière, c’eft celle
de la formation des lu par les nombres. « 11 en
|j e ft, difent les Chinois, des nombres comme
»? des autres êtres. Ils ont leur yang & leur yn ,
»3 c’eft-à-dire , les deux principes , le parfait 6c
»> Y imparfait qui, par leur union & lent rnutuel
» concours, produifent dans l’efpèce tout ce qui
” peut être produit ». llferoit inutile de nousenfon-
cer avec eux dans cette doârine abftraiite ; mais
voici ce qu il faut bien remarquer. « un , deux,
3) trois 81 quatre , dit un de' leurs auteurs, con-
>3 temporain de Confucius ; renferment la doclri-
>3 ne la plus profonde. Cette do&rine n’avoit point
j> échappé à nos anciens, qui en faifoient l’ob- ,
3» jet de leurs études 8c de leurs méditations.....
»» un Sl un font deux ; un 6c deux font trois. Les
33 hommes vulgaires ne voient rien dans cet j
33 énoncé ; mais les fages favent en tirer parti,-
3> quand ils calculent les lu, &c. ».
C ’eft là précifément le facrê quaternaire des
Pythagoriciens. Les nombres 1 , 2 , 3 , 4 , renferment
en abrégé les principes fondamentaux du
fyftême muftcal. M. l’abbé Rouftier, par une
conjecture des plus ingénieufes , avoit préfumé,
dans fon excellent mémoire fur la mufîque des anciens ,
que Pythagore n’étoit pas lui-même l’inventeur de
te quaternaire, & des principes admirables qu’il
renferme. Il a trouvé dans le mémoire du père
Arniot la confirmation de fa conjeâure ; il a reconnu
que c’eft aux Chinois qu?on doit le facré quaternaire
, 8c que fans doute Pytbagorp l’avoit
emprunté d’eux , ainfi que l’application de ce
quartenaire aux principes du fyftême muftcal.
De tout ce qui précédé on pçut conclure: |
C H I
t . Que les Chinois ont eu de tout temps ’
ou du moins bien des Cèdes avant les autres
nations , un fyftême de miifique ïuivjJ lié dans
toutes xes parues, & fondé fpécialemênt fur les
™PP°rts des diffêrens termes de la progreffion
2 . Qu ils font les auteurs de ce fyftême
puisque, d’après leurs livres les plus authentiques*
u eft antérieur à tout autre fyftême connu. ’
3 • Que ce fyft me renfermant à-peu-près
tout ce que les Grecs & les Egyptiens ont mis
en oeuvre dans les leurs , & étant plus ancien
il s enfuit que les Grecs & même les Egyptiens
ont puifé chez les Chinos tout1 ce qu’ils ont dit
ur la mufique, 8c s’en font fait honneur, eom-
! me « une invention propre.
,. Que Pythagore lui même qui voÿageoit pour
s inftruire , oc qui fûrement avoit pénétré dans les
Indes, alla fans doute jufqu’à la Chine où les
iavans 8c les lettrés le mirent au fait de la mufique
, qu ils regardoient comme la première de
toutes les fciences; & que Pythagore de retour
en Grèce , ayant médité fur ce qu’il avoit appris,
en aura formé un fyftême qu’on appelle le foflê-
me de Pythagore. J
Cette derniere conclufion eft d’autant plus cer-
3 comme l’obferve M. Rouftier, que dans
la ferie des fons diatoniques qui forme le fyftême
général des Chinois , 6c qui eft ici plus haut , on
peut remarquer le mime nombre 8c le même ordre
de fons que dans le fyftême de Pythagore, dont
on auroit fupprimé la corde a jo u t é e le la inférieur
, que les Grecs eux-mêmes regardoient
comme étrangère au fyftême, 6c qu’ils appel! oient
proflambanomène, de peur qu’on ne la confondît
avec le fyftême que Pyihagore leur avoit donné,
( Voyez mufique des G r e c s ).
,4 y ,a encore de 'bien remarquable dan«
cette férié, c’eft le modèle des tétracordes des
Grecs, que préfentent les quatre fons pien-tché, tchè,
yu & pien-koung, ou f i , u t , , mi, qui font audeiTous
du koung ou fa. L e / inférieur, qui eft la
corde la plus baffe du fyftême Chinois, Pythagore
^ >3 aP P ^ e dans le fien Chypate des hypates ,
c eft-à dire la première des premières : c’eft exactement
comme nous la nommerions nous mêmes,
les yeux fixes fur cette partie inférieure du fyftême
général des Chinois, f i , ut, re, mi.
On recherche depuis long.-temps fi les anciens
Grecs ont connu l’harmonie, ou ce que nous appel-
Ions le contre-point ; on peut faire la même queftion
relativement aux Chinois. Voici de quelle manière
le pere Amiot y répond; il équivoque fur le mot
harmonie, 8c l ’on peut juger par fa réponfe, que
1 harmonie de la mufique Chinoife ne reflemble
en rien à la nôtre,
“ * l’on me demandoit fimplement, dit-il, les
Chinois connoijfent-ils ou ont-ils connu ancienneh
ment l harmonie] Je répondrois affirmativement ?
c h i
I t -,’aiouteroîs que les ChinôU font peut-être la
Mtion du monde qui a le mieux connu 1 lrarmo-
& qui en a le plus univerfellement obferve
j s î0is. __Mais qu&lle eft cette harmonie ?
C’eft celle qui confifte dans un accord general
entre les choies- phyfiques, morales & politiques ,
en ce qui conftitue la-religion & le gouvernement;
accord dont ’a fdence des fons n’eft qu une
repréfentation & une image. —- Quel eft donc
cet accord, puifqu’il ne s’agit ici que de muli-
qlie ? — A cela les Chinois , tant anciens que
modernes,feront la réponfe fuivame , extraite de
leurs propres livres.
<( La mufique n’eft qu’une efpèce de langage
dont les hommes fe fervent pour exprimer les
fentimens dont ils font afte&és. Chaque pafiion
a fes tons propres 6c fon langage particulier. 11
faut donc que la mufique , pour être bonne, foit
àTunififon des pallions qu’elle doit exprimer: voilà
le premier accord
et Chaque ton a une manière d’être 6c d’exprimer
qui n’appartient qu’à lui. ( I l faut fe fou-
venir ici que ce font des Chinois qui parlent).
Le ton koung a une modulation férieufe 6c grave ,
parce qu’elle doit repréfenter l’empereur , la fubli-
mitè de fa çloélrine, la majefté de fa contenance
8c de toutes fes avions. Le ton chang a une modulation
forte 8c un peu âcre, parce qu’elle doit
repréfenter le miniftre 6c fon intrépidité a exercer,
-la juftice , même avec un peu de rigueur. Le^ ton
kio a Une modulation unie 6c douce , parce qu’elle
doit repréfenter la modeftie, la 'foumiffion aux
lois, 6c la confiante docilité des peuples envers
ceuxquiîes gouvernent. Le ton tchéa.une modulation
rapide, parce qu’elle repréfente les affaires de
l’empire, l’exaélitude 8c la célérité avec lefquelles
on doit les traiter, Sec. que ces modulations foient
emnlnvép»; à nronos.en ’
. « Les tons font comme les mots du langage
mufical ; les modulations en font les phrafes : les
voix, les inftrumens 6c les danfes forment le
contexte 6c tout l’enfemble du difeours. Lorfque
nous voulons exprimer ce que nous fentons ,
nous employons dans nos paroles des tons hauts
ou bas , - graves ou aigus , forts ou foibles , ^lents
ou précipités. Si ces tons font réglés par les lu ;
fi les inftrumens fôutiennent la voix 6c ne font
entendre ces tons ni plutôt ni plus tard qu’eMe ;
fi ch; rcun des fons eft mis au ton qui lui convient,
& n’eft r employé que lorlqu’i! eft à propos
qu’il le foit ; fi les danfeurs , par leurs attitu
des 8c leurs évolutions , difent aux yeux ce que
les voix 8c les inftrumens difent aux oreilles,;
fi celui qui fait les cérémonies en l’honneur
du ciel, ou pour honorer les ancêtres / montre par
la gravité de fa contenance , 6c par tout fon maintien
, qu’il eft véritablement pénétré des fentimens
qu’expuiment le chant 6c les danfes , voilà l’accord
C H I
le plus parfait;' voila la véritable harmonie, nous
h en connoiffons point & nous ri en a von s jamais connu
d autre ».
Ceite cérémonie en l’honneur des ancêtres' eft?
une des plus belles , des plus célèbres, 6c certainement
la plus ancienne du monde. Les Chinois y
portent un efprit de recueillement, un profond fen-
timent d’amour, de refpeél 6c de reonnoiftancei
pour ceux à qui ils doivent la vie 8c tous les biens
dont elle eft la Iburce. Ce fentiment influe fans
doute fur l’effet que produit en eux la mufique dei
l’hymne que Fon adreffe alors aux ancêtres de la
famille impériale , 6c qui eft chanté par les mufi-.
ciens, au nom de l’empereur même, préfent à cette
cérémonie.
On trouvera le chant de cet hymne noté en ca-
•raâères européens , pl. de mufi., fig -.55. Pour fe former
quelque idée de ce que peut faire éprouvera
ceux qui l’écoutent un chant fi fimple,dépouillé de ce
que nous appelions harmonie , oc accompagné par
le fimple uniffon des inftrumens 6c des v o ix , il!
faut néceffairement le repréfenter l’ordre qui règne
dans cette folemnité , 6c l ’appareil dont les yeux y
font frappés, en même tems que les coeurs -font
émus par les fentimens de cette piété filiale qui s’étend
chez les Chinois jufqu’aux générations les
plus reculées. En voici la defcriptiôn extraite des
Mémoires du P. Amiot.
« On trouve d’abord dans,le veftibule de lafalle-
des ancêtres tous ceux qui portent les étendards r
qui annoncent que c’eft dans ce lieu que l’empereur
doit fe transporter. On y-voit les principales
cloches 6c les principaux tambours , les officiers
des gardes & quelques mufteiens , tous rangés avec-
fymmétrie, 6c immobiles dans leurs poftes.
53 En entrant dans la falle , on voit, à droite 6c k
gauche, les joueurs du cheng, du king, 8c autre»
joueurs d’inftrumens , rangés également par ordre*
Vers le milieu de la falle font les danfeurs, habillés
en uniforme, 8c tenant à h main les inftnrmens
qui doivent leur lervir dans leurs évolutions : c’eftr
un drapeau , ou. un petit bâton furmonté de plumes,
! ou un dard , 8cc. ce qui fait que ces évolutions fe
nomment la danfe du drapeau , des plumes, du dardy
8cc. félon celui de ces inftrumens dont les danfeurs
y font armés. Plus prés du fond font placés les
joueurs du kin 8c du ché, ceux qui touchent le tambour
po-fou, 6c les chanteurs. Enfin , dans le fond
; même de la falle , on voir la repréfentation dès an-
' cêtres , c’eft à-dire, ou leurs portraits , ou de fim-
pies tablettes , fur lefquelles leurs noms font écrits,
1 depuis celui qu’on compte pour le tay-tfou, c’eft-à-
dire, pour le chef de la branche régnante , jufqu’aiï
père du fouverain aéhiellement fur le trône. Devant
ces repréfentations eft une table garnie cîe tout
ce qui doit fervir à l’offrande 6c aux libations.
5j Tout-à-coup on entend le lignai qui avertit de
l’arrivée de l’empereur. Le profond filence qui fuc-
cèriè à ce lignai, la démarche grave 6c majeftueule
da fils du ciel, qui s’avance vers la table des par