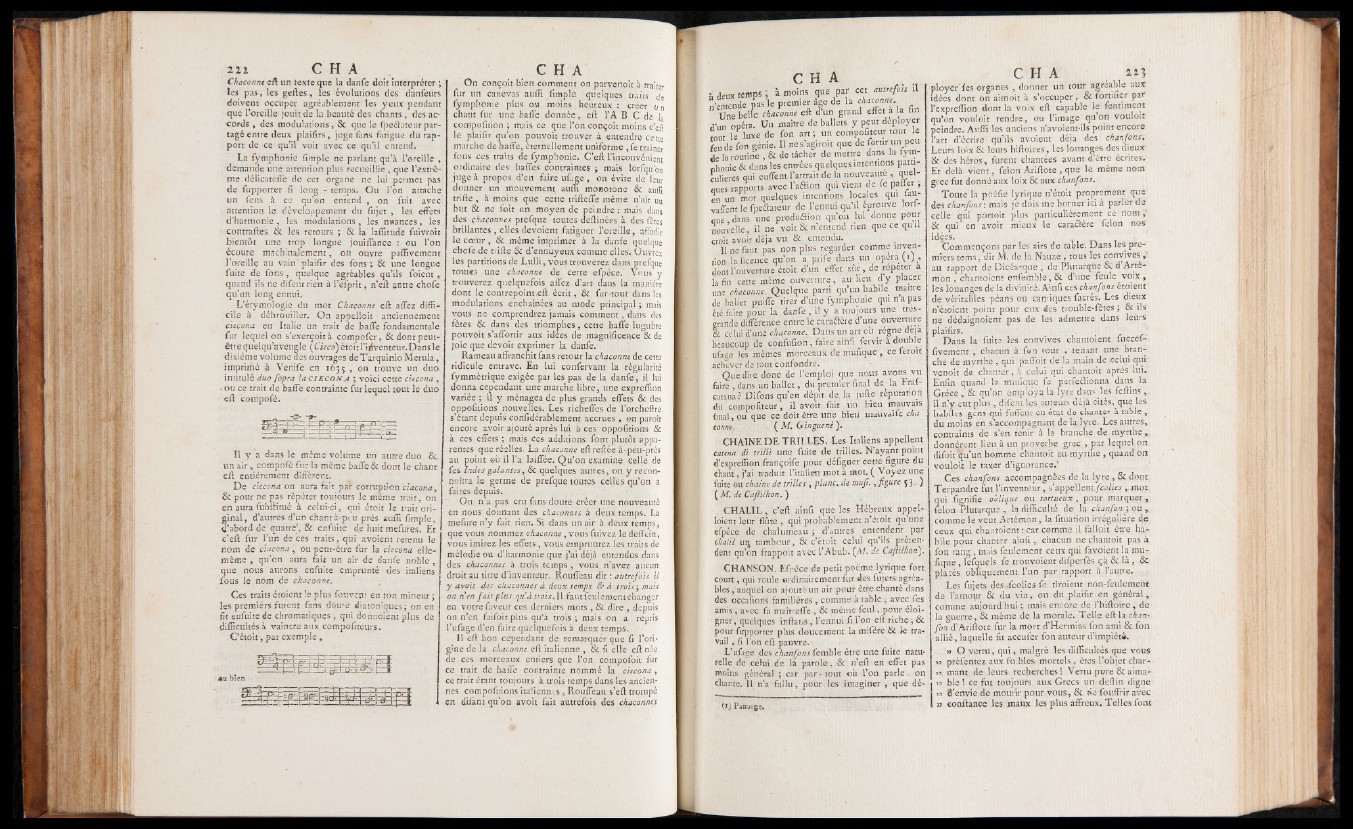
2 2 1 C H A
Chaconne eft un texte que la danfe doit interpréter ;
les pas, les geftes, les évolutions des danfeurs
doivent occuper agréablement les yeux pendant
que l’oreille jouit de la beauté des chants , des accords
, des modulations , & que le fpôéiateur partagé
entre deux plaifirs, juge fans fatigue du rapport
de ce qu’il voit avec ce qu’il entend.
La fymphonie fimple ne parlant qu’à l’oreille ,
demande une attention plus recueillie , que l’extrême
délicateffe de cet organe ne lui permet pas
de fupporter fi long - temps. Ou l’on attache
un fens à ce qu’on entend , on fuit avec
attention le développement du fujet , les effets
d’harmonie, les modulations, les naances, les
contraires & les retours ; & la laffitude fuivroit
bientôt une trop longue jouiffance : ou l’on
écoute machinalement, on ouvre paffivement
l ’oreille au vain plaifir des fons ; & une longue
fuite de fons , quelque agréables qu’ils foient,
quand ils ne difent rien à l’efprit, n’eft antre chofe
qu’un long ennui.
L'étymologie du mot Chaconne eft affez difficile
à débrouiller. On appelloit anciennement
ciecona en Italie un trait de baffe fondamentale
fur lequel on s’exerçoità compofer, & dont peut-
être quelqu’aveugle {Cieco) étoitl’inventeur. Dans le
dixième volume des ouvrages deTarquinio Merula,
imprimé à Venife en 1635 , on trouve un duo
intitulé duo fopra la c iecona ; voici cette ciecona,
- ou ce trait de baffe contrainte fur lequel tout le duo
eft compofé.
■
I l y a dans le même volume un autre duo &
un air, compofé fur la même baffe & dont le chant
eft entièrement différent.
De ciecona on aura fait par corruption ciacona,'
& pour ne pas répéter toujours le même trait, on
en aura fubftitué à celui-ci, qui étoit le trait o r iginal
, d’autres d’ un chant à-peu près suffi fimple,
d’abord de quatre’, & enfuite de huit mefures. Et
c’eft fur l’un de ces traits, qui avoient retenu le
nom dé ciacona, ou peut-être fur la ciecona elle-
même , qu’on aura fait un air de danfe noble ,
que nous aurons enfuite emprunté des italiens
fous lé nom de chaconne.
Ces traits étoient le plus fouvept en ton mineur ;
les premièrs furent fans dôme diatoniques; on en
fit enfuite de chromatiques , qui donnoient plus de
difficultés à vaincre aux compofiteurs.
.C’étoit, par exemple,
C H A
On conçoit bien comment on parvenoit à traiter
fur un canevas aLiffi fimple quelques traits' (je
fymphonie plus ou moins heureux : créer u n
chant fur une baffe donnée, eft l’A B C de la
conipefition ; mais ce que l’on conçoit moins c’eft
le plaifir qu’on pouvoir trouver à entendre cette
marche de baffe, éternellement uniforme ,fe traîner
fous ces traits de fymphonie. C ’eft l'inconVénient
ordinaire des baffes contraintes ; mais lorfqu’on
juge à propos d’en faire ufage, on évite de leur
donner un mouvement auffi monotone & aufli
trifte, à moins que cette trifteffe même n’ait un
but & ne foit un moyen de peindre ; mais dans
des çhaçonnes prefque toutes deftinées à des fêtes
brillantes , elles dévoient fatiguer l’oreille, affadir
le coetir, & même imprimer à la danfe quelque
chofe de trifte 8c d’ennuyeux comme elles. Ouvrez
les partitions de Lu lli, vous trouverez dans prefque
toutes une chaconne de cette efpèce. Vous y
trouverez quelquefois affez d’art dans la manière
dont le contrepoint .eft écrit, & fur-tout dans les
modulations enchaînées au mode principal ; maïs
vous ne comprendrez jamais comment, dans des
fêtes & dans des triomphes, cette baffe lugubre
pouvoit s’affortir aux idées de magnificence & de
joie que devoit exprimer la danfe.
Rameau affranchit fans retour la çhaçonne de cette
ridicule entrave. Ên lui confervant la régularité
fymmétrique exigée par les pas de la danfe, il lui
donna cependant une marche libre, une expreffion
variée ; il y ménagea de plus grands effets & des
oppofitions nouvelles. Les richeffes de l’orcheftre
s’étant depuis confidérablement accrues , on paroît
encore avoir ajouté après lui à ces oppofitions &
à ces effets ; mais ces additions font plutôt apparentes
que réelles. La chaconne eft reftée à-peu-prés
au point ©ù il l’a laiffée. Q u ’on examine celle de
fes Indes galantes, & quelques autres, on y recon-
noîtra le germe de prefque toutes celles qu’on a
faites depuis.
On n’a pas cru fans doute créer une nouveauté
en nous donnant des chaconnes à deux temps. La
mefure n’y fait rien. Si dans un air à deux temps,
que vous nommez chaconne, vous fuivez le deffein,
vous imitez les effets, vous empruntez les traits de
mélodie ou d’harmonie que j’ai déjà entendus dans
des chaconnes à trois temps , vous n’avez aucun
droit au titre d’inventeur. Rouffeau dit : autrefois il
y avoit des chaconnes à. deux tempis. & à trois y maïs
on n en fait plus quà trois. 11 faut feulement changer
en votre faveur ces derniers mots , & dire , depuis
on n’en faifoit plus qu’à trois ; mais on a repris
l’ufage d’en faire quelquefois à deux temps.
11 eft bon cependant de remarquer que fi l’origine
de la chaconne eft italienne , & fi elle eft née
de ces morceaux entiers que .l’on compofoit fur
ce trait de baffe contrainte nommé la ciecona ,
ce trait étant toujours à trois temps dans les anciennes
compofirions italiennes, Rouffeau s’eft trompé
çn difant qu’on avoit fait autrefois des chaconne
C H A
à deux temps; à moins que par cet j f g f f >1
n’entende pas le premier âge de la chac°nne- -
Une belle chaconne eft d’un grand effet à la fin
d’un opéra. Un maître de ballets g peut déployer
tout U luxe de fon art ; un compofiteur tout le
feu de fon génie. Il nes’agiroit que de fortir un peu
de la routine , & de tâcher de mettre dans la fym-
nhonie & dans les entrées quelques intentions particulières
qui euffent l’attrait de la nouveauté , quell
e s rapports avec l ’aftion qui vient de le palier ,
en un mot quelques intentions locales qui iau-
vaffent le fpe&ateur de l’ennui qu’il éprouve lorl-
mie dans une production qu’on lui donne pour
nouvelle, il ne voit & n’entend rien que ce qu il
croit avoir déjà vu & entendu.
Il ne faut pas non plus regarder comme invention
la licence qu’on a prife dans B I P S
dont l’ouverture étoit d’un effet sûr, de repeter a
la fin cette même ouverture, au lieu d’y placer
une chaconne. Quelque parti qu’un habile maître
de ballet puiffe tirer d’une fymphonie qui n a pas
été faite pour la danfe, il y a toujours une tres-
grande différence entre le caractère d’une ouverture
& celui d’une chaconne.. Dans un art ou regne déjà
beaucoup de confufioh, faire aihfi fervir à double
ufage lés mêmes morceaux de mufique , ce feroit
achever de tout confondre.
Que dire donc de l’emploi que nous avons vu
faire , dans un ballet, du premier final de_ la Fral-
catana? Difons qu’en dépit de, la jufte réputation
du compofiteur, il avoit fait un- bien mauvais
final, ou que ce doit être une bien mauvaife cha-
conne. , ( M, Ginguenc ).
CHAINE DE TRILLES. Les Italiens appellent
catena di trilli une fuite de trilles. N’ayant point
d’expreffion françoife pour défigner cette figure du
chant, j’ai traduit l’italien mot à mot. ( Voyez une
fuite ou chaîne de trilles , plane. de muß. , figure 53• )
( M. de Cafiilhon. )
CH A L IL , c’eft ainfi que les Hébreux appel-
loient leur flûte, qui probablement n’étoit qu’une
éfpèce de chalumeau ; d’autres entendentpar
chalil uij tambour, & c’étoit celui qu’ ils prétendent
qu’on frappoit avec l’Abub. (M. de Cafiilhon).
CHANSON. Efpèce de petit poëme lyrique fort
court, qui roule ordinairement fur des fujets agréables
, auquel on ajouté un air pour être chanté dans
des occafions familières , comme à table , avec fes
amis, avec fa maîtreffe , & même feul, pour éloigner,
quelques inftans, l’ennui fi l’on eft riche ; &
pour fupporter plus doucement la mifère & le travail
, fi l’on eft pauvre.
L’ufage des chanfons femble être une fuite naturelle
de celui de là parole, & n’eft en effet pas
moins général ; car par - tout où l’on parle . on
chante. 11 n’a fallu, pour.les imaginer , que déc
H A
ployer'fes organes , donner un tour agréable aux
idées dont on aimoit à s’occuper, & fortifier par
l’expreffion dont la voix eft capable le fentiment
qu’on vouloit rendre, ou l’image qu’on vouloit
peindre. Auffi les anciens n’avoient-ils point encore
l’art d’écrire qu’ils avoient déjà des chanfons.
Leurs loix & leurs hiftoires, les louanges des dieux
& des héros, furent chantées avant d’être écrites.
Et delà vient, félon Ariftote , que le même nom
grec fut donné aux loix & aux chanfons.
Toute là poéfie lyrique n’étoit proprement que
des chanfons'. mais je dois me borner ici a parler de
celle qui portoit plus particulièrement ce nom ,l
& qui en avoit mieux le caractère félon nos
id^es.
(Commençons par les airs de table. Dans les premiers
tems, dit M. de la Nauze , tous les convives ,
au rapport de Dicéarque , de Plutarque & d Ane-
mon , chantoient enfemble, & d’une feule - voix ,
lés louanges delà divinité. Ainfi ces chanfons etoient
de véritables péans ou cantiques facrés. Les dieux
; n’étoient point pour eux dés trouble-fêtes ; & ils
ne dedaignoient pas de les admettre dans leurs
. plaifirs.
Dans la fuite les convives chantoient fuccef-
; fivement , chacun à fan tour , tenant une branché
de myrthe g qui paffoit de la main de celui qui
' venoit de chanter , à celui qui chantoit après lui.
Enfin quand la mufique fs perfeâionna dans la
Grèce , & qu1on employa la lyre dans les feftins ,
il n’y eut plus , difent les auteurs déjà cités, que les
i habiles gens qui fuffent en état de chanter à table ,
du moins en s’accompagnant de la lyre. Les autres,
contraints de s’en tenir à la branche de myrthe,
donnèrent „lieu à un proverbe grec , par lequel on
difoit qu’un homme chantoit au-myrthe , quand on
vouloit le taxer d’ignorance.5.
Ces chanfons accompagnées de la lyre , & dont
Terpandre fut l’inventeur, s’appellent feolies ,-inot
qui fignifie oblique ©u tortueux , pour marquer,
lelon Plutarque , la difficulté de la chanfon ; ou ,
comme le veut Artémon, la fituation irrégulière de
ceux qui chantoient : car comme il falloit être habile
pour chanter ainfi , chacun ne chantoit pas à
fon rang , mais feulement ceux qui favoient la mufique
, lefquels fe trouvoient difperfés çà & là , &
placés obliquement l’un par rapport à l’autre.
Les fujets des -feolies fe tiroient non-feulement
de l’amopr & du vin, ou du plaifir en général,
comme aujourd’hui ; mais encore de l’hiftoire , de
la guerre, & même de la morale. Telle eft la chanfon
d’Ariftote fur la mort d’Hermias fon ami & fon
allié, laquelle fit accufer fon auteur d’impiété.
» O vertu , qui, malgré les difficultés que vous
m préfentez aux fo'.bles mortels , êtes l’objet char-
» mant de leurs recherches ! Vertu pure & aima-
I jj ble ! ce fut toujours aux Grecs un deftin digne
>j fl’envie de mourir pour vous, & de fouffrir avec
, n confiance les maux les plus (l) Panurge. affreux. Telles font