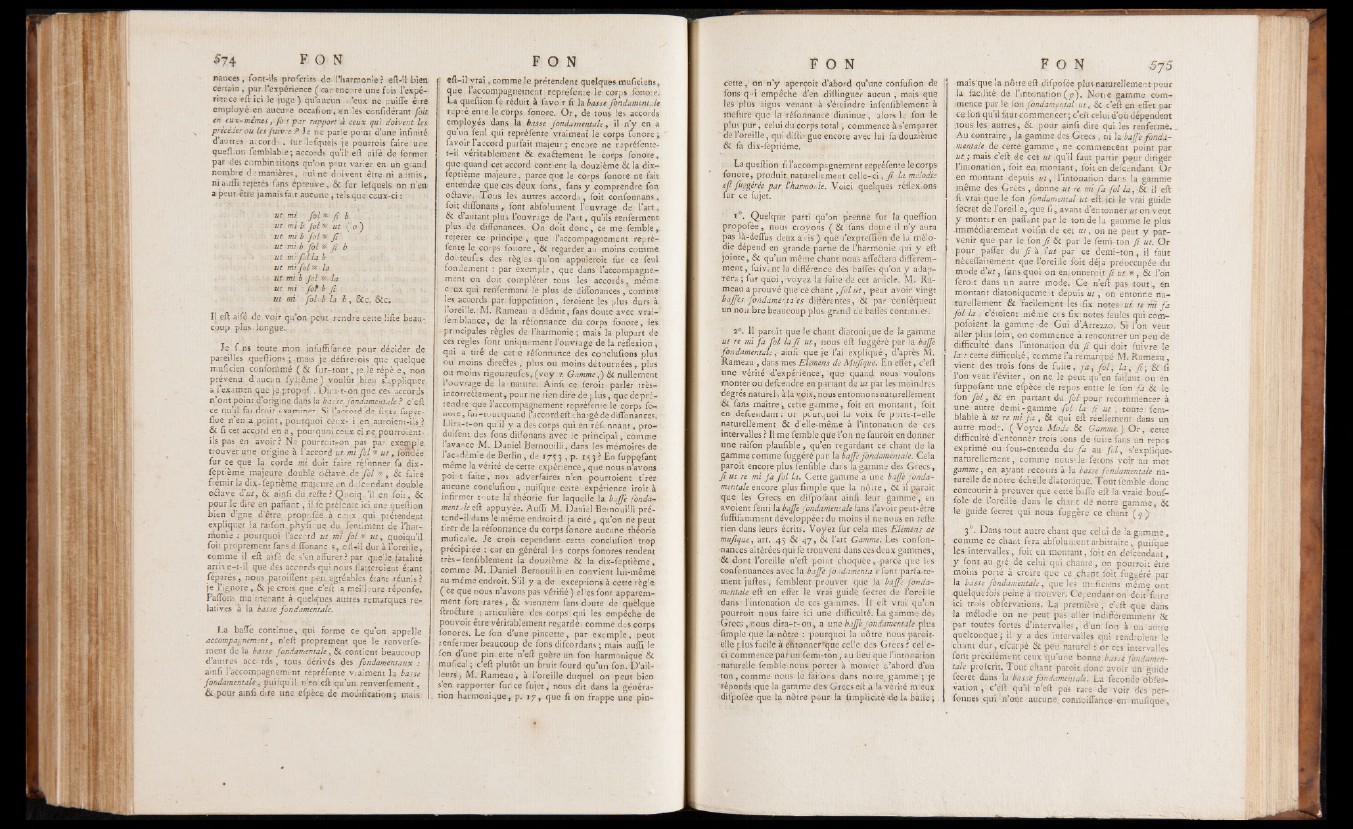
Rances, font-ils proscrits deiWiarmonie ? efWLbien
certain , par l’expérience ( car. encore une fois l'expérience
eft ici le juge ) qu’aucun o’eux ne puiffe être
employé en aucune occafion, «n ies confidérant foit
en eux-mêmes, f in par rapport à ceux qui doivent les
précéder ou les fuivre? Je ne parle point d’une infinité
dautres accords, <ur lefquels je pourrois faire'une
quefiion femblabie; accords qu’il* eft ailé de former
par des combinailons qu’on peut varier en un grand
nombre de manières, qui ne doivent'être ni admis,
ni aufti rejetés fafis épreuve, & fur lefquels on n'en
a peut-être jamais fait aucune ; tels que ceux-ci :
ut mi f i l * f i b
ut mi b: f i l * ut (:o )
ut mi b fo l * f i
ut mi b fo l * f i b
ut .-mi f i l la b
ut mi fo l * la
ùt. mi. b f i l *• la
ut mi fit b fi :
ut mi fol b la b , &c. &c.. ...
Il eft aife de. voir qu’on peut rendre cette lifte beaucoup
plus longue.
Je f.ns toute rùon infuffi farce pour décider de
pareilles queftions mais je défirerois que quelque
muficien confommé (& fur-tout, je. lé répè.e, non
prévenu d'aucun fyfiême) voulût biep slappliqner-
àjexamen que jtg,propef . Dira-1-on que ces accords,
n’ont point d’origine dans la basse fondamentale ? c’eft
ce qu’il faudro.it examiner» Si l’accord de\ fixta;. ftiper-
ftue n’en a point, pourquoi cepx-.i en auroient-iis_?
& fi cet accord en a , pourquoi ceux, ci r.e pourroient-
ils pas en avoir? Ne pourrpit-on pas par exemple,
trouver une origine à l’accord ut mi fol * ut , fondée
fur ce que la corde mi doit faire réfonner fà dix-
feptième majeure double o&ave, de fol * , & faire
frémir la dix-feptième majeure en defeendant double
oélave d\ut, & ainfi du refte? Quoiqu’il en foit, &
pour le dite en paffant, il fe préfente ici une quefiion
bien drgne d’être propcfée.à ceux qui prétendent
expliquer la raifonvphyfi;;ue du fentiment de l’har-
ifionie : pourquoi l’accord ut mi f o l * ut, quoiqu’il
foit proprement fans d.ffonanc s, eit-.il dur à loreiile,
comme il eft aifé de s’en aflùrer ? par quelle fatalité
arrive-t-il que des accords qui nous flatteroient étant
féparés, nous paroiffent peu, agréables étant réunis?
je l’ignore je crois que c’eft ;a meilleure réponfe.
Paffons maintenant à.quelques autres remarques relatives
à la basse fondamentale.
La baffe continue, qui forme ce qu’on appelle
accompagnement, n’eft proprement que le renverfe-
ment de la basse fondamentale, & contient beaucoup
d’autres acc rds, tous dérivés des fondamentaux :
ainfi l’accompagnement repréfente vraiment la basse
fondamentale, puisqu'il n’en eft qu’un, renverfement,
& pour ainfi dire une efpèce de modification ; mais.
çft-il vrai, comme le prétendent quelques muficiefis,
| qué. 1 accompagnement ; repréfeme le corps fonore.
; La quefiion fè réduit à fayoir fi la basse fondamentale
j çqpre énre le corps fonore. O r , de tous les accords
| employés dans la basse fondamentale, il n’y en a
j qu un feul qui repréfente vraiment le corps fonore ;;
: fa voir l’accord parfait majeur; encore ne rapréfente-
t-il véritablement & exaéfement le corps fonore,
! -.que,quand cet accord contient la douzième & la dix-
feptième majeure, parde que le corps fonore ne fait
entendre que ces deux fons, fans y comprendre fon
! o&ave. «Tous les autres . accords , foit confonnans,
foit diffonans , font abfolument l’cuvrage de l’art,
& d’autant plus l’ouvrage de l’art, qu’ils renferment
plus de diffonances. On doit donc, ce me femble,
' rejeter ce principe ,' que l’accompagnement repré-
| fente le corps fonore, & regarder au moins comme
douteufes des règles qu’on appuieroit fur ce feul
; fondement : par exemple, que dans l'accompagne-,
! ment on doit compléter tous les accords, meme
| e ux qui renfermant le plus de diffonances, comme
i les accords par fuppofition, feroient les plus durs à
l’oreille. M. Rameau a déduit; fans doute avec vrai-
| femblanoe, de la réfonnance du corps fonore, les
principales règles de l’harmonie; mais la plupart de
: ces règles font uniquement l’ouvrage de la réflexion ,
qui a tire de eete réfonnance des çoncîüfîons plus
; ou moins direâes, plus ou moins détournées, plus
ou moins rigoureufes, (voy:z Gamme f) & nullement
\ l’ouvrage dè la nature. Ainfi ce feroit parler très-
incorreéiement, pour ne rien dire de plus, que de prétendre
que l’accompagnement repréfente le corps fo-.
nore, fur-tout quand Raccord eft chargé de diffonances. •
Dira-t-on qu il y a des corps qui en réfonnànt, pro-
duifent. des fons diffonans avec je principal, comme
1 avance M.. Daniel Bernouilli, dans les mémoires de
1 academie de Berlin , de 175 3 » P* 153? En fuppofant
meme la vérité de cette expérience, que nous.n’avons
por t faite, nos adverfaires n’en pourroient tirer
aucune conclufion , puifque cette expérience iroit à
infirmer toute la" théorie fur laquelle la baffe fonda-*
mentale eft appuyée. Aufli M. Daniel Bernouilli pré-
tentMl dans le même endroit déjà cité, qu’on ne peut
tirer de la réfonnance du corps fonore aucune théorie
muficale. Je crois cependant cette conclufion trop
précipitée : car en général les corps fonores rendent
très-fenfiblement la douzième & la dix-feptième,
comme M. Daniel Bernouilli en convient lui-même,
au meme endroit. S il. y a de. exceptions à cette règ’e
( ce que nous n’avons pas vérifié ) elles font apparemment
fort rares, & viennent fans doute de quelque
ftruéfure \ articulière des corps qui les empêche de
pouvoir être véritablement regardé-; comme des corps
fonores. Le fon d’une pincette, par exemple, peut
renfermer beaucoup de fons difeordans ; mais aufli le
fon d’une pincette n’eft guère un fon harmonique &
mufical ; c’eft plutôt un bruit fourd qu’un fon. D’ailleurs,
M. Rameau, à l’oreille duquel on peut bien-
s en. rapporter fut-ce fujet* nous dit dans la généra-
I. tion harmonique, p. 1 7 , que fi on frappe une pincette,
on n’y aperçoit d’abord qu’une confufion de
fons qci empêche d’en diftinguer aucun , mais que
les plus aigus venant à s’éteindre infenfiblement à
mefure que la1 réfonnance diminue, alors le fon le
plus pur, celui du corps total, commence à s’emparer
de l’oreille, qui dtftii gue encore avec lui fa douzième
& fa dix-feptième.
La queftion fi l’accompagnement repréfente le corps
fonore, produit, naturellement celle-ci, fi: f i mélodpe
efl fuggérée par l'harmonie. Voiçi quelques réflexions
fur ce fujet.
i°. Quelque parti qu’on prehne fur la queftion
propofée, nous croyons ( & fans doute il n’y aura
pas la-deffus deux avis ) que l’exprefiion de la mélodie
dépend en grande-partie de l’harmonie qui y eft
jointe, & qu’un même chant nous affrétera différemment,
fuivarit la différence dés baffes qu’on y adaptera
; fur quoi, voyez la fuite de cet article. M. Rameau
a prouvé que ce chant , fôl ut, peut avoir vingt
baffes, fondamenta'es différentes, & par'tenféquent
un nombre beaucoup plus grand cle baflès continues;
2°. Il paroît que le chant diatonique de la gamme
ut re mi fa fo l la f i ut, nous eft fuggéré par la baffe
fondamentale, ainfi que je l’ai expliqué , d’après M.
Rameau, dans mes Elèmens de Mufique. En effet, c’eft
une vérité d’expérience , que quand nous voulons
•monter ou defceiidre en partant d eut par les moindres
'degrés naturels à la vpix, nous entonnons naturellement
& fans maître v cette gamme, foit en montant, foit
en defeendant: or pourquoi la voix fe porte-t-elle
naturellement & d’elle-même à l’intonation de ces
intervalles ? Il me femble que l’on ne fauroit en donner
une raifon plaufible , qu’en regardant ce chant de la
gamme comme fuggéré par la baffe fondamentale. Cela
paroît encore plus fenfible dans la gamme des -Grecs,
f i ut re mi fa fo l la. Cette gamme a une baffe fondamentale
encore plus fimple que la nôtre, & il paroît
que les Grecs en difpofant ainfi leur gamme, en
«voient fenti la baffe fondamentale fans l’avoir peut-être
fuffifamment développée : du moins il ne nous en refte
rien dans leurs écrits. Voyez fur cela mes Elémens de
mufique, art. .45 & 47, & l’art Gamme. Les confon-
nances altérées qui fe trouvent dans ces deux gammes,
& dont l’oreille n’eft point choquée, parce que les
confonnances avec la baffe fondamenta 'e font parfaitement
juftes , femblent 'prouver que Ja baffe fondamentale
eft en effet le vrai guidé fécret de l’orei-ile
dans l’intonation de ces gammes. Il eft vrai' qu’on
pourroit nous faire ici une difficulté. La gamme dès
Grecs, nous dira-t-on, a une baffe fondamentale plus
fimple que la-nôtre : pourquoi la nôtre nous paroît-
elle plus facile à eltonner'qué celle des Grecs ? cel e-
ci commence par un femi-ton , au lieu que l’intonation
•naturelle femble nous porter à monter d’abord d’un
•ton, comme nous lé faifons dans no.ret gamme ; je
réponds que la gamme des Grecs eft à la vérité m eux
difpofée que la nôtre pour la firoplicité de la ballè ; .
mais'que îa nôtre eft: difpofée plus naturellement pour
la facilité de l’intonation (/?). Noue gamme commence
par le fon fondamental u t & c’eft en effet par
ce fon qu’il faut commencer ; c’eft celui d’où dépendent
.tous,les autres, & pour ainfi dire qui les renferme..
Au contraire, la gamme des Grecs, ni Ja baffe fondamentale
de cette gamme, ne- commencent point par
ut i mais c eft de cet ut -qu’il faut partir pour diriger
l’intonation, foit en,montant, foit..en defeendant. Or
en montant depuis vt , \ l ’intonation dars la gamme
même des Grecs , donne ,ut re mi fa f i l f i , ‘6£ il eft
fi vrai que le fon fondamental ut eft ici le vrai guidt
fecret de l’oreil e, que fi, avant d’entonner ut on veut
y monter en paffant par le tonde la gamme le plus
immédiatement voifin de cet ut, on ne peut y parvenir
que par le fon f i ’& .par le femi-ton f i ut. Or
pour paffer du f i à l"ut par ce demi-ton, il faut
néeeffairemèn.t que l'oreille foit déjà préoccupée du
mode d’u t, fans quoi on emonneroit^ ut * , & l’on
féroit dans un autre mode. Ce n’eft pas tout., en
montant diatoniquement depuis u t on entonne naturellement
& facilement les ffix notes ut re mi fa
f i l la ; c’étoient même ces fix- notes feules qui com-
pofoient la gamme-de Gui d’Arrezzo. Si l’on veut
aller plus loin , on commence à rencontrer un peu dé
difficulté dans l’intonation dû f i qui doit fuivre le
la.: cette difficulté, comme l’a remarqué M. Rameau,
vient des trois fons de fuite, fa., fo l, la, fi-, & fi
l’on veut l’éviter, on ne le peut qu’en faifant ou en
fuppofant une efpèce de repos entre le fon fa & le
fon fo l, & en partant du fol pour recommencer à
une autre demi-gamme fo l la- f i ut , toute: femblabie
à ut re mi-fa, & qui eft réellement dans un
autre mode. ( Voyez Mode & Gamme. ) O r , cette
difficulté d’entonner trois ions de fuite fans un repes
exprimé ou fous-entendu du fa ^ au f i l , s’explique*
naturellement, comme nous-le ferons voir au mot
gamme, en ayant recours à la basse fondamentale naturelle
de notre échèlle diatonique. Tout femble donc
concourir à prouver que cette baffe eft la. vraie bouf-
fole de l’oreille dans le chant dé notre gamme, &
le guide fecret qui nous fuggère ce chant ( q )
30. Dans tout autre chant que celui de la gamme ,
comme ce chant fera abfolument arbitraire, puifque
les intervalles, foit en montant, foit en defeendant,
y font au gré de celui, qui chante , on pbürroit être
moins porté à croire que ce chant foit fuggéré par
la basse fondamentale, que les muiiciens même ont
quelquefois peine à trouver. Cependant on doit’ faire
ici trois obfervations. La première, c’eft que dans
la mélodie on ne peut pas aller indifféremment &
par toutes fortes d’intervalles, d’un fon à un autre
quelconque ; il y a des intervalles qui rendroient le
•chant dur, eftarpé & peu naturel : or ces intervalles
font précifémtnt ceux qu’une bonne bassé fondamentale
proferit. Tout chant paroît donc avoir un guide'
fecret dans la basse fondarhentale. La fécondé ôbfer-
vation , c’e'ft qu’il n’eft pas rare de voir des personnes
q u i;n’ont aucune, connoiffance en mufique,