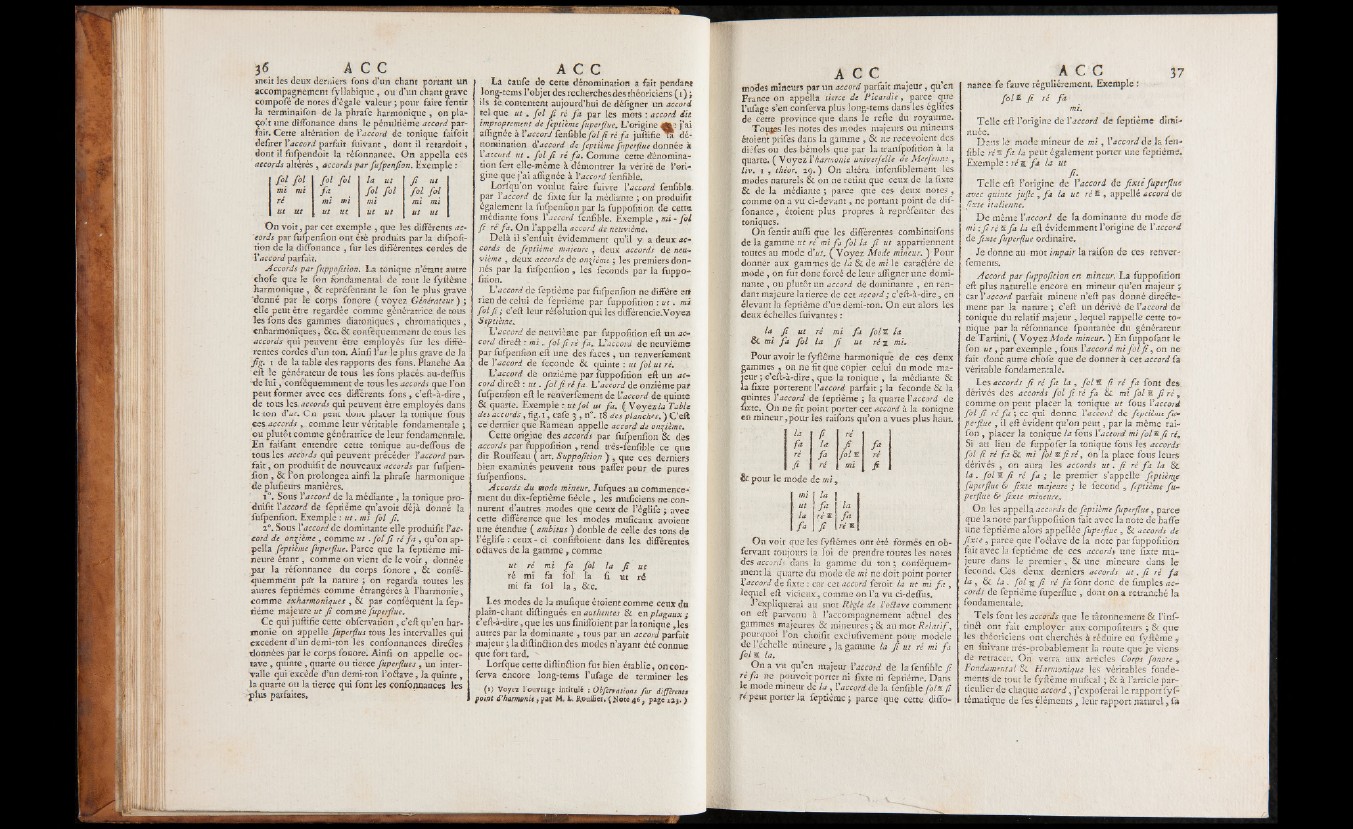
3<S A C C
meit les deux derniers fons d’un chant portant un
accompagnement fyllabique , ou d’un chant grave
compofé de notes d’égale valeur ; pour faire lentir
la terminaifon de la phrafe harmonique , on pla-
Ço't une diffonance dans le pénultième accord parfait.
Cette altération de Yaccord de tonique faifoit
defirer Yaccord parfait fuivant, dont il retardoit,
dont il fufpendoit la rêfonnance. On appella ces
accords altérés , accords par fûfpenfion. Exemple :
fo l fol fo l fo l la ut J! ut
mi mi f* . fo l fo l fa t fol
ré mi mi mi mi mi
ut ut ut ut ut ut ut ut
O n voit,par cet exemple , que les différents accords
par fûfpenfion ont été produits par la difpofi-
tion de la diffonance , fur les différentes cordes de
Y accord parfait.
Accords par fuppofition. La tonique n’étant autre
chofe que le fon fondamental de tout le fyftême
harmonique , & repréfentant le fon le plus grave
‘donné par le corps fonore (v o y e z Générateur) ;
elle peut être regardée comme génératrice de tous
les ions des gammes diatoniques , chromatiques ,
enharmoniques, &c. & eonfêquemment de tous les
accords qui peuvent être employés fur les différentes
cordes d’un ton. Ainfii’i# le plus grave de la
fig. i de la table des rapports dès fons. Planche Aa
eft le générateur de tous les fons placés au-deffus
xle lu i , eonfêquemment de tous les accords que l’on
peut former avec ces différents fons , c’eft-à-dire,
de tous les accords qui peuvent être employés dans
le ton à'ut. C n peut donc placer la tonique fous
e e saccords comme leur véritable fondamentale \
©u plutôt comme génératrice de leur fondamentale.
En faifant entendre cette tonique au-deffous de
tous les accords qui peuvent précéder Y accord parfait
, on produifit de nouveaux accords par fufpen-
fion , & ron prolongea ainfi la phrafe harmonique
de plufieurs manières.
‘ i° . Sous Y accord de la médiante , la tonique produifit
Y accord de foptiéme qu’a voit déjà donné la
fûfpenfion. Exemple : ut. mi fo l fi.
2°. Sous Y accord de dominante elle produifit Y accord
de onzième , comme u t . f o l f i ré fa , qu’on appella
feptième fuperfiue. Parce que la feptième mineure
étant, comme on vient de le voir , donnée
par la rêfonnance du corps fonore, & confé-
quemment pafr la nature ; on regarda toutes les
autres feptièmes comme étrangères à l’harmonie,
comme exharmoniques , & par conféquent la feptième
majeure ut f i comme fuperfiue.
Ce qui juftifie cette obfervation , c’efl qu’en harmonie
on appelle fiuperfius tous les intervalles qui
excédent d’un demi-ton les confonnances direâes
données par le corps fonore. Ainfi on appelle octave
, quinte , qnarte ou tierce fuperfiues , un intervalle
qui excède d’un demi-ton Poélave, la quinte,.
la quarte ou la tierce qui font les confonnances les
plus parfaites,
a c c
La caufe de cette dénomination a fait pendant
long-tems l’objet des recherchesdes théoriciens ( i ) ;
ils fe contentent aujourd’hui de défigner un accord
teLque ut . fo l f i ré fa par les mots : accord dit
improprement de feptième fuperfiue. L’origine d te j’ai
aflignêe a Y accord fenfible fo l f i ré fa juftifie ni dénomination
d’accord de feptième fuperfiue donnée à
Y accord u t . fo l f i ré fa . Comme cette dénomination
fert elle-même à démontrer la vérité de l’origine
que j’ai aflignée à Yaccord fenfible.
Lorfqu’on voulut faire fuivre Y accord fenfible.
par Y accord de fixte fur la médiante ; on produifit
également la fûfpenfion par la fuppofition de cette
médiante fous Y accord fenfible. Exemple , mi - fol
f i ré fa . On l’appella accord de neuvième.
Delà il s’enfuit évidemment qu’il y a deux accords
de feptième majeure , deux accords de neuvième
, deux accords de onzième ; les premiers donnés
par la fûfpenfion, les féconds par la fuppofition.
p L ’accord de feptième par fûfpenfion ne diffère ert
rien de celui de feptième par fuppofition vut. mi
f°lfi> c.’eft leur rêfolutionqiu les différencie-Voyez
Septième.
Vaccord de neuvième par fuppofition eft un accord
direâ r mi.. fo l f i ré fa . Ï2laccord de neuvième
par fûfpenfion eft une des faces , un renverfement
de Y accord de fécondé & quinte : ut fo l ut ré. .
L’accord dé onzième par fuppofition eft un accord
direél : u t. fol f i ré fa. h'accord de onzième par
fûfpenfion efl le renverfement de Y accord de quinte
& quarte. Exemple tu t fo l m fa . ( Voyez- la Table
désaccords, fig .i, cafe 3 , n°. 18 des planches. ) C ’efl
ce dernier que Rameau appelle accord de onzième.
Cette origine des accords par fufoenfibn & dès
accords par fuppofition , rend três-fenfible ce que
dit Rouffeau ( art. Suppofition J , que ces derniers
bien examinés peuvent tous paffer pour de pures
fufpenfîons.
Accords du mode mineur. Jufques au commencement
du dix-feptième fiècle , les muficiens ne connurent
d’autres modes que ceux de l’êglife j avee
cette différence que les modes muficaux avoient
une étendue ( ambitus ) double de celle des tons de
Féglife : ceu x -c i confiftoient dans les. différentes
o&aves de. la gamme T comme
ut ré mi fa fo l la f i ut
ré mï fâ loi la fi ut ré
mi fa fol la , &c.
Les modes de la mufique étoient comme ceux du
plain-chant drftingués en authentes & en plagaux ;
c’eft-à-dire, que les uns finiffoientpar la tonique ,les
autres par la dominante , tous par un accord parfait
majeur ; la diftindion. des modes n’ayant été connue
que fort tard. N
Lorfque cette diftindion fut bien établie, on conferva
encore long-tems I’ufage de terminer les
(1) Voyez l'ouvrage intitulé : Obfervatiqns fur différents
point d’harmonit, pat M, L, Rouffici, (Noce46, page vx%. )
A C C 37
modes mineurs par un accord parfait majeur, qu’en
France on appella tierce de Picardie, parce que
l’ufage s’en conferva plus long-tems dans les églifes
de cette province que dans le refte du royaume.
Toujps les notes des modes majeurs ou mineurs
étoient prifes dans la gamme , fk ne recevoient des
dièfes ou des bémols que par la tranfpofition à la
quarte. ( V oyez Y harmonie univer/elle de Mcrfenm ,
liv. 1 , théor. 29.) On altéra infenfiblemeilt les
modes naturels & on ne retint que ceux de la fixte
& de la médiante ; parce que ces deux notes ,
comme on a vu ci-devant, ne portant point de dif-
fonance, étoient plus propres à repréfenter des
toniques.
On fentit auffi que les différentes combinaifons
de la gamme ut ré mi fa fo l la f i ut appartiennent
toutes au mode d'ut. ( Voyez Mode mineur. ) Pour
donner aux gammes de la 8c de mi le caractère de
mode, on fut donc forcé de leur affigner une dominante
, ou plutôt un accord de dominante , en rendant
majeure la tierce de cet accord ; c’efi-à-dire, en
élevant la feptième d’u 2 demi-ton. On eut alors les
deux échelles fuivantes :
la f i ut ré mi fa f o lS la
& mi fa fo l la f i ut ré 2 mi. ■
Pour avoir le fyftême harmonique de ces deux
gammes , on ne fit que copier celui du mode majeur
; c’eft-à-dire, que la tonique , la médiante &
la fixte portèrent Y accord parfait ; la fécondé 8c la
uintes Y accord de feptième ; la qnarte Y accord de
xte. On ne fit point porter cet accord à la tonique
en mineur ,pour les raifons qu’on a vues plus haut.
la fi ré
1 la fi |S
ré f§f fol m. ré fi ré mi fi
«k pour le mode de mi,,
mi | la 1
, ut . fa lu
la I ré 2 f *
f a 1 f i ré s [
On voit que les fyftémes ont été formés en ob-
fervant toujours la loi de prendre toutes les notes
des accords clans la gamme du ton; eonféquem-
ment la quarte du mode de mi ne doit point porter
Xaccord de fixte : car cet accord feroit la ut mi fa ,
lequel eft vicieux, comme on l’a vu ci-deftlis.
J’expliquerai au mot Règle de Coèlave comment
on eft parvenu à l ’accompagnement aduel des
gammes majeures & mineures ; & au mot Relatif,
pourquoi l’on choifit excîufivement pour modèle
de l’échelle mineure , la gamme ta f i ut ré mi fa
fo l 2 la,
j On a vu qu’en majeur Y accord de la fenfible f i
te fa ne pouvoir porter ni fixte ni feptième. Dans
le mode mineur de la , Y accord de la fenfible fols, fi
Tt peut porter la feptième ; parce que cette diftbÀ
C C
nattee fe fauve régulièrement. Exemple :
fo l % f i ré fia
mi.
Telle eft l’origine de Y accord de feptième diminuée.
.
Dans le mode mineur de m i, Y accord de la fenfible
re's fa la peut également porter une feptième.
Exemple : ré g fa la ut
fi-
Telle eft l’origine de Y accord de fixte fuperfiue
avec quinte jufie , fa la ut ré S , appellé accord d&
, fixte italienne.
De même Y accord de la dominante du mode der
mi : f i ré 2 fa la eft évidemment l’origine de Y accord
de fixte fuperfiue ordinaire.
Je donne au mot impair la raifon de ces renver-
fements.
Accord par fuppofition en mineur. La fuppofition
eft plus naturelle encore en mineur qu’en majeur ;
car Y accord parfait mineur n’eft pas donné directement
par la nature ; c’eft un dérivé de Y accord de
tonique du relatif majeur , lequel rappelle cette tonique
par la rêfonnance fpontanée du générateur
de Tartini. ( Voyez Mode mineur. ) En fuppofant le
fon u t , par exemple , fous Y accord mi fo l f i ^ on ne
fait donc autre chofe que de donner à cet accord fa
véritable fondamentale.
Les accords f i ré fa la , fo l S f i ré fa font des.
dérivés des accords fo l f i ré fa & mi fo l s f i ré ,
comme on peut placer la tonique ut fous Y accord
fo l f i ré f a ’, ce qui donne Y accord de feptième fu perfiue
, il eft évident qu’on peut, par la même raifon
, placer la tonique la fous Yaccord mi fo l s f i rèm
Si an lieu de fuppofer la tonique fous les accords
fo l f i ré fa & mi fol S f i ré, on la place fous leurs
dérivés , on aura les accords ut . f i ré fa la &
la . fo l s f i ré fa ; le premier s’appelle feptièrçe
fuperfiue & fixte majeure ; le feconcf, feptième fu perfiue
& fixte mineure„
On les appella accords de feptième fuperfiue, parce
que la note par fuppofition fait avec la note de baffe
une feptième alors appellee fuperfiue , 8c accords de
fix te , parce que l’o&ave de la note par fuppofition
fait avec la feptième de ces accordi une fixte majeure
dans le premier, & une mineure dans le
fécond. Ces deux derniers accords u t . f i ré fa
la , & la . fo l g f i ré fa font donc de fimples accords
de feptième fuperfiue , dont on a retranché la
fondamentale.
Tels font les accords que le tâtonnement & l’inf-
tinéf ont fait employer aux compofiteurs ; 8c que
les théoriciens ont cherchés à réduire ep fyftême ?
en fuivant très-probablement la route que je viens
de retracer. On verra aux articles Corps fonore ,
Fondamental & Harmonique les véritables fondements
de tout le fyftême mnfical ; & à l’article particulier
de chaque accord, j’expoferai le rapport fyf-
tématique de. fes éléments x leur rapport naturel > fe