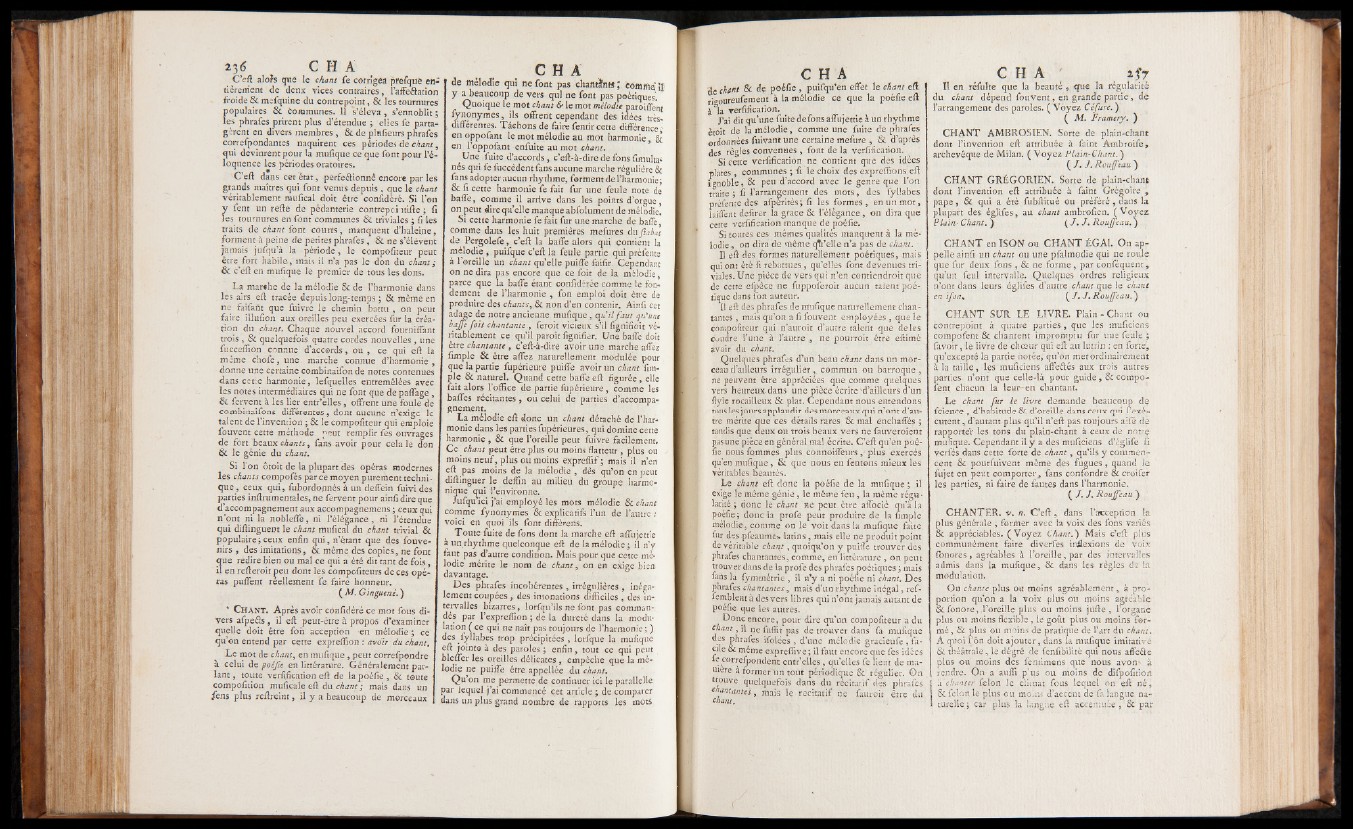
1 3 6 C H À
C ’eft alofs que le chant fe corrigea prefquè entièrement
de deux vices contraires, raffeâation
froide & mefquine du contrepoint, & les tournures
populaires & Communes. 11 s’é le v a , s’ennoblit ;
les phrafes prirent plus d’étendue ; elles fe partagèrent
en divers membres , & de plnfieurs phrafes
correfpondanteS naquirent ces périodes de chant
qui devinrent pour la mufique ce que font pour l’éloquence
les périodes oratoires.
C ’eft dans cet état, perfe&ionné encore par les
grands maîtres qui font venus depuis | que le chant
véritablement mufical doit être confidéré. Si l’on
y fent un relie de pédanterie contrepci itifte ; fi
les tournures en font communes & triviales ; fi les
traits de chant font courts, manquent d’haleine,
forment à peine de petites phrafes, & ne s’élèvent
jamais jufqu’à la période, le compofiteur peut
être fort habile., mais il n’a pas le don du chant ;
& c’éft en mufique le premier de tous les dons.
La marche de la mélodie & de l’harmonie dans
les airs eft tracée depuis long-temps ; & même en
ne faifafit que fuivre le chemin battu , on peut
faire illufion aux oreilles peu exercées fur la création
du chant. Chaque nouvel accord fourniffant
trois j & quelquefois quatre cordes nouvelles, une
fucceffion connue d’accords, ou , ce qui eft la
même chofe, une marche connue d’harmonie ,
donne une certaine combinaifon de notes contenues
dans cette harmonie, lefquelles entremêlées avec !
les notes intermédiaires qui ne font que de paflage,
& fervent à les lier entr’elles, offrent une foule de
combinaifons différentes, dont aucune n’exige le
talent de l’invention ; & le compofiteur qui emploie
fouvent cette méthode peut remplir fes ouvrages
de fort beaux chants, fans avoir pour cela le don
& le génie du chant.
Si Ion ôtoit de la plupart des opéras modernes
les chants compofés par ce moyen purement technique
, ceux qui, fubordonnés à un deffein fuivi des
parties inflrumentales, ne fervent pour ainfi dire que
d’accompagnement aux accompagnemens ; ceux qui
n’ont ni la nobleffe, ni l’élégance, ni l’étendue
qui diftinguent le chant mufical du chant trivial &
populaire;ceux enfin qui, n’étant que des foüve-
nirs , des imitations, & même des copies, ne font
que redire bien ou mal ce qui a été dit tant de fois,
il en refteroit peu dont les compofiteurs de ces opéras
puffent réellement fe faire honneur.
( M. Ginguené. )
* C h ant. Après avoir cdnfidéré ce mot fous divers
a fp eâ s , il eft peut-être à propos d’examiner
quelle doit être fon acception en mélodie ; ce
qu’on entend par cette exprefîion : avoir du chant.
Le mot de chant, en mufique, peut correfpendre
à celui de poéfie en littérature. Généralement parlant
, toute vérification eft de la poéfie, & toute
compofition muficale eft du chant ; mais dans un
/ens plus reftreint, il y a beaucoup de morceaux
C H A
de mélodie qui ne font pas chanttntf ; Comme iî
y a beaucoup de vers qui ne font pas poétiques.
Quoique le mot chant & le mot mélodie paroiffenf
fynonymes, ils offrent cependant des idées très-
i differentes. Tâchons de faire fentir cette différence '
en oppofant le mot mélodie au mot harmonie, &
en l’oppofant enfuite au mot chant.
Une fuite d’accords, c’eft-à-dire de fons fimulta*
nés qui fe fuccèdent fans aucune marche régulière &
fans adopter aucun rhythme, formentde l’harmonie ;
& fi cette harmonie fe fait fur une feule note de
baffe, comme il arrive dans les points d’orgue,
on peut dire qu’elle manque abfolument de mélodie.
Si cette harmonie fe fait fur une marche de baffe,
comme dans les huit premières mefures du Jlabat
de Pergolefe, c’eft la baffe alors qui contient la
mélodie , puifque c’eft la feule partie qui préfente
à l’oreille un chant qu’elle puiffe faiftr. Cependant
on ne dira pas encore que ce foit de la mélodie,
parce que la baffe étant confédérée comme le fondement
de l’harmonie , fon emploi doit être de
produire des chants,,& non d’en contenir. Ainfi cet
adage de notre ancienne mufique , qu'ilfaut qu'une
baffe foit chantante , feroit vicieux s’il fignifioit véritablement
ce qu’il paroît fignifier. Une baffe doit
être chantante , c’eft-à-dire avoir une marche affez
ftmple & être affez naturellement modulée pour
que la partie fupérieure puiffe avoir un chant fim-
ple & naturel. Quand cette baffe eft figurée, elle
fait alors l’office de partie fupérieure, comme les
baffes récitantes, ou celui de parties d’accompagnement.
La mélodie eft donc un chant détaché de l’harmonie
dans les parties fupérieures, qui domine cette
harmonie , & que l’oreille peut fuivre facilement.
Ce chant peut être plus ou moins flatteur, plus ou
moins neuf, plus ou moins expreffif ; mais il n’en
eft pas moins de la mélodie , dès qu’on en peut
diftinguer le deffin au milieu du groupe harmonique
qui l’environné.
Jufqu ici j’ai employé les mots mélodie & chant
comme fynonymes & explicatifs l’un de l’autre ;
voici en quoi ils font différens.
Toute fuite de fons dont la marche eft affujettie
a un rhythme quelconque eft de la mélodie ; il n’y
faut pas d’autre condition. Mais pour que cette, mélodie
mérite le nom de. chant, on en exige bien
davantage.
Des phrafes incohérentes , irrégulières , inégalement
coupées, des intonations difficiles, des intervalles
bizarres, lorfqu’ils ne font pas commandés
par l’expreffion ; de la dureté dans la modulation
( ce qui ne naît pas toujours de l’harmonie; )
des fyllabes trop précipitées , lorfque la mufique
eft jointe à des paroles ; enfin, tout ce qui peut
bleffer les oreilles délicates , empêche que la mélodie
ne puiffe être appellée du chant.
Q u’on me permette de continuer ici le parallelle
par lequel j’ai commencé cet article ; de comparer
dans un plus grand nombre de rapports les mots
C H A
de chant 8c d ç poéfie , puifqu’en effet le c h a n t eft
rigoureufement à la mélodie ce que la poéfie eft
à la verfification.
J’ai dit qu’une fuite defonsaffujettie à un rhythme
ètôit de la mélodie , comme une fuite de phrafes
ordonnées fuivant une certaine mefure , & d’après
des règles convenues , font de la verfification.
Si cettë verfification ne contient que des idées
plates , communes ; fi le choix des expreffions eft
ignoble, & peu d’accord avec le genre que l ’on
traite ; fi l’arrangement des mots, des fyllabes
préfe nte des afperités; fi les formes, en un mot,
laiffent defirer la gface & l’élégance , on dira que
cette verfification manque de poéfie.
Si toutes ces- mêmes qualités manquent à la mélodie
, on dira de même ^ti’elle n’a pas de chant.
Il eft des formes naturellement poétiques, mais
qui ont été fi rebattues, qu’elles font devenues triviales.
Une pièce de vers qui n’en contiendroit que
de cette efpèce ne fuppoferoit aucun talent poétique
dans ion auteur.
Il eft des phrafes de mufique naturellement chantantes
, mais qu’on a fi fouvent employées, que le
compofiteur qui n’auroit d’autre talent que de les
coudre f inie à l’autre , ne pourroit être eftimé
avoir du chant.
Quelques phrafes d’un beau chant dans un morceau
d’ailleurs irrégulier , commun ou barroque ,
ne peuvent être appréciées que comme quelques
vers heureux dans une pièce écrite'd’ailleurs d’un
flyle rocailleux & plat. Cependant nous entendons
tous les jours applaudir des morceaux qui n’ont d’autre.
mérite que ces détails rares & mal enchaffés ;
tandis que deux ou trois beaux vêts ne fauveroient
pas une pièce en général mal écrite. C ’eft qu’en poéfie
nous femmes plus connoifleurs, plus exercés
qu’en mufique, & que nous en fentons mieux les
véritables beautés.
Le chant eft donc la poéfie de la mufique ; il
exige le même génie, le même fe u , la même régu •
larité,; donc le chant ne peut-être aflbcié qu’à la
poéfie ; donc la profe peut produire de la fimple
mélodie , comme on le voit dans la mufique faite
fur des pfeaumeî, latins, mais elle ne produit point
de véritable chant, quoiqu’on y puiffe trouver des
phrafes chantantes, comme, en littérature , on peut
trouver dans de la profe des phrafes poétiques ; mais
fafts la fymmétrie , il n’y a ni poéfie ni chant. Des
phrafes chantantes, mais d’un rhythme inégal, ref-
iemblent à des vers libres qui n’ont jamais autant de
poéfie que les autres.
Donc encore, pour dire qu’un compofiteur a du
chant, il ne fuffit pas de trouver dans fa mufique
,®s phrafes ifolées , d’une mélodie gracieufe , facile
& même expreffive; il finit encore que fes idées
le correfpondent entr’elles, qu’elles fe lient de maniéré
à former un tout périodique & régulier. On
trouve quelquefois dans du récitatif des phrafes
chantantes, mais le récitatif ne fauroit être du
chant.
C H A i?7
Il en réfulte que la beauté , que la régularité
du chant dépend fouvent, en grande partie, de
l’arrangement des paroles. ( Voyez Céfure. )
( M. Framery. )
CHANT AMBROSIEN. Sorte de plain-chant
dont l’invention eft attribuée à faint Ambroife*
archevêque de Milan. (V o y e z Flain-Chant. )
( J. J . Roujfeau )
CHAN T GRÉGORIEN. Sorte de plain-chant
dont l’invention eft attribuée à faint Grégoire ,
pape, & qui a été fubftitué ou préféré, dans la
plupart des églifes, au chant ambrofien. (V o y e z
Plain* Chant. ) ( / . / . Roujfeau. )
CH AN T en ÏSON ou CHANT ÉGAL On appelle
ainfi un chant ou une pfalmodie qui ne roiye
que fur deux fons , & ne forme , par conféquent,
qu’un feul intervalle. Quelques ordres religieux
n’ont dans leurs églifes d’autre chant que le chant
en i f on, ( J . J , Roujf’.au. )
CHAN T SUR LE LIVRE. Plain - Chant ou
contrepoint à quatre parties, que les muficiens
compofent & chantent impromptu fur une feule ;
fa voir ,1e livre de choeur qui eft au lutrin : en forte,
qu’excepté la partie notée, qu’on met ordinairement
à la taille, les muficiens affedés aux trois autres
parties n’ont que celle-là pour guide, & compofent
chacun la leur-en chantant.
Le chant fur le livre demande beaucoup de
fcience, d’habitude & d’oreille dans ceux qui l’exécutent
, d’autant plus qu’il n’eft pas toujours aile de
rapporter les tons du plain-chant à ceux de notre
mufique. Cependant il y a des muficiens d’églife fi
verfés dans cette forte de chant, qu’ils y commencent
& pourfuivent même des fugues, quand le
fujet en peut comporter^ fans confondre & croifer
les parties, ni faire de fautes dans l’harmonie.
( J. J. Roujfeau )
CHANTER, v. n. C ’e f t , dans l'acception la
plus générale , former avec la voix des fons variés
& appréciables. (V o y e z Chant.) Mais c’eft plus
communément faire diVerfes inflexions de voix
fonores , agréables à l’oreille, par des intervalles
admis dans la mufique, & dans les règles de la
modulation.
On chante plus ou moins agréablement, à proportion
qu’on a la voix plus ou moins agréable
& fonore,,l’oreille plus ou moins jufte , l’organe
plus ou moins flexible, le goût plus ou moins formé,
& plus ou moins de pratique de l’art du chant.
A quoi l’ôn doit ajouter, dans la mufique imitative
& théâtrale, le dégré de fenfibilité qui nous affeéie
pins ou moins des femimens que nous avom à
rendre. On a auffi p’us ou moins de difpofition
à chanter félon le climat fous lequel on eft né,
& félon le plus ou moins d’accent de fa langue naturelle
; car plus la langue eft accentuée , & par