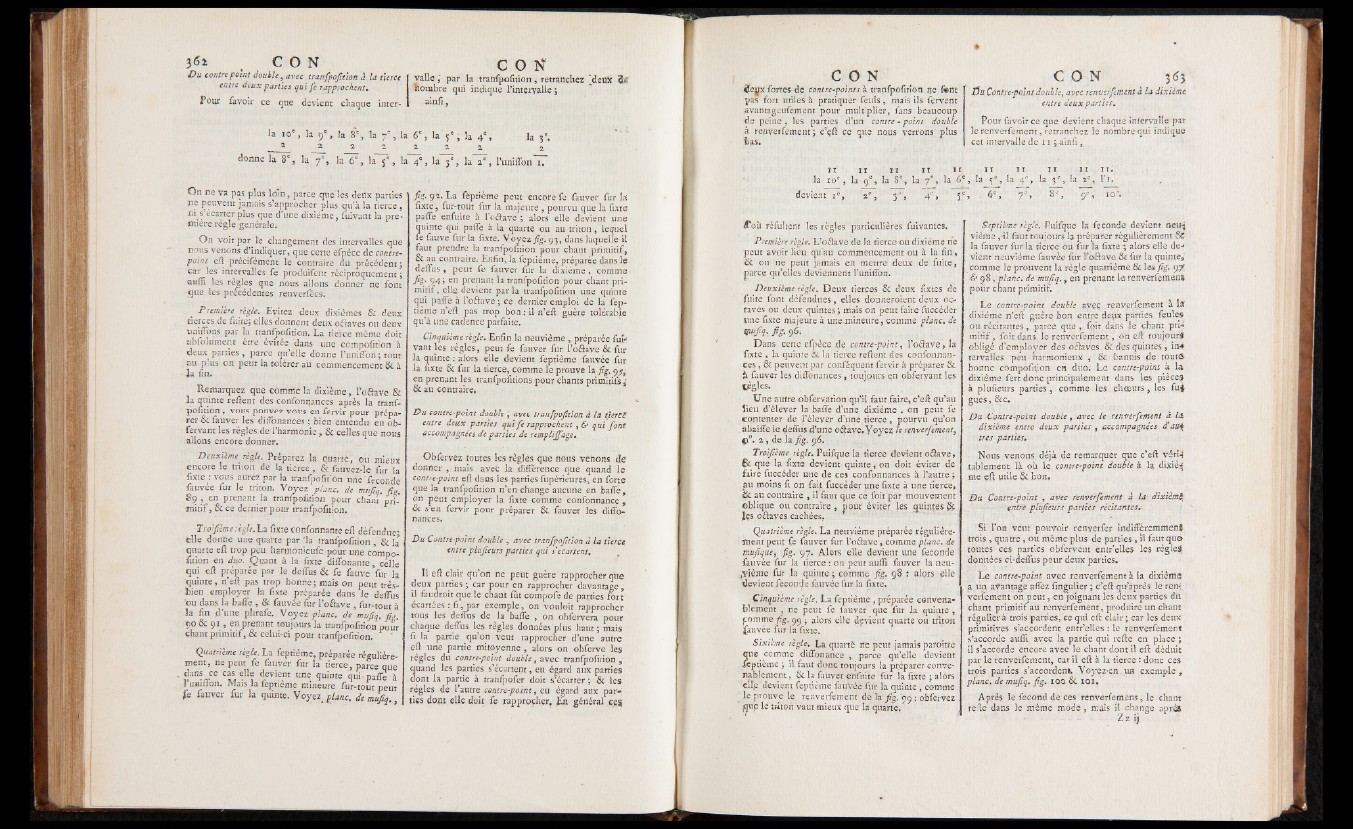
36* C O N
D u contre point double, avec tranfpojltion à la tierce
entre deux parties qui fe rapprochent.
Pour lavoir ce que devient chaque interla
1 0 ', la t>e , Ja 8*\ la 7 ' , la
__a_ u a 2
donne la 8% la ~ / , la” ? , la~ 7', la
On ne va pas plus loin, parce que les deux parties
he peuvent jamais s’approcher plus qu’à la tierce ,
ni s’écarter plus que d’une dixième, fuivant la pie- -
- tnière règle generale.
On voit par le changement des intervalles que
- nous venons d’indiquer, que cette efpèce de contrepoint
eft precifément le contraire du précédent ;
car les intervalles fe produifent réciproquement ;
aufü les règles que nous allons donner ne font
que les précédentes renverfées.
Première règle. Evitez deux dixièmes & deux
tierces^de fuite; elles donnent deux oéiaves ou deux
unifions par la tranfpofition. La tierce même doit
abfolument etre evitee dans une compolition à
deux parties , parce qu’elle donne l’unifTon ; tout
au plus on peut la tolérer au commencement & à
■ la fin.
Remarquez que comme la dixième, l’oflave &
la quinte relient des confonqances après la tranf-
pofitiôn , vous pouvez vous en fervir peur préparer
& fauver les diffonances ; bien entendu en ob-
fervant les règles, de l’harmonie, & celles que nous
allons encore donner.
Deuxieme règle. Préparez la quarte, ou mieux
encore le triton de la tierce , & fauvez-le fur la
fntte : vous aurez par la tranfpoftt'on une fécondé
fauvée fur le triton. Voyez plane, de mufiq. fia.
89 , en prenant la tranlpofition pour chant prim
itif, & ce dernier pour tranfpofition.
T roi filme règle. La fixfe confirmante eft défendue;
elle donne une quarte par ‘la tranfpofition , & la
qnarte eft trop peu barmonieufe pour une compo-
fition en duo. Quant à la frxte diffonante, celle
qui eft préparée par le deflus & fe fauve fur la
quinte, n’eft pas trop bonne ; mais on peut très-
bien employer la fixte préparée dans le deflus
ou dans la baffe , & fauvee fur l’oâave , fur-tout à
la fin d ’une pbrafe. Voyez plane, de mufiq. f ia ..
50 & 9 1 , en prenant toujours la tranfpofition pour
chant primitif, & celui-ci pour tranfpofition. r ' i
Quatrième règle. La feptième, préparée régulièrement,
ne peut fe fauver fur la tierce, parce que
. dans ce cas elle devient une quinte qui paffe à
l’uniffon. Mais la feptième mineure fur-tout peut
fe fauver fur la quinte. Voyez, plane, de mufiq. ,
c o isr
Val l epar la tranfpofition, retranchez ’deujf
nombre qui indique l’intervalle j
ainfi,
6e , la 5e i la 4% fe 3';
JL 2 2
4e > la 3% la 2e j l’uniflon i .
fi?- 92. La feptième peut encore fe fauver fur lai
fixte, fur-tout fur la majeure , pourvu que 1a fixte
pafie enfuite à l ’câave ; alors elle devient une
quinte qui pafie à la quarte ou au triton , lequel
fe fauve fur la fixte. Voyez fig. 93, dans laquelle il
faut prendre la tranfpofition pour chant primitif,
& au contraire. Enfin, la feptième, préparée dans le
deflus, peut fe fauver fur fe dixième, comme
fié ; 94 j en prenant la tranfpofltion pour chant primitif,
elfe devient par la tranfpofition une quinte
qui pafle à l’oâave 3 ce dernier emploi de la feptième
n’efl pas trop bon : il n’efl: guère tolérable
qu’à une cadence parfaite.
Cinquième règle. Enfin la neuvième , préparée fut»
vant les règles, peut fe fauver fur l’oâave & fur
la quinte : alors elle devient feptième fauvée fur
la fixte & fur la tierce, comme le prouve 1a fig, ç f j
en prenant les tranfpofitions pour chants primitifs {
& au contraire.
Du contre-point double,' avec tranfpofition a la tiercé
entre deux parties qui fe rapprochent, & qui font
accompagnées de parties de remplijfage.
Obfervez toutes les règles que nous venons de
donner , maïs avec fe différence que quand le
contre-point eft dans les parties fupérieures, en forte
que 1a tranfpofition n’en change aucune en baffe,
on peut employer 1a fixte comme confonnance,
& s’en fervir pour préparer 8c fauver les difîo-
nances.
Du Contre-point double , avec tranfpofition à la tierce
entre plufieurs parties qui s'écartent.
Il eft clair qu’on ne peut guère rapprocher que
deux parties; car pour en rapprocher davantage,'
il faudroit que le chant fût compofé de parties fort
écartées : fi ,p a r exemple, on vouloit rapprocher
tous les deflus de la baffe , on obfervera pour
chaque deflus les règles données plus haut ; mais
fl la partie qu’on veut rapprocher d’une autre
eft une partie mitoyenne, alors on obferve les
règles du contre-point double, avec tranfpofition ,
quand les parties s’écartent, eu égard aux parties
dont la partie à tranfpofer doit s’écarter ; & les
règles de l ’autre contre-point, eu égard aux par-'
tfes dont elle doit fe rapprocher. En général ce$
c o N
Üeyx fortes de contre-points à tranfpofition ne font
pas fort utiles à pratiquer feuls, mais ils fervent
^vantageufement pour multiplier, fans beaucoup
de peine , les parties d’un contre - point double
à renverfement ; c’çft ce que nous verrons plus
fes.
11 11 11 i i 11
la 10e , la 9e , la 8e, la: 7*-, la 6*
devient 1% 2% 3% 4% 5 e:
C O N 363
ifiii Contre-point double, avec renverfement à la dixième
entre deux parties.
Pour favoir ce que devient chaque intervalle par
le renverfement, retranchez le nombre qui indique
cet intervalle de 11 ; -ainfi,
11 11 11 i i i r .
, .la 5®, la 4e, la 3e, la 2% l ’ r,
, - 4e, 7% §% 9e 10*.
d’où réfui tent les règles particulières fui vantes.
Première règle. L’oâave de la tierce ou dixième ne
peut avoir lieu qu'au commencement ou à la fin,
8c on ne peut jamais en mettre deux de fuite ,
parce qu’elles deviennent l’uniflbn.
Deuxième règle. Deux tierces & deux fixtes de
fuite font défendues, elles donneroient deux octaves
ou deux quintes; mais on peut faire fuccéder
une fixte majeure à une-jnineure, comme plane, de
fis • 96-
Dans cette efpèce de contre-point, l’o â a v e , 1a
fixte , la quinte 5c la tierce reftent des confonnan-
ce s , & peuvent par conféquent fervir à préparer &
& fauver les diffonances, toujours en çbferyant les
f^ègles.
Une autre obferv.ation qu’il faut faire, c’eft qu’au
lieu d’élever la bafle d’une dixième , on peut fe
contenter de Félever d’une tierce, pourvu qu’on
abaiffe le deffiis .d’une oâ av e.Yo yez le renverfement,
Çt°. 2 , de la fig. 96.
Troifième règle, Puifque la tierce devient oâave,
& que 1a fixte devient quinte , on doit éviter de
faire fuccéder une de ce* confonnances à l’autre ;
au moins fi on fai| fuccéder une fixte à une tierce,
8c au contraire , il faut que ce foit par mouvement
oblique ou contraire , pour éviter les quintes §ç
jfes oâaves cachées. "
Quatrième règle, La neuvième préparée régulièrement
peut fe fauver fur Foâave, comme plane, de
mufiqiie, fig, 97. Alors elle devient une fécondé
fauvée fur la tierce : 011 peut aufli fauver 1a neuvième
fiir fe quinte ; comme fig- 98 : alprs elle
devient fécondé fauvée fur la fixte.
Cinquième règle. La feptième, préparée convenablement
, ne peut fe fauver que.fur 1a quinte ,
pomme fig. 99 ; alors elle devient quarte ou triton
fauvée fur la fixte.
Sixième règle, La quarté n*e peut jamais paroîtse
que comme diflonance , parce qu’elle devient
feptième ; il faut donc toujours la préparer convenablement
, & la fauver enfuite fur la fixte ; alors
eilp'devient feptième fauvée fur la quinte; comme
le prouve le renverfement de 1a fig. '99 J obfervez
flue lé triton vaut mieux que la quarte.
Septième règle,. Puifque la fécondé devient neuj
vième ,'il faut toujours fe préparer régulièrement 8C
la fauver fur-1a tierce où fur la fixte ; alors elle de-»
vient neuvième fauvée fur l’oâave 8c fur la quinte,'
comme le prouvent 1a règle quatrième & les fig. 97!
& 9 8 plane, de mufiq, , en prenant le renverfement
pour chant primitif.
Le contre-point double avçç. renverfement à lâ'
dixième n’eft guère bon entre deyx parties feules
ou récitantes, parce que , f$it dans le chant pri-*
mitif, foit dans le renverfement, on eft toujours
obligé d’employer des oâaves & des quintes , in*
tervalfes peu harmonieux , 8c bannis de touta
bonne compofifion en duo. Le contrepoint à la
dixième fert donc principalement dans les pièces
à plufieurs parties , comme . les choeurs, les fu i
gués, &c.
Du Contre-point double, avec le renverfement à là
dixième entre deux parties , accompagnées fi aU\
très parties.
Nous venons déjà de remarquer que c’eft vêrM
tablement là où le contre-point double à la dixiè^
me çft utile 8c bon.
Du Çontre-point , avec renverfement à la dixième,
entre plufieurs parties récitantes
Si Ton veut pouvoir renvetfer indifféremment
trois, quatre, ou même plus de parties , il faut qu6
toutes ces parties obfefvent entr’elles les règles
données ci-deffùs pour deux parties*
Le contrepoint avec renverfement à la dixième
a un avantage aflez fingulier ; c’eft qir’àprès le r en*
verfement on peut, en joignant lès deux parties du
chant primitif au renverfement, produire un chant
régulier à trois parties, ce qui eft clair ; car les deux
primitives s’accordent entr’elles : le renverfement
s’accorde aufli avec la partie qui refte en place ;
il s’accorde encore avec le chant dont il eft déduit
par le renverfement, car il eft à la tierce : donc ces
trois parties s’accordent. Voyez-en. un exemple,
plane, de mufiq* fig, IOQ & 101*
Après le fécond de ces renverfemens, le chant
refte dans le même mode, mais il change après
Z z ij