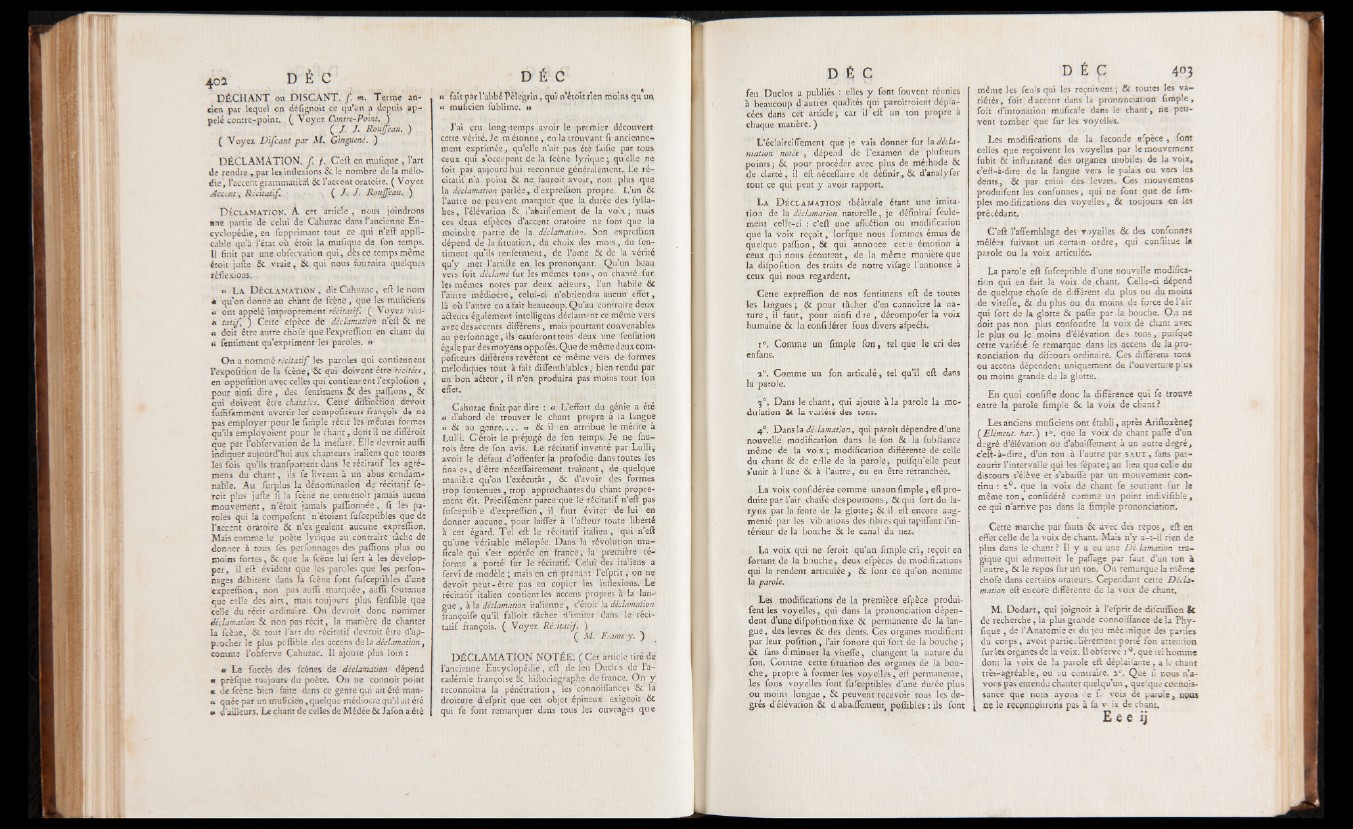
DÉCHANT ou DISCAN T f m. Terme ancien
par lequel on défignoit ce qu’ôn a depuis appelé
contre-point. (V o y e z Contre-Point. )
S O . Roujjcau. )
( Voyez Difcant par M. G'uiguené. )
DÉCLAMATION, f . f . C’eft en mufique , l’art
de rendre , par les inflexions & le nombre de la mélodie
\ l’accent grammatibâl & l’accent oratoire. ( Voyez
Accent, Récitatif. ( A A RouJJeau. )
D éclamation. A cet article , nous joindrons
«ne partie de celui de Cahuzac dans l’ancienne Encyclopédie,
en fupprimant tout ce .qui 'n’eft applicable
qu’à l’état où étoit la mufique de fon temps.
Il finit par une obfervation qui, dès ce temps même
étoit jufte & vraie, 6c qui nous fournira quelques
réflexions.
ce L a D éclamation , dit Cahuzac, eft le nom
je qu’on donne au chant de fcène , que les-muficiens
« ont appelé improprement récitatif. •( Voyez réci-
a tattfl ) Cette efpèce de déclamation n’eft ôc' ne
a doit être autre chofe que Fexpreflion en chant du
m fentiment qu’expriment les paroles. »
On a nommé récitatif les paroles qui contiennent
l ’expofition de la fcène, & qui doivent être récitées,
en oppofition avec celles qui contiennent l’explofion ,
pour ainfi dire , des fentimens ÔC des pallions,, &
qui doivent être chantées. Gètte1 diftin&i’ôn dëvoit
fuffifamment avertir les' compofiteurs françors de ne
pas employer pour le fimple récit lés mèmès formes
qu’ils employoient pour le chant, dont il ne différoit
que par l’obfervation de la mêfiire. Elle devroit auffi
indiquer aujourd’hui aux chanteurs italiens que toutes
les fois qu’ils tranfporterit dans le récitatif les agré-
mens du chant, ils le livrent à un abus .condamnable.
Au furplus la dénomination de' récitatif fe-
roit plus jufte fi la fcène ne contenoit jamais aucun
mouvement, n’étoit jamais paflïonnée, fi les paroles
qui la compofent n etoient fufceptibles que de
l’accent oratoire ôc n’exigeaient aucune expreflion.
Mais comme le poète lyrique au contraire tâche de
donner à tous fes perfonnages des pallions plus ou
moins fortes, & que la fcène lui fert à les développer,
il eft évident que les paroles que’ les perfonnages
débitent dans la fcène font fufceptibles d’une
expreflion, non pas aufli marquée, aüfli foutenue
que celle des airs, mais toujours plus fenfible que
celle du récit ordinaire. On devroit donc nommer
déclamation & non pas récit, la manière de chanter
la fcène, & tout l’art du récitatif devroit être d’approcher
le plus pcflible des accens delà déclamation,
comme l’obferve Cahuzac. Il ajoute plus loin :
« Le fuccès des fcènes de déclamation dépend
« prèfque toujours du poète. On ne connoit point
« de fcène bien faite dans ce genre qui ait été man-
u quée par un muficien, quelque médiocre qu’il ait été
u d’ailleurs. Le chant de celles de Médée Ôc Jafon a été
« fait par l’abbé Pélegrin, qui n’étoit rien moins qu un
« muficien fublime. »
J’ai cru long-temps avoir le premier découvert
cette vérité. Je m étonne, en la trouvant fi anciennement
exprimée, qu’elle n’ait pas été fai fie par tous
ceux qui s’occupent de la fcène lyrique ; qu elle ne
foit pas aujourd hui reconnue généralement. Le récitatif
n’a point Ôc ne, fauroit ayoir, non plus que
la déclamation parlée, d’expreflion propre. L ’un ôc
l’autre ne peuvent marquer que la durée des fylla-
bes, l’élévation ôc l’abailïement de la voix; mais
ces deux efpèces d’accent oratoire ne font que la
moindre partie de la déclamation. Son expreflion
dépend de la fituation, du choix des mois, du fentiment
qu’ils renferment, de l’ame Ôc de la vérité
qu’y met l’artifte en les prononçant. Qu’un beau
vers foit déclamé fur les mêmes tons, ou chanté fur
les mêmes notes par deux aéleurs, l’un habile ôc
l’autre médiocre, celui-ci n’obtiendra aucun effet,
là où l’autre en a fait beaucoup. Qu au contraire deux
a&eurs également intelligens déclament ce même vers
avec des accents différens, mais pourtant convenables
au perforinâge, ils cauferonttous deux une fenfation
égale par des moyens oppofés. Que de même deux compofiteurs
différens revêtent ce même vers de formes
mélodiques tout à fait diffemblablesbien rendu par
ùn bon aâeur, il n’en produira pas moins tout fon
effet.
Cahuzac finit par dire : « L’effott du génie a été
« d’abord de trouver le chant propre à la langue
« & au genre.. . . » & il en attribue le mérite à
Lulli. Cetoit le préjugé de fon temps;, Je ne fau-
rois être de fon avis. Le récitatif inventé par Lulli,
avoit le défaut d’offenfer la profodie dans toutes les
fina’es, d'être néceffairement traînant, de quelque
manière qu’on l’exécutât, ôc d’avo.ir des formes
trop foutenues , trop approchantes du chant proprement
dit. Précifément parce que lé récitatif n’èft pas
fufceptib’e d’expreflion , il faut éviter de lui en
donner aucune, pour laiffer à l’aéleiir toute liberté
à cet égard. Tel eft le récitatif italien, qui n eft
qu’une véritable mélopée. Dans la révolution mu—
ficale qui s’est opérée en france, la première réforme
a porté fur le récitatif. Celui des .italiens- a
fervi de modèle ; mais en en prenant l’efpnt, on ne
devoit peut-être pas en copier les inflexions. Le
récitatif italien contient les accens propres à- la lan-1
gue , à la déclamânon italienne, c’étoit la déclamation
françoife qu’il falloit tâcher d’imiter dans le-récitatif
françois. ( Voyez Récitatif. )
( M . Frame-y. )
DÉ CLAMATION NOTÉE: ( Cet article tiré de
l’ancienne Encyclopédie, eft, de feu Quclcs de l’académie
françoise ÔC hiftoriographe de france. On y
reconnoîtra la pénétration, les connoiffances ÔC la
droiture d’efprit que cet objet épineux exigéoit ôc
qui fe font remarquer dans tous les ouvrages que
feu Duclos a publiés : elles y font fou vent réunies
à beaucoup d autres qualités qui paroîtroient déplacées
dans cet article; car i f eft un ton propre à
chaque matière.)
L ’éclaircifTement que je vais donner fur \& déclamation
notée , dépend de l ’examen de plufieurs
points; ôc pour procéder avec plus de méthode ôc
de clarté, il eft néceffaire de définir, & d’analyfer
tout ce qui peut y avoir rapport.
L a D é c l am a j io n théâtrale étant une imitation
de la déclamation naturelle, je définirai feule- ■
ment celle-ci : c’eft une affeétion ou modification -
que la voix reçoit, lorfque nous fomrnes émus de
quelque paftion, Ôc qui annonce cette émotion a
ceux qui nous écoutent, de la même manière que
la difpofition des traits de notre vifage l’annonce à
ceux qui nous regardent.
Cette expreflion de nos fentimens eft de toutes
les langues ; $c pour tâcher d’en connoître la nature
, il faut, pour ainfi dire , décompofer la voix
humaine ôc la conftdérer fous divers afpeéls.
i °. Comme un fimple fon, tel que le cri des
enfans.
2°. Comme un fon articulé, tel qu’il eft dans
la parole.
3°. Dans léchant, qui ajoute à la parole la modulation
& la variété des tons.
4°. Dans la déclamation, qui paroît dépendre d’une
nouvelle, modification dans le fon ôc la fubflance
même de la voix ; modification différente de celle
du chant Ôc de celle de la parole, puifqu’elle peut
s’unir à l’une Ôc à l’autre, ou en être retranchée.
La voix confidérée comme un son fimple, eft produite
par l’air chaffé des poumons, ôtqui fort du larynx
par la fente de la glotte; Ôc il eft.encore augmenté
par les vibrations des fibres qui tapiffent l’intérieur
de la bouche ôc le canal du nez.
La voix qui ne feroit qu’un fimple cri, reçoit en
fortant de la bouche, deux-efpèces de modifications
qui la rendent articulée , ôc font ce qu’on nomme
la parole.
Les modifications de la première efpèce produi-
fent les voyelles, qui dans la prononciation dépendent
d’une difpofition fixe ôc permanente de la langue
, des levres Ôc des dents. Ces organes modifient
par leur pofition, l’air fonore qui fort de la bouche ;
& fans diminuer la vîteffe, changent la nature du
fon. Comme cette fituation des organes de la bouche,
propre à former les voyelles, eft permanente,
les fons voyelles font fufceptibles d’une durée plus
ou moins longue, ôc peuvent recevoir tous les degrés
d'élévation ÔC daba»ffement4 poftibles : Us font
même les feuls qui les reçoivent ; Ôc toutes les variétés,
foit d accent dans la prononciation fimple,
foit d’intonation muficale dans le chant, ne peuvent
tomber que fur les voyelles.
Les modifications de la fécondé efpèce , font
celles que reçoivent les voyelles par le mouvement
fubit ÔC inftaritané des organes mobiles de la voix,
c’eft-à-dire de la langue vers le palais ou vers les
dents, ôc par celui des levres. Ces mouvemens
produifent les confonnes, qui ne font que de Amples
modifications des voyelles, ôc toujours en les
précédant.
C ’eft l’affemblage des voyelles ôc des confonnes
mêlées fuivant un certain ordre, qui conftitue la
parole ou la voix articulée.
La parole eft fufceptibîe d’une nouvelle modification
qui en fait la voix de chant. Celle-ci dépend
de quelque chofe de différent du plus ou du moins
de vîteffe, ôc du plus ou du moins de force de l’air
qui fort de la glotte ôc paffe par la bouche. O a ne
doit pas non plus confondre la voix de chant avec
le plus ou le moins d’élévation des tons, puifque
cette variété fe remarque dans les accens de la prononciation
du difeours ordinaire. Ces différens tons
ou accens dépendent uniquement de l’ouverture plus
ou moins grande de la glotte.
En quoi confifte donc la différence qui fe trouve
entre la parole fimple ôc. la voix de chant ?
Les anciens muficiens ont établi, après Ariftoxène-f
(Elément, har.) 1°. que la voix de chant paffe d’un
degré d’élévation ou d’abaiffement à un autre degré,
c’eft-à-dire, d’un ton à l’autre par sa u t , fans parcourir
l’intervalle qui les fépare ; au lieu que celle du
discours s’élève et s’abaiffe par un mouvement continu
: 2°. que la voix de chant fe soutient fur le
même ton, confidéré comme un point indivifible,
ce qui n’anive pas dans la fimple prononciation.
Cette marche par fauts ôc avec des repos, eft en
effet celle de la voix de chant. Mais n’y a-t-il rien de
plus dans le chant ? Il y a eu une Dé. lamation tragique
qui admettoit le paffage par faut d’un ton à
l’autre, Ôc le repos fur un ton. On remarque la même
chofe dans certains orateurs. Cependant cette Déclamation
eft encore différente de la voix de chant.
M. Dodart, qui joignoit à i’efpritde difcuflïon le
de recherche, la plus grande connoiffance de la Phy-
fique , de l’Anatomie et du jeu mécanique des parties
du corps, avoit particulièrement porté fon attention
fur les organes de la voix. Il obferve 1 que tel homme
dont la voix de la parole eft déplaçante, a le chant
très-agréable, ou au contraire. a.°. Que il cous n’a-
vor.s pas entendu chanter quelqu’un, que que coitnois-
sance que nous ayons de fo voix de parole a nous
ae le reconnoiirons pas à fa v ix de chant.
E e e ij