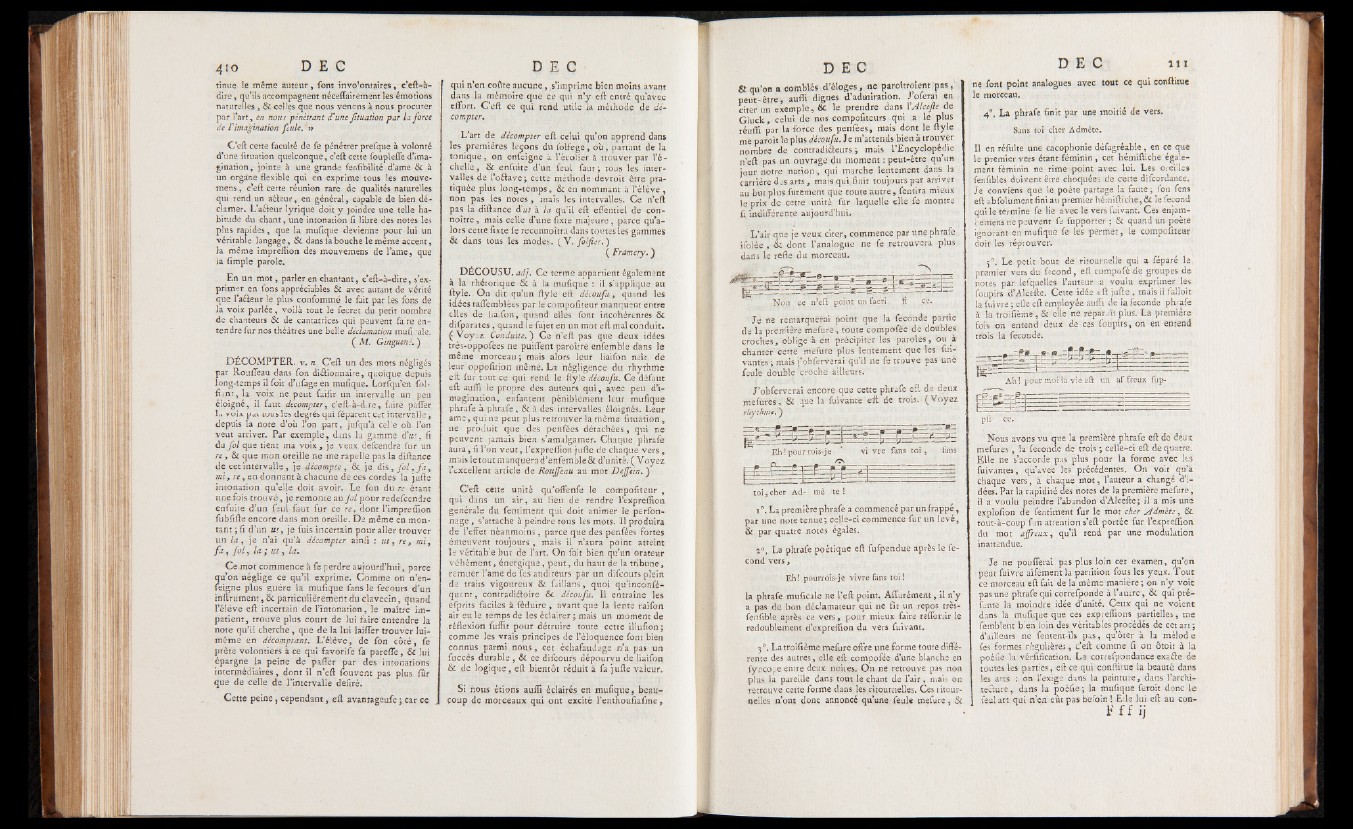
tinue le même auteur, font invo’ontaires, c’eft-à-
dire, qu’ils accompagnent néceffairement les émotions
naturelles, & celles que nous venons à nous procurer
par l’art, en nous pénétrant d'une fituation par la force
de Vimagination feule. »
G’eft cette faculté de fe pénétrer prefque à volonté
d’une fituation quelconque, c’eft cette foupleffe d’imagination,
jointe à une grande fenfibilité d’ame & à
un orgine flexible qui en exprime tous les mouve-
mens, c’eft cette réunion rare de qualités naturelles
qui rend un aéleur, en général, capable de bien déclamer.
L’aéfeur lyrique doit y joindre une telle habitude
clu chant, une intonation fi libre des notes les
plus rapides, que la mufique devienne pour lui un
véritable langage, & dans fa bouche le même accent,
la même impreflion des mouvemens de lame, que
la fimple parole.
En un mot, parler en chantant, ceft-à-dire, s’exprimer
en fons appréciables & avec autant de vérité
que l’aéieur le plus confommé le fait par les fons de
la voix parlée, voilà tout le fecret du petit nombre
de chanteurs & de cantatrices qui peuvent far e entendre
fur nos théâtres une belle déclamation muficale.
( M. Ginguené. )
DÉCOMPTER, v. n C ’eft un des mots négligés 1
par Rotiffeau dans fon dictionnaire, quoique depuis
long-temps il foit d’ufage en mulique. Lor(qu’en fol-
fiant, la voix ne peut faifir un intervalle un peu
éloigné, il faut décompter, c’e ft-à-dlre, faire palier
la voix par tous les degrés qui féparent cet intervalle,
depuis la note d’où l’on part, jufqu’à celle où l’on
veut arriver. Par exemple, dans la gamme à'ut, fi
du fo l que tient ma voix , je veux defcendre fur un
re , & que mon oreille ne me rapelle pas la diftance
de cet intervalle , je décompte, & je dis, fo l , fa ,
miy re, en donnant à chacune de ces cordes la jufte
intonation qu’elle doit avoir. Le fon du re étant
une fois trouvé, je remonte au Jol pour redefcendre
enfuite d’un feul faut fur ce re, dont l’impreflion
fubfifte encore dans mon oreille. De même en montant
; fi d’un ut, je fuis incertain pour aller trouver
un la , je n’ai qu’à décompter ainfi : u t, re, mi,
f a , f o l , la ; u t , la.
Ce.mot commence à fe perdre aujourd’hui, parce
qu’on néglige ce qu’il exprime. Comme on n’en-
feigne plus guère la mufique fans le fecours d’un
inftrument, & particulièrement du clavecin, quand
Félève eft incertain de l’intonation, le maître impatient,
trouve plus court de lui faire entendre la
note qu’il cherche , que de la lui laiffer trouver lui-
même en décomptant. L’élève, de fon côté, fe
prête volontiers à ce qui favorife fa pareffe, & lui
épargne la peine de paffer par des intonations
intermédiaires, dont il n’eft fouvent pas plus fûr
que de celle de l’intervalle déliré.
Cette peine, cependant, eft avantageufe ; car ce J
qui n’en coûte aucune, s’imprime bien moins avant
dans la mémoire que ce qui n’y eft entré qu’avec
effort; C ’eft ce qui rend utile la méthode de dé*
compter•
L'art de décompter eft celui qu’on apprend dans
les premières leçons du folfege, où , partant de la
tonique, on enfeigne à l’écolier à trouver par l’é chelle,
& enfuite d’un feul faut; tous les intervalles
de l’oétave; cette méthode devroit être pratiquée
plus long-temps, & en nommant à l’élève ,
non pas les notes, mais les intervalles. Ce n’eft
pas la diftance d'ut à la qu’il eft effentiel de con-
noître, mais celle d’une fixté majeure , parce qu’a-
lors cette fixte fe reconnoîtra dans toutes les gammes
& dans tous les modes. ( V . folfier. )
( Framery. )
DÉCOUSU, adj. Ce terme appartient également
à la rhétorique & à la mufique : il s'applique au
ftyle. On dit qu’un ftyle eft découfu, quand les
idées raffemblées par le compofiteur manquent entre
elles de liaifon, quand elles font incohérentes &
difparates , quand le fujet en un mot eft mal conduit.
£ Voyez Conduite. ) Ce n’eft; pas que deux idées
très-oppofées ne puiffent paroître enfemble dans le
même morceau ; mais alors leur liaifon naîtx de
leur oppofition même. La négligence du rhythme
eft fur tout ce qui rend le ftyle découfu. Ce défaut
eft aufïi le propre des auteurs q ui, avec peu d’imagination,
enfantent péniblement leur mufique
phrafe à phrafe, & à des intervalles éloignés. Leur
ame, qui ne peut plus retrouver la même fituation,
ne produit que des penfées détachées, qui ne
peuvent jamais bien s’amalgamer. Chaque phrafe
aura, fi l’on veut, l’exprefïion jufte de chaque vers ,
mais le tout manquera d’enfemble & d’unité. (V o y e z
l’excellent article de Roujfeau au mot Dejfcin.')
C ’eft cette unité qu’offenfe le compofiteur ,
qui dans un air, au lieu de rendre l ’expreffion
générale du fentiment qui doit animer le perfon-
nage , s’attache à peindre tous les mots. Il produira
de l’effet néanmoins, parce que des penfées fortes
émeuvent toujours , mais il n’aura point atteint
le véritable but de l’art. On fait bien qu’un orateur
véhément, énergique, peut, du haut de la tribune,
remuer l’ame de fes auditeurs par un difeours plein
de traits vigoureux & faillans, quoi qu'inconfé-
quent, contradiéloire & découfu. Il entraîne les
efprits faciles à féduire , avant que la lente raifon
ait eu le temps de les éclairer ; mais un moment de
.réflexion fuffit pour détruire toute cette illufion;
comme les vrais principes de l’éloquence font bien
connus parmi nous, cet échafaudage n’a pas un
fuccès durable, & ce difeours dépourvu de liaifon
& de logique, eft bientôt réduit à fa jufte valeur.
Si nous étions aufli éclairés en mufique, beaucoup
de morceaux qui ont excité l’enthoufiafme,
ne font point analogues avec tout ce qui conftitue
le morceau..
St qu’on a comblés d’éloges, ne paroitroient pas,
peut-être, aufli dignes d’admiration. J’oferai en
citer un exemple, ôc le prendre dans VAlcefle de
Gluck, celui de nos compofiteurs qui a le plus
réufli par la force des penfées, mais dont le ftyle
me paroît le plus découfu. Je m’attends bien à trouver
nombre de contradiéleurs ; mais l’Encyclopédie
n’eft pas un ouvrage du moment : peut-être qu’uH
jour notre nation*, qui marche lentement dans la
carrière des arts , mais qui finit toujours par arriver
au but plus furement que toute autre, fentira mieux
le prix de cette unité fur laquelle elle fe montre
fi, indifférente aujourd’hui.
L’air que je veux citer, commence par une phrafe
ifolée , & dont l’analogue ne fe retrouvera plus
dans le refte du morceau.
’ ’ ,-Non ce n’eft point un facri ft , , ce. ..
Je ne rem arqué rai point que la fécondé partie
de la première mefure, toute compofée de doubles
croches, oblige à en précipiter les paroles, ou à
chanter cette mefure plus lentement que les fui-
vanfés ; mais j’obferverai qu’il ne fe trouve pas unë
feulé double ' cloche ailleurs.
J’obferverai encore que cette phrafe eft de deux
irieturés, & que la fuivante eft de trois, (V oy e z
rhythmev)
-----P -
fe
Eh ! pour rois-je vi vre fans toi, fans
toi,-cher Ad- mè te !
i° . Là première phrafe a commencé par un frappé,
par une note tenue; celle-ci commence fur un levé,
& par quatre notes égales.
2.°, La phrafe poétique eft fufpendue après le fécond
vers,
la phrafe muficale ne l’eft point. Affurément, il n’y
a pas de bon déclamateur qui ne fit un repos très-
fenfible après ce vers , pour mieux faire refforiir le
redoublement d’expreflion du vers fuivanr.
3°. Latroifième mefure offre une forme toute différente
des autres, elle eft compofée d’une blanche en
fyncope entre deux noires. On ne retrouve pas non
plus la pareille dans tout le chant de l’air, mais on
retrouve cette forme dans les ritournelles. Ces ritournelles
n’ont donc annoncé qu’une feule mefure, &
4°. La phrafe finit par une moitié de vers.
Sans toi cher Admète.
Il en réfulte une cacophonie défagréable , en ce que
le premier vers étant féminin , cet hémiftiche également
féminin ne rime point avec lui. Les oreilles
fenfibles doivent être choquées de cette difcordance.
Je conviens que le poète partage la faute; fon fens
eft abfolument fini au premier hémiftiche, & le fécond
qui le termine fe lie avec le vers fuivant. Ces enjam-
bemens ne peuvent fe fupporter ; & quand un poète
ignorant en mufique fe les permet, le compofiteur
doit? les réprouver.
„ 5°. Le petit bout de ritournelle qui a féparé le,
premier vers du fécond, eft compofé de groupes de.
notes par lefquelles l'auteur a voulu exprimer les
foupirs d’Alcefte. Cette idée eft jufte , mais il falloit
la fui vre ; elle eft employée aufli de la fécondé phrafe
à la troifième, & elle ne reparoît plus. La première
fois on entend deux de ces foupirs, on en entend
trois la fecopde.
Ah ! p dur moi là vie eft un affreux fùppii
ce.
Nous avons vu que la première phrafe eft de deux
mefures , la fécondé de trois ; celle-ci eft de quatre.
Elle ne s’accorde pas plus pour la forme avec les
fuivantes, qu’avec les précédentes. On voit qu’à
chaque vers, à chaque mot, l’auteur a changé d’idées.
Par la rapidité des notes de la première mefure,
il a voulu peindre l’abandon d’Alcefte; il a mis une
explofion de fentiment fur le mot cher Admète, &
tout-à-coup fon attention s’eft portée fur l’expreflion
du mot affreux, qu’il rend par une modulation
inattendue.
Je ne poufferai pas plus loin cet examen, qu’on
peut fuivre aifément la partition fous les yeux. Tout
ce morceau eft fait de la même manière ; on n’y voit
pas une phrafe qui correfponde à l’autre, & qui préfente
la moindre idée d’unité. Ceux qui ne voient
dans la mufique que ces expreflions partielles, me
fembient bien loin des véritables procédés de cet art ;
d’ailleurs ne fentent-ils pas, qu’ôter à la mélod e
fes formes régulières, c’eft comme fi on ôtoit à la
poéhe la vérification. La correfpondance exaéle de
toutes les parties, eft ce qui conftitue la beauté dans
les arts : on l’exige dans la peinture, dans l'architecture
, dans la poéfie ; la mufique feroit donc le
feul art qui n’en eût pas befoin 1 E;le lui eft au con-
F f f ij