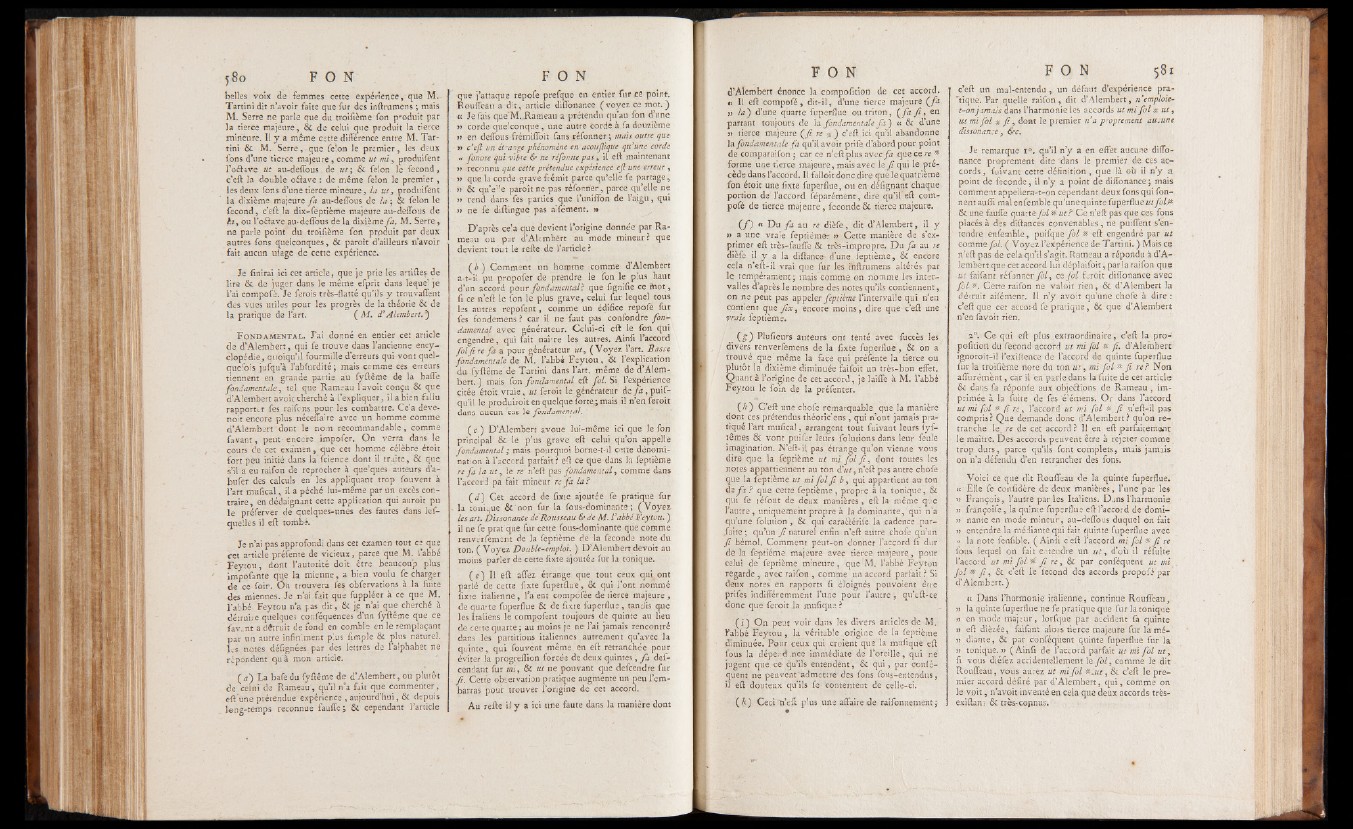
belles voix de femmes cette expérience, que M.
Tartini dit n’avoir faite que fur des inftrumens ; mais
M. Serre ne parle que du troifième fon produit par
la tierce majeure, & de celui que produit la tierce
mineure. Il y a meme cette différence entre M. Tartini
& M. Serre, que fe.on le premier, les deux
fons d’une tierce majeure , comme u t m i , produifent
l’oélave u t au-deffous de u t ; & félon le fécond,
c’eft la double oélave : de même félon le premier,
les deux fons d’une tierce mineure, la. u t 3 produifent
la dixième majeure f a au-deffous de la ; & félon le
fécond, c’eft la dix-feptième majeure au-deffous de
l a , ou l’oélave au-deffous de la dixième f a . M. Serre,
ne parle point du troifième fon prpduit par deux
autres fons quelconques, & paroît d’ailleurs n’avoir
fait aucun ufage de cette expérience.
Je finirai ici cet article, que je prie les artiftes de
lire & de juger dans le même efprit dans lequel je
l’ai compofè. Je ferois très-flatté qu’ils y trouvaffent
des vues utiles pour les progrès de la théorie & de
la pratique de l’art. ( M . d * A lem b e r t .)
F o n d am e n t a l . J'ai donné en entier cet article
de d'Alembert, qui fe trouve dans l’ancienne encyclopédie,
quoiqu’il fourmille d’erreurs qui vont quelquefois
jufqu’à l’abfurdité ; mais comme ces erreurs
tiennent en grande, partie au fyftême de la baffe
fo n d am e n ta le , tel que Rameau l'avoit conçu & que
d’Alembert avoir cherché à l’expliquer, il a bien fallu
rapporter fes raifens pour les combattre. Ce’a deve-
noit encore plus néceffaire avec un homme comme
d’Alembert "dont le nom recommandable, comme
favant, peut- encore impofer. On verra dans'le
cours de cet examen, que cet homme célèbre étoit
fort peu initié dans là fcience dont il traite, & que
s’il a eu raifon de reprocher à que’ques auteurs d’a-
bufer des calculs en les appliquant trop fouvent à
l’art mufical, il a péché lui-même par un excès contraire,
en dédaignant cette application qui auroit pu
le préferver de quelques-unes des fautes dans lesquelles
il eft tombé.
Je n’ai pas approfondi dans cet examen tout ce que
cet article préfenre de vicieux, parce que M. l’abbé
Feytou, dont l’autorité doit être beaucoup plus
imposante que la mienne, a bien voulu fe charger
de ce foir. On trouvera les obfervations à la fuite
des miennes. Je n’ai fait que fuppléer à ce que M.
l'abbé Feytou n’a pas dit, & je n’ai que cherché a
détruire quelques conféquences d’un fyftême que ce
fav<;ni a détruit de fond en comble en le remplaçant
par un autre infiniment pius fimple & plus naturel.
Us notes défignées par dès lettres de l'alphabet ne
répondent qu'à mon article.
( a ) La bafe du fyftême de d’Alembert, ou plutôt
de celui de Rameau, qu’il n’a fait que commenter,
eft une prétendue expérience , aujourd’hui, & depuis
long-temps reconnue fauffe; & cependant l’article
que j’attaque repofe prefque en entier fur cé point.
Rouffeau a dit, article diffonance (voyez.ce mot.)
« Je fais que'M..Rameau a prétendu qu’au fon d’une
» corde quelconque , une autre corde à fa douzième
» en deffous frémiffoit fans réfonner ; m a is outre que
» c ’ efl un ét-ange p h énom èn e en aco ufliq u e q u ’ u ne corde
« fo n o r e q u i vib r e & ne réforme p a s , il eft maintenant
» reconnu q u e c ette p r éten d ue expér ience efl une e r r eu r ,
» que la corde grave frémit parce qu’elle fe partage,
» & qu’e'le paroît ne pas réfonner, parce qu’elle ne
» rend dans fes parties que l’uniffon de l’aigu, qui
» ne fe diftingue pas aifément. »
D ’après cela que devient l’origine donnée par Rameau
ou par d’Alembêrt au mode mineur? que
devient tout le refte dé l’article ?
(£ ) Comment un homme comme d’Alembert
a-t-il pu propofer de prendre le fon le plus haut
d’un accord pour fo n d am e n ta l} que lignifie ce ftiot ,
fi ce n’eft le fon le plus grave, celui fur lequel tous
les autres repofent, comme un édifice repofe fur
fes fondemens? car il ne faut pas confondre f o n d
am en ta l avec générateur. Celui-ci eft le fon qui
engendre, qui fait narre les autres. Ainfi l’accord
f o l f i re f a a pour générateur u t , (Voyez l’art. B a s s e
fo n d am en ta le de M. l’abbé Feytou, & l’explication
du fyftême'de Tartini dans l’art, même de d’Alembert.
) mais fon fo n d am e n ta l eft f o l . Si. l’expérience
citée étoit vraie, u t feroit le générateur de f a , puif-
qu’il le produiroit en quelque forte,; mais il n’en feroit
dans aucun cas le fo n d am e n ta l.
( c ) D’Alembert avoue lui-même ici que le fon
principal & - lé p’us grave eft celui qu’on appelle
fo n d am e n ta l ; mais pourquoi borne-t'il cette dénomination
à l’accord parfait ? eft ce que dans la feptième
re f a la u t , le re’ n’eft pas fo n d am e n ta l, comme dans
l’accord pa fait mineur re f a l a ?
( i ) Cet accord de ftxte ajoutée fe pratique fur
la tonique & non fur la fous-dominante; (Voyez
le s art. D is s o n a n c e de R o u s s ea u & d e M . l ’ abbé F e y t o u . )
il ne fe prat que fur cette fous-dominante que comme
renverfement de la feptième de la fécondé note du
ton. ( Voyez D o u b le - em p lo i. ) D ’Alembert devoit au
moins parler de cette fixte ajoutée fur la tonique.
( e ) Il eft affez étrange que tout ceux -qui;iont
parlé de cette fixte fuperflue, & qui l’ont nommé
fixte italienne, l’a ent compôfée de tierce majeure ,
de quarte fuperflue & de fixte fuperflue, tandis que
les Italiens le compofent toujours de quinte au lieu
de cette quarte; au moins je ne l’ai jamais rencontré
dans les partitions italiennes autrement qu’avec la
quinte, qui fouvent même en eft retranchée pour
éviter la progreflion forcée de deux quintes, f a descendant
fur mi, & ut ne pouvant que defcendre fur
fi. Cette observation pratique augmente un peu l’embarras
pour trouver l ’origine de cet accord.
Au refte il y a ici une faute dans la manière dont
d’Alembert énonce la compofition de cet accord.
« Il eft compofé, dit-il, d’une tierce majeure (/#
» la') d’une quarte fuperflue ou triton, ( fa f i , en
partant toujours de U fondamentale f i ) « & d’une
tierce majeure Çfi re # ) c’eft.ici qu’il abandonne
la fondamentale fa qu’il avoit prife d’abord pour point
de comparaifon ; car ce n’eft plus avec fa que ce re ^
forme une tierce majeure, mais avec le f i qui le précède
dans l’accord. Il falloir donc dire que le quatrième
fon étoit une fixte fuperflue, ou en défignant chaque
portion de l’accord Séparément, dire qu’il’eft compofé
de tierce majeure, fécondé & tierce majeure.
(ƒ ) « Du fa au re dièfe, dit d’Alembert, il y
» a une vraie feptièmér » Cette manière de s’exprimer
eft très-fauffe & très-impropre. Du fa au re
dièfe il ,y a la diftance d’une feptième , & encore
cela n’eft-il vrai que fur les ihftrumens altérés par
lé tempérament; mais comme on nomme,les intervalles
d’après le nombre des notes qu’ils contiennent,
on ne peut pas appeler feptième l’intervalle qui ri’en
contient que f i x , encore moins, dire que^c’eft une
vraie feptième.
( g ) Plufieurs auteurs ont tenté avec fuccès les
divers renverfemens de la fixte fuperflue, & on a
trouvé que même la face qui préfente la tierce ou
plutôt la dixième diminuée faifoit un très-bon effet.
Quant à l’origine de cet accorJ, je laiffe à M. l’abbé
Feytou le foin de la préfenter.
(/z) C’eft une chofe remarquable que la manière
dont ces prétendus théoriciens, qui n’ont jamais pratiqué
l’art mufical, arrangent tout fuivant leurs lÿf-
temes & vont püifer leurs folutions dans leur feule
imagination. N’eft-il pas étrange qu’on vienne vous
dire que la feptième ut mi fol f i , dont toutes les
notes appartiennent au ton dut, n’eft pas autre chofe
que la feptième ut mi fol f i b, qui appartient au-ton
de fa ? que cette feptième, propre à la tonique, &
qui fe réfout de deux manières, eft la même que
l’autre, uniquement propre à la dominante, qui n'a
qu’une folution, & qui caraélérife. la cadence parfaite
; qu’un f i naturel enfin n’eft autre chofe qu’un
f i bémol. Comment peut-on donner l’accord fi dur
de la feptième majeure avec tierce majeure, pour
celui de feptième mineure, que M. l’abbé Feytou
regarde , avec raifon , comme un accord parfait ? Si
deux notes en rapports fi éloignés pduvoient être
prifes indifféremment l’une pour l’autre, qu’eft-ce
donc que feroit la mufiqus ?
( z ) On peut voir dans les divers articles de M.
l’abbé Feytou , la véritable origine de la feptième
diminuée. Pour ceux qui croient que la mufiquè eft
fous la déperd ;nce immédiate de l’oreille, qui né
jugent que.ce-qu’ils entendent, & qui, par çonlé-
quent ne peuvent'admettre des fons fous-entendus,
il eft douteux qu’ils fe contentent dé celle-ci.
(A ) Cecï'n’eft plus une affaire de raifonnemeht ;
c’eft un mal-entendu , un défaut d’expérience pratique.
Par quelle raifon , dit d’Alembert, n emploie-
t-on jamais dans l’harmonie les accords ut mi fo l * ut,
ut mi fol # f i , dont le premier n’a proprement au:une
dissonant, &c.
Je remarque i° . qu’il n’y a en effet aucune diffonance
proprement dite 'dans le premier de ces accords,
fuivant cette définition , que là oh il n’y a
point de fécondé, il n’y a point de diffonance ; mais
comment appellera-t-on cependant deux fons qui fon-
nentaufli mal enfemble qu’une quinte fuperflue ut folfi-
& une fauffe quarte fol % ut? Ce n’eft pas que ces fons
placés à des diftances convenables, ne puiffent s’entendre
enfemble, puifque fo l eft engendré par ut
comme fol. ( Voyez l’expérience de Tartini. ) Mais ce
n’eft pas de cela qu’il s’agit. Rameau a répondu à d’A lembert
que cet accord lui déplaifoit, parla raifon que
ut faifant réfonner fo l, ce fo l fer oit diffonance avec
fold». Cette raifon ne valoit rien, & d’Alembert la
détruit aifément. 11 n’y avoit qu’une chofe à dire :
c’eft que cet accord fe pratique, & que d’Alembert
n’en favoit rien.
20. Ce qui eft plus extraordinaire, c’eft la pro-
pofitiori du fécond accord ut mi fol # fi. d’Alembert
ignoroit-il l’exiftence de l’accord de quinte fuperflue
fur la troifième note du ton u t , mi folM fi re? Non
afftirément, car iTen parle dans la fuite de cet article
& dans fa réponfe aux objeâions de Rameau , imprimée
à la fuite de fes elémens. Or dans l’accord
ut mi fol x f i r e , l’accord ut mi fo l #. f i n’eft-il pas
compris? Que demande donc d’Alembert? qu’on retranche
le, re de cet accord ? Il en eft parfaitement
le maître. Des accords peuvent être à rejeter comme
trop durs, parce qu’ils font complets, mais jamais
on n’a défendu d’en retrancher des fons.
Voici ce que dit Rouffeau de la quinte fuperflue.
« Elle fe confidère de deux manières, l’une par les
w François, l’autre parles Italiens. Dans l'harmonie
jj frànçoife, la quinte fuperflue eft l’accord de domi-
jj nante en mode mineur, au-deffous duquel on fait
jj entendre la médiante qui fait quinte fuperflue avec
« la note fenfible. ( Ainfi ceft l’accord mi fo l * f i re
fous lequel on fait entendre un u t, d’ou il réfulte
l’accord ut mi fol. 0 f i re, & par conséquent ut mi
Jol * f i , & c’eft le fécond des accords propofé par
d’Alembert.)
« Dans l’harmonie italienne, continue Rouffeau,
jj la quinte fuperflue ne fe pratique que fur la tonique
jj en mode majeur, lorfque par accident fa quinte
jj eft dièzée, faifant alors tierce majeure fur la mé-
jj diànte, & par conféqùent quinte fuperflue fur la
jj tonique, jj (Ainfi de l’accord parfait ut mi fol ut ;
fi vous diéfez accidentellement le fo l, comme le dit
Rouffeau, vous aurez ut mi fol u t , & c’eft le premier
accord défiré par d’Alembért, qui, comme on
le-voit, n’avoit inventé en cela que deux accords très-
exiftans & très-copnus.