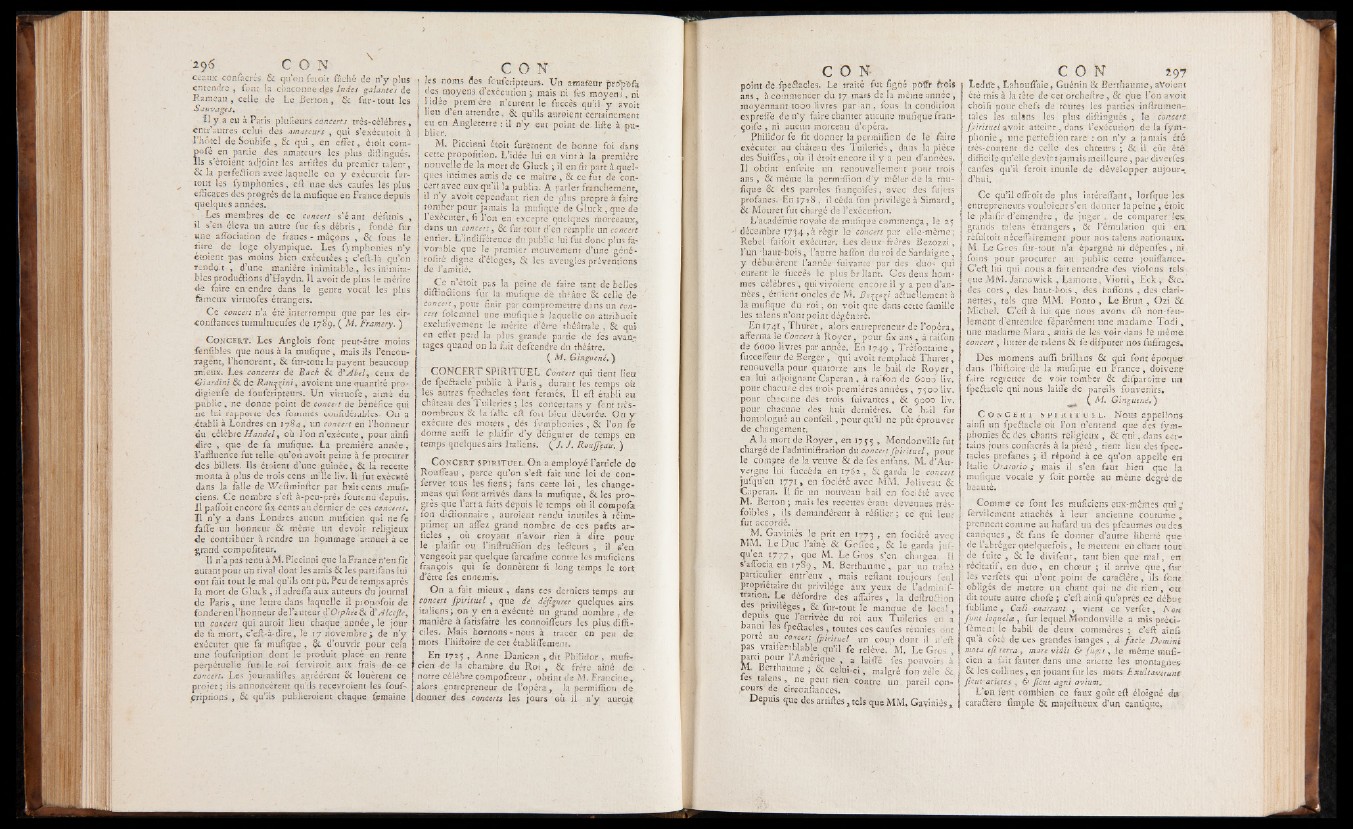
\
ceaux coniacrt-t* 8c qu'on fetoit fâché de n’y plus
entendre , font la cbacon n e cî,es Indes galantes de
Rameau, celle de Le jBer.ton, 8ç fur-tout les
Sauvages.
i l y a eu à Paris plufieurs concerts très-célèbres,
entr’autres celui des amateurs , qui s’exécutoit à
I hôtel de Soubife , 8c qui , en e ffet, étoit cora-
pofé en partie des amateurs les plus cîi{lingues.
Ils s’étoient adjoint les artiff es du premier talenr,
.& la perfedion avec laquelle on y exécurcit fur-
tout les fymphonies, eff une des caufes les plus
efficaces des progrès de la mufique en France depuis
quelques années.
Les membres de ce concert s’éant défunis ,
il s’en éleva un autre fur fts débris , fondé fur
une affociation de francs - maçons , & fous le
titre de loge olympique. Les fymphonies n’y
étoient pas moins bien exécutées ; c’eft-là qu’en
rendo-t , d’une manière inimitable,, les inimitables
produirions d’Haydn. Il avoit de plus le mérite
de faire entendre dans le genre vocal les plus
fameux virtuofes étrangers.
Ce concert riz été interrompu que par les eir-
■ conffances tumultueufes de 1789. ( M. Framery. )
C o n c e r t . Les Anglois font peut-être moins
fenfibles que nous à la mufique , mais ils l’encou-
yagent, l’honorent, & fur-tout la payent beaucoup
mieux. Les concerts‘ de Bach 8c d'Abel, ceux de
Gïardini 8c de Rau^zinï, avoient une quantité pro*
digieufe de fouferipteurs. Un virruofe, aimé du,
public , ne donne point de conçut de bénéfice qui
ne lui rapporte des fommes confidérables- On a
;étabii à Londres en 1784 , lin concert en l’honneur
du célèbre Handel, où l ’on n’exécute, pour ainfi
dire , que de fa mufique. La première année,
l ’affiuence fut telle qu’on avoir peine à fe procurer
des billets. Ils étoient d’une guinée, 8c la recette
monta à plus de trois cens nvlie liv. 11 fut exécuté
dans la ialle de Weffminffer par huit cents mufi-
ciens. C e nombre s’efl à-peu-près foutenü depuis.,
i l paffoit encore fix cents au dernier de ces concerts.
II n’y a dans Londres aucun muficien qui ne fe
faffe un honneur & même un devoir religieux
de contribuer à rendre un hommage annuel à ce
■ grand compofiteur.
Il n’a pas tenu à M. Piccinni que la France n’eri fît j
autant pour un rival dont lès amis 8c les partifans lui
ont fait tout le mal qu’ils ont pù. Peu de temps après
la mort de Gluck , il adreffa aux auteurs du journal
de Paris, une lettre dans laquelle il piopofoit de
fonder en l’honneur de l’auteur d'Orphée & d’Alcefie,
lin concert qui auroit lieu chaque année, le jour
de fa mort, c’eft-à-dire, h 17 novembre^ de n’y
exécuter que fa mufique , d’ouvrir pour cela
une foufeription dont le produit placé en rente
perpétuelle fu tile rot ferviroit aux frais de ce
concert. Les joumaüftes agréèrent 8c louèrent ce
projet ; ils annoncèrent qu’il$ recevroient les fouf-
jeriptiops , & qu’ils publieroient. chaque femaine
les noms des fouferipteurs. Un amatèùr proyôfa
vdes moyens d’exécution mais ni fes moyens, ni
1 idée ^prem ère n’eurent le fuccès qu’il y avoit
lieu d’en attendre, & qu’ils atiroient certainement
eu en Angleterre : il n’y eut point de- M e à publier.
M. Piccinni étoit furement de bonne foi dans
cette propofition. L’idée lui en vint à la première
nouvelle de la mort de G lu ck ; il en fit part à.quelques
intimes amis de ce maître , & ce fut de concert
avec eux qu’il la publia. A parler franchement,
il n y avoit cependant rien de plus propre à faire
tomber pour jamais la mufique de Gluck , que de
1 exécuter, fi l’on en excepte quelques morceaux,
dans un concert, & fur-tout cl’en remplir un ccncert
;entier. L’indifférence du public lui fut donc plus favorable
que le premier mouvement d’une géné-
rofiré digne d’éloges, & les aveugles préventions
de l’amitié.
Ce n’étoit pas la peine de faire tant de belles
diminutions fur la mufique de théâtre 8c celle de
concert, pour finir par compromettre dans un cour
cert folenrnel une mufique à laquelle on attribuoit
exclusivement le mérite d’être théâtrale , 8c qui
en effet perd la plus grande partie de fes avantages
quand on la fait defeendre du théâtre.
( M. Ginguené. )
CON CER T SPIRITUEL Concert qui tient lieu
de fpe&acle* public à Paris , durant fes temps où
les autres fpeâacles font fermés. Il eff établi au
château des Tuileries ; les concertans y font très-
nombreux 8c la falle eff fort bien, décorée. On y
exécute des motets , dès fymphonies , 8c l’on fe
donne aufli le plaifir d’y défigurer de temps en
temps quelques airs Italiens. { J. J. Roujfçau.. )
C o n c e r t s p ir it u e l . On a employé l’article de
Roaffeau , parce qu’on s’eft fait une loi de con-
ferver tous les fiens; fans cette lo i, les change»
mens qui font arrivés dans la mufique, 8c les progrès
que l’art a faits depuis le temps où il couapofa
fon dictionnaire , auroient rendu inutiles à réimprimer
un affez grand nombre de ces pgfits articles
, où croyant n avoir rien à dire pour
le plaifir ou l’inffruiKoii des leileurs , il s’en
vengeoit par quelque farcafme contre les muficiens
françois qui fe donnèrent fi long temps le tort
d’être fes ennemis.
On a fait mieux , dans ces derniers temps au
concert fpirituel , que de défigurer quelques airs-
italiens; on y en a exécuté un grand nombre y de
manière à fatisfaire les connoiffeurs les plus, difficiles.
Mais bornons - nous à tracer en peu de
mots l ’iiiftoire de cet établiffemenr.
ï En 1725 , Anne Danican , dit PhMidor , mufr-
cien -de’ la chambre du Rot , 8c frère aîné de
notre célèbre compofiteur , obtint de M. Francine,
alors entrepreneur de l’opéra, la permiffiou de
dorme* des concerts les jours où il n’y auroit;
pôînt de ipeélacles. Le traité fut fighé pôtfr frôîs
ans, à commencer du 17 mars de fa même année ,
moyennant 1000 livres par an , fous la condition
expreffe de n’y faire chanter aucune mufique fran-
çoife , ni aucun morceau d’opéra.
Philidor fe fit donner la permifîicn de le faire
exécuter au château des Tuileries, dans la pièce
des Suiffes, où il étoit encore il y a peu d’années.
Il obtint enfuite un renouvellement pour trois
ans , 8c même la permiffiou;d’y mêler de la mu-
fique 8c des paroles françoifes, avec des fujets
profanes. En 1748 , il céda fon privilège à Simard,
8c Mouret fut chargé de l’exécution.
L ’a c ad ém ie r o y a le d e m u fiq u e c om m e n ç a , l e 25
d é c em b re 1734, à ré g ir l e concert pa r e lle -m êm e ;
R e b e l fa ifo it e x é cu te r . L e s d e u x frè res B e z o z z i ,
l ’ un 'h a u t - b o i s , l ’au tre b a llo n du ro i d e S a rd a ign e |;
y d éb u tè ren t l ’an n é e fu iv a n t e ’ pa r d e s d u o s qu i
eu ren t le fu c c è s le p lu s b r liant. G e s d e u x h o m m
es c é lè b r e s ', qui v iv o ie n t en c o r e i l y a p eu d ’ann
é e s , é to ie n t o n c le s d e M . Be^sçi a éh ie tlem en î à
la mu fiqu e du ro i ; o n v o i t q u e dans c e tte fam ille
le s ta len s n ’o n t p o in t d é g én é ré .
En 1741, Thuret, alors entrepreneur de l’opéra,
afferma le Concert à R o y e r , pour fix ans , à raifon
de 6000 livres par année. En 1749 j TréTontaine ,
fucceffeur de Berger, qui avoit remplacé Thuret,
renouvella pour quatorze ans le ba-il de R o y e r ,
en lui adjoignant Caperan , à raifon de 6ooo liv.
pour chacune des trois premières années , 7500 liv.
pour chacune des trois Suivantes., 8c 9000.liv.
pour chacune des huit dernières. Ce bail fut
homologué au confèil, pour qu’il ne pût éprouver
de changement,
A la m o r t d e R o y e r , e n 17 5 5 , M o n d o n v ille fu t
ch a rg é d e l’adm in iffra tion du concert, fpirituel, p o u r
l e c om p te d e la v e u v e 8c d e fes eh fan s . M . d ’A u v
e r g n e lu i fu c c é d a en 1762 , 8c ga rd a l e concert
ju fq u 'e n 17 71, en fo c ié t é a v e c ' M M . J o llv e a u 8c
C a p e ra n . I l fit u n n o u v e au b a il en fo c ié t é a v e c
M. B e r to n ; mais le s r e c e tte s étan t d e v e n u e s trè s-
fo ib lè s , ils d em an d è ren t à ré filie r ; ce ' q u i le u r
fu t a c c o rd é .
M . G a v in iè s le p r it en 1773 > en fo c ié t é a v e c
M M . L e D u c l ’aîné 8 c G o f f e c , 8 c l e garda ju f - ,
q u ’ en 1 7 7 7 » ^-ue M . L e G ro s s’ en ch a rg e a . Ï 1
s’ a ffo c ia en 1789, M . B e r th a um e , p a r un traité
pa rticu lie r entr’eu x , mais reffan t to u jo u r s fe u l
proprié ta ire du p r iv ilè g e a u x y e u x d e l ’adm in if-
tra tion . L e d é fo rd re d e s affa ires , la d e ffru c lio h
de s p r iv i lè g e s , 8c fu r -to u t le m an q u e de l o c a l ,
d e p u is q ue l ’ar r iv é e du ro i a u x T u i le r ie s en a
b an n i le s fp e& a c le s , tou te s ce s c a u fe s réu n ie s o n t
p o r te au concert fpirituel im co u p d on t i l n ’ eft
p a s v r a ifem b la b le qu ’il f e re lè v e . M . L e G ro s
o a rti p o u r l’Am é riq u e , a la if fé fe s p o u v o ir s à
M. B e r th a um e ; 8c c e lu i - c i , m a lg ré fo n z è le 8c
es ta e n s , ne p eu t r ien c o n t r e u n p a re il c o n co
u r s de c i r c c n u a n c e s . :
Depuis <jue des artiftes, tels que MM. Gaviniès,
C O N 297
Ledifc, Lahouffaie, Guénin oc Berthaume, aVoient
été mis à la tête de cet orcheffre, 8c que l’on avoit
choifi pour chefs de toutes les parties in ff rumen-,
tales les tal«ns les plus diffingués , le concert
fpirituel avoit atteint, dans l’exécution de la fym-
phonie, une perfeéVion rare : on n’y a jamais été
très-content de celle des choeurs ; 8c il eût été
difficile qu’elle devînt jamais meilleure , par di ver fes
canfes qu’il feroit inutile de développer aujourd’hui.
Ce qu’il offroit de plus intéreffant, lorfque les
entrepreneurs vouloient s’en donner lapeine , étoic
le plaifir d’entendre, de juger de comparer les;
! grands talens étrangers , 8c l’émulation qui e n
i réfultoit néceffairement pour nos talens nationaux.
M. Le Gros fur-tout n’a épargné ni dépenfes , ni
: foins pour procurer au public cette jouiffance-
C ’eff. lui qui nous a fait entendre des violons tels
que MM. Jarncwick , Lamotte, Viotti, Eck , Sic.
des cors , des haut-bois , des baffons , des clarinettes,
tels que MM. Ponto , Le Brun , Ozi 8c
Michel. C ’en à lui que nous avons dû non-feulement
d’entendre féparément une madame T o d i,
une madame Mar a , suais de les voir dans le même
concert, lutter de talens Si fe difputer nos fufirageS.
Des momens aufii brilhns 8c qui font époque
dans Thiftoire de la mufique en France -, doivent
faire regretter de voir tomber 8c difparcître un
fpeâacle qui nous laide de pareils fonvenirs.
( M. Ginguené
C ON c e r t s p i r i t u e l . Nous appelions
ainfi un fpeélacle où l’on n’entend que des lymphomes
8c des chants religieux , 8c qui, dans certains
jours confacrés à la piété , tient lieu des fpec-
tacles profanes ; il répond à ce qu’on appelle en
Italie Oratorio ; mais il s’en faut bien que la
mufique vocale y foit portée au même degré de
beauté.
Comme ce font les muficiens eux-mêmes qui ^
fervilement attachés à leur ancienne coutume ,
prennent comme au hafard un des pfeaumes ou des
cantiques , 8c fans fe donner d’autre liberté eue
de l’abréger quelquefois , le mettent en cirant tou t.
de fuite , 8c le divifenr, tant bien que mal, en
récitatif, en diïo, en choeur ; il arrive que, fur
les verfets qui n’ont point de caraéîère, ils font
obligés de mettre un chant qyi ne dit rien, oir
dit toute autre chofe ; c’eff ainfi qu’après ce début
fublime, Ccdi enarrant , vient ce verfet, Aon
funt loquela. , fur lequel Mondonville a mis préci-
fément le babil de deux commères ; c’eff ainfi
qu’à côté de ces grandes images , à fade Dominé
mot a efit erra, mare vidit & fu-git , 1 e même muficien
a fût fauter dans une ariette les montagnes-
8c les collines, en jouant fur les mots Exultaverune
ficut arietes , & ficut agni ovïum*
L’en fent combien ce faux goût eff éloigné du
cara&ère fimple & majeftueux d’un cantique.