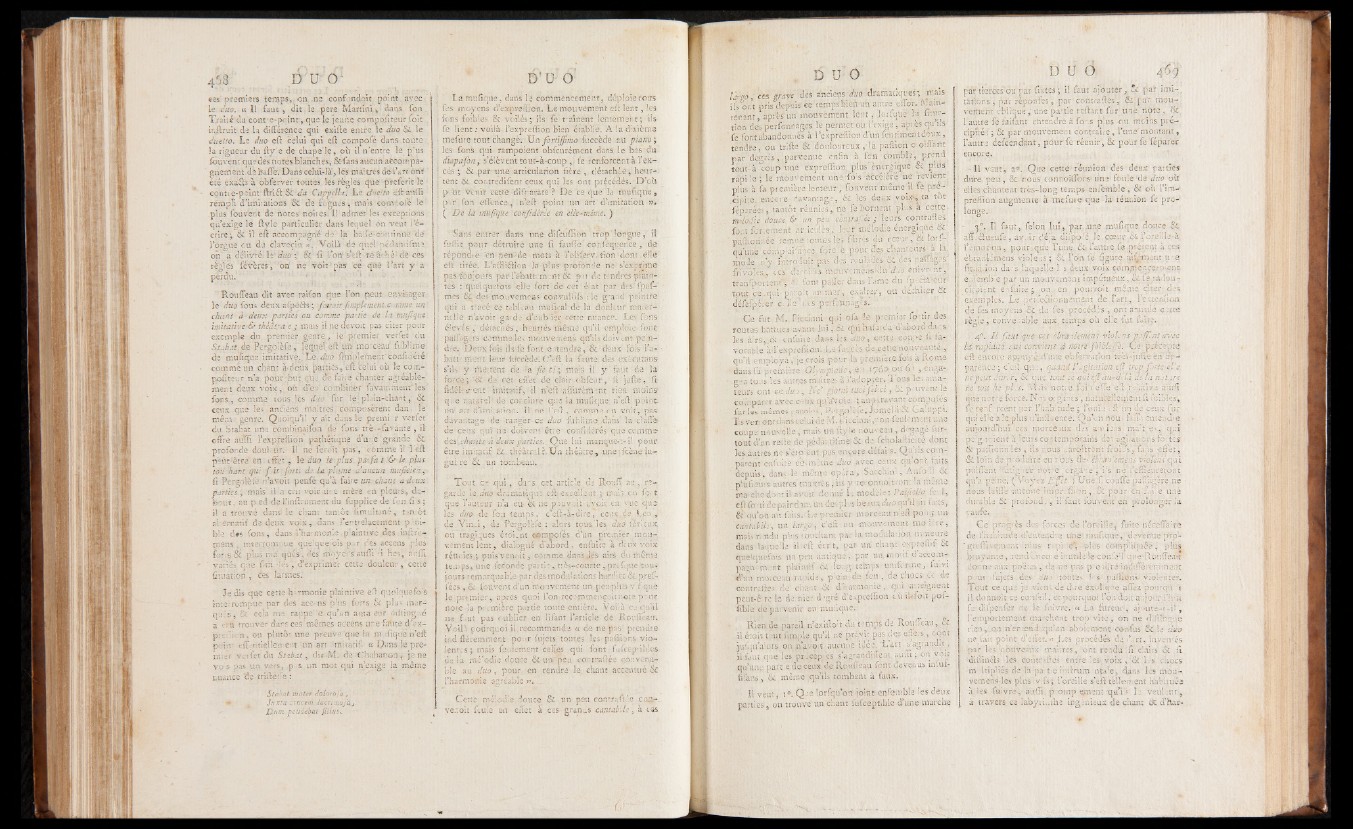
ses’ premiers tënipS’, ; on, ,ns confondqit point .. avec <
le eut). « I l fa u t , d i t , le pere M a rtin i,' Sans fpn
Traité du conî-e-peint:, que îe jeune compoifiteur foit .
inftruit de la différence qui exifte entre le duo & le
duetto. Le duo eft aèiui qui eft compofé dans toute ;,
la rigueur du f ty ’e de chape’J e, oh il n’entre le £>'us
fou vent que des notés blanches1, &-fans aucun aécompa-
gnement dè baffe; Dans celui-là’, les nia; très de-fart ont
été exaéls à ôbfervër toutes, lés règles que pfrefcrit le
cçntî e-pôint ftrïét S ld a C a p p e lle Le ctâetîà ëftauffi
rempli d’imnàtioù’s & de fugues -, mais eomêole le -
plus foüvent de notes noires, il admet les exceptions :
qu’exige le fty le particulier dans lequel on veut l’écrire.;
St il èft accompagné de' la bâlîë-oontin'ué 'dë:.
l’orgue eu dà clavecin » ..V o ilà de quel pétkmifm?-.
oh' à délivré le duo ;; & fi i-’on! s’eft ne âohé: de ces
réglés fédères, 'oh ne : v o i t J pas c é qôè l àrt y a
perdu.
‘ Rouffeàu dit avec raifon que l’on peut envisager
1 q duo fous deux afpëéls ; favoirfmpUment,c mme un ■’
chant à - deux parties ou comme partie de la mufique
imitatïvey& tkêâtra e ; mais il ne devoit pas citer pour
exemple du premier g e n r e ' le premier verfet clu
Stabat, de Përgôîèfe , lequel eft’uïi-’ morceau' fiiblime
de mufique'imitative;;*'Lè, duo ' triplement' conhûéré
comme un çHant à>deux parties, eft celui ch le composteur
n’a pour but.que dé fane chanter agréablement
deux v o ix , où d’en combiner fàvarr.ment'les
fons.., comme tous, lés duo fur ief p lain-chant, St
ceux que les anciens maîtres composèrent dan; le'
même genre, Quoiqu’il y ait dans le prerni r verfet
du Stabat une combinaifon de fons-trè--lavante , il
offre .auffi l’expreÜion pathétique d’une grande &
profonde douleur. 1! ne fereit; pas:, comme if 1 eft
psu rêtrë en e f fe t , 1 z duo le plus, parfa t :& le plus
torc hant qui f it fortï de la plume d'aucun mufcjen,-
fi Pèrgofèfe t-’avoir peafé qu’à faire un chant à deux
arties ; mais il a cru voir lire mère en pleurs, dc-
ont, au p.ed de l.’inftrument du fupplice de fon fi ,s ;
il a trouvé dans; le chanr tantôt fimuitané, tm-ôt
al ernatif de deux v o ix , .dans l’entrelacement pénible
d#$ fon s, dans l’h a r moitié p ’aintive.des . inilru-
mens , interrompue quelquefois;p*r ries accens plus-
for; s & plus rr.a qué s, dés irioyers' auffi ri fies, auffi
variés que fini -les , d’exprimer cette douleur, cette
foliation , des larmes.!
Je dis que cette harmonie plaintive eft quelquefo’s
interrompue par des ace-ns puis forts & plus marq
u i s , & cela rne rappel 'e qu’un anta eur difting ,é
a cru trouver dans ces’mêmes accens une faute d-’ex -
preffion, ou plutôt une preuve que la mffiqu en ’eft
point effrntièilep-.eut un art -mitarif. « Dans..le premier
verfet du Stabat, dir-M. de Chabanorl j je ne
v o s pas un vers, p; s un mot qui n’exige la même
nuance ’de trifte'Je : . *
Stabat mater dolorofa ,
Jnxta cruceiû lacrimojclt.
Du in peudebat fitius*
La mufique, dans le commencement, déploie toits
fes moyens d’expreffiôn. Le mouvement eft len t , les
fons foibles & vo ilé syü s fe rainent lentement ; ils
fe lient : voilà l’expreffion bien établie. A la dixième
mefoire tout changé. Un fortiffmo fuccède au piano',
les fons qui rampoient obfcurément dans le bas du
drapa fon s s’élèvent tout-à-çoup fé renforcent à l’excès
; & .par une articulation fière détachée ; heurtent
&. contredifent ceux qui les ont précédés. D ’oh
pdut venir cette -'diteàrate ? D e "ce que'la mufique 9
p:-.r fon eft'ence, n’eft point un art d’smitatîôn ».
( De la ntufique confidèrèe en elle-même. )
Sans entrer' dans une difeuffion. ' trop' longue, il-
fnibt pour détruire une fi faufie conféquence, de
répondié*'en période mots à l’obferv..lion dont .elle
eft tirée. L ’affiiéfion la p!usi profonde ne s’exprime
pas tbujôûft par l’ébattcm ;-nt & pnr' de tendres plain-
" teé-: quelquefois elle fort dé cet &at par dés' fpaf-
•mes ô^ydes'mouvémr»s convuîfifs :1e gya.nd peifitfe
qui a t'acé ce tablcâ-u îriufual dè la dqrikur marèr-
nclle n’avoit ga-cle d’oub-ier cette nuance. Les.fons
élevés', détachés, heurtés 'même qu’il emploie font
pailagers comme le> mouvemeus qffils doivent pe’n-
d>!e. Deux fois ils fé font ë ’ tendrè, & deux fois l’a -
bat fi merit leur f ifrcède. fdeft la faute des exécutant
s?iL y - mettent de. ia fie tir, mais il y faut de la
force; -St de cet effet de. clair ob fcur, fi jufte, f i
fidélt trent imitatif, il n’eft affurémint rien moins-
que naturel' de conclure que la mufique. n’eft point-
iin: art d’imi.aiion. Il ne l’e f t , comme on voit , pas-
davantage de -ranger-ce duo fublimo. clans la claflé1
de ceux qui né doivent-être- eonfidérés que comme-
âes\chants à deuxparties. Que lui manque-t-il pour
être imitatif ëç.:th é â t r a lU n théâtre,un es fcèn ehir
guère un tombeau.
T ou t ce qui , durs' cet article de Rouit an, regarde
l e duo -dra ma tique,eft» exééii.ent ; mai?' on fort
que l’auteur n’a eu- & ne p euvoifiayôii: en vue qùé
les duo de. fon temps , c’eft-;a-dire., ceux dé Léo +
de. V in c i , de Pergoîèfe : alors tous les duo térieux.
eu tragiques ctofent o^mpofés. d’ini premier mouvement
lent, dialogué- d’abord, enfuite a deux voix
rétmie'S;,; puis'venoit, comme dan-s yles airs du mérite
temps, une fécondé partir, très-courte,prefque toujours
remarquable par des modulations hardies pref-
fées , & foilvent d’un mouvement un peu plus v' f que
le premier, après quoi l’on rcc.\rnmençoitr.oîe p: ur
note la première partie toute entière. Voilà ce qu’.il
ne. fi.ut pas oublier en lifant l’article de Rouffeàu.
Voilà pourquoi il,recommanda « de ne pas prendre
iï.d fféremmect pour fujets toutes les paffions v io lentes;
mais feulement celles qui font • fufcep-iblcs
p e la mé’oclie dçuée & un" peu cor.traftce co.-rvcn.a-
fcle au duo, pour en rendre le-, chant accentué
l’harmonie agréable »....
Cette mélodie douce & un peu contraftéc caqt-:
yer.oit foule en effet à ces grands cantal/,U, à cas
W
largo; ces giave dès anciens duo dramatiques; mais
ils orit pris Épiiis: ëé 'tëfops bién-'im; autre effor. il'-ain-
tènant, après un mouvement, fon t, iîorfuüc la fi'.iic-
tion des perfonnàges le p'érmet ou l’exigé; après qu’ils
' fé font abandonnés à l ’expreffion d’un ferifimentclcux,
tendre , ou trifte & douloureux , la paftion ctoiffant
par degrés^. parvenue enfin à fen -c o m i i l , prend
tout-à-coup une expreffion. pins énergiqué & P-D®,
rapifie ; le mouvement une /fois -accéléré ne rev ien t.
plus à fa première lenteurq foûvënt même ilTe p r é - 1
.cipite. encore-davantage, les deux voix»;.ta••tôt
féparégs, tantôt réunies1, ne fe bornent plus a cette.
m/lodie douce & un peu ccntrafée ’ leurs contra fies
fort for.ement ar.icujési, leur mélodie énergique &
paffionr.ée lemne ; eûtes les fibres du c c e ir , & loti-,
qu'uns cômprii’déce fore e pour des chanteurâ à Ki.
m o le n’y introduit pas des roiil.iocs o-l des p adages^
frivoles., tes de • i :.s mcuv:mà:>s-du duo eriivr* u t,
tranfiîortev.v, font p aller dans lame du fp.euVcur
tout ce .qu i paroi t animer',^ exalte^', o.u deor.uer oi
défefpcrer c ; Üc - e t s"perfonnàges.'
Ce fut M. Pieciniii q .i ofa le premier fo tir des
routas battues avant lu i , & qui hafàrda'd abord aar.s.
les airs ,,& cnfiiiie dans..-les :4tt0 ». cette-coupe, fr fir-v
vorâble ad expreirion. Le. fuçces de .çe-fiq nouveauté ,
qu’il employa y je crois pour là première fors à'J\onie
■ dans fa première. Olympiade, e t iy(SP, 0tr 6 t , en^a-
- gea tous les âutr.es maîtres a l’adopter. 1 ans les amateurs
o.nt ee duo, A V giomi luoifehci, p-mv^tu le
comparer avéc.eeüx q riàyp-ieau para vant compo.es
fur les mêmes p a io k s , Pergo’:cleqî.omeh.i ^ Gamppi.
Ils verrontdaris celui de ivl. l-‘icclnn-!,;'’.on-feU'lem-nt une
coupe n ou ve lle, mais-u-n f t y l e nouveau , dégagé hir-
to ut d’un r elle de pédai trime; & de fcuolafticite dont
les autres ne :s’.é;to:ent pas encore aefai s. Q j ils comparent
enfuite ce'.mûme duo avec ceux qu ont faits
’ • depuis,, 'dans - le même op é ra , .Sac-cain:, AuîO.ii &
pl ü fi ehrsl autresliriakr.es , ils y ‘reconnot tronc-la me trie
marche dont il aveit donné 1 ; model e i Païjiel/o fo. I,-
eft forti c-c pair dans un des plus be rux duo qu il --it faits,
êï qu’ori ait faits. Le premier morceau n’eft pofot un
'cahüihiù, un largo, cé ft un mouvement modéré;
fnaLr.ndu pies touchant par .la; modulation^ m-rieur e
dans laquelle il eft écr t, par un chai>t expreff-f St
que'quefois. un peu antique , par un motif daccom-
jia^n n v n t plaintif ÔL long;temps •îimterir.e, fiusV1
d’un nvoiceau rapide, p'em de feu , de chocs c< de
contraires de' chaut -.&■ ■ d harmonie , qui attejgne-it
peiït-ê’ re le dernier d'gré- d e.vpreffion cu ii*foit pot-
fible de parvenir eu nautique.
Rien de pareil n’exiftoit du temps de Rouffeàu, &
„il étoit tout iîmple qu’il ne prévît pas des efférsq cqnt
jufqu alors on n’avo t aucunè idée. "L’art s agrandit .,
,il fit ut que les préceptes s’agrandiffeat | uffi ; ori, voie
qu’une part’e dc çeux de Rcufieau font devenus inlufo
fifans, & même qu’iU tombent à faux.
Il v eu t , i° . Q.ie lorfqu’on joint enfétuble les deux
parties y on trouvé'un chant fufceptible d’une marche
par tierces!du par fixtes ; il faut ajouter, S t par imi-,
titrons ; pàr réponfies , par coritraffés, ôi paf mou-
veftteirt obliqueune partie reftant fur une npte , &
iautre fe faifant entendre à fous plus ou moins précipité!’
; St par mouvement contraire, l’une mon tant,
l’autre défeendant, pour fe réunir, & pour fé féparer
encor er., ,
- i l veut, 2°. Que cette’ réunion des deux parties
dure-peu, & 'nous connoèffors^ une- foule d é d u o oh
elles chantent très-long-temps enfétrible ; & oh l’im-'
preffion augmente à mcfüre que la réunion fe pre-
3°. I1 faut, félon lu i, par .une mufique douce S c
a’ff rélueufie, av.-ir déjà difpofe le coeur .64 l’oreille-à;
ré’mpfibn , pour q.ire l’uné; ^ laitue fe .prê^ent-à ces
ébrarrlimens vipleûs ; &.,ljori f é figure. ^iQrmenf u:.e
fffiiavxoh dary Taquelle 1. s .^eux' voix cdmiqençero-ent
êhjemb'e par un ijiouŸé.ment ifnpetueux,.ôofe:iadou-
cirpient enfuite ; :on en, pou,ri oit même Æeri dés
exemples. Le .pch-feâionnement de . l’art , l’extenfion
de fies moyens^,de fes procédas , ont annulé cette
règle, conye/âble aux, t/nfios où elle fuL fiuiitÿ-, ..
40. I l f a u t q u e c e s c b ra ilem en s v io le n s p j f f n t a v e c
I d ra p id ité cm c o n v ie n t à notre fdibU jT e. Ce précepte
eft encore appiiyp;d’une obfoffvàtîon:tïèi--fjri^ éîi’dp-^
pafençe ; c'e’ft que- , q u a n d V a g ita tio n e f t trop fo r t e e l ’c
ne p e u t J w \ r , OC q ue to u t cc q u i ç j là u - d .là de-l'a n ù t.ir e
n e to u he p L s . Mit-; notre' foi Ve (fis eft .relative auffi
que n-'t'e force. No.s otgvincs, haîurelleipentfo ipibïesq
fé renforcent par rhàb’tude ; I’buïe i'fir un de ceux fur
qui elle a le.plus d’iiffièence. Qu’on nôti; faffo entendis
aujourd'hui cçs tnorceutx d. s a i îj/.s' ms 'ty s q.;i
pfig i r ient à leurs contemporains 'de ; agitations fo:t:s
& p a ffi o r. n é e s , ils rjoujs ' a roi t r e n t fir ô i Is, fa n s effet,
SL loi:'. d'è’jptôduiT.èr & i 'r '0,ds 'Vte/ébr.rr 'enièns violer: t qu i
pu:fient -Matîg : t t notre . crgà-ie • i:s ne‘ /cf./i-.u-eron,:
(;n’j pé:-'. ( Voyei F f t ) Urie.fi: couffé.pafiagèrè nè
nous- iffilfe ùiièuneumprcffion ,. & pour ieri-fiff/e une
durable S t profond.-, il faut fouvent en 'pi'Otôngef la
cairfo. „
Ce progrès clés forces de l’oreille ÿ fuite néceffa’re
de- l’habitude d’entèqdve une- rii'ufiqiVèy''jdeven’ue'p^oL
‘ greftivernsnt ’pius! r pi ’ é% -plus coiripHtiuêé, plus
broyante, rendbnc-o:.e iminl ; le coule ! oue-Rouffeati
dorme aux; pqër.’Siÿ de ne pas p r e i o r é’ î ndi fie re rri i ri e ne
paut lu jets, des duo toute' ! s p a ! ’fions- vio; e mes.
Tout ce eu : je vient de d/re exolique aOez'pourqu t
il donneit ce corsfoil,' et po;:n.[uoi l’o.i doit aujoùrdjh-Vi
fe difpenfer de le fin ivre.« lui fureur, aj ute-t-i' ,
. Lethportementmarchent trop'vite, on ne rfiftîhgue
tien jlotîtn’érîfotd (jti’an aboiemént cordas & ie d-sco
. ne vait point d’eftet. » Les procédés de inverilés
par les rioilveaiix maîtres, ''Ont re idu ifi^ clairs ét fi
-diftinêfis des ctontr^ftés entre les voix, Si l. s chocs
m dtipHés dedà'pâ tie iniirum. npde, ffans les mou-
veméns les plus1 vifs; l’oreille s’eft tellement habituée
a ies fùivro, auffi. promp ement'qu’i r 1: veulent,
à travers ce labyii.uhe ins mieux de chant & d’hav