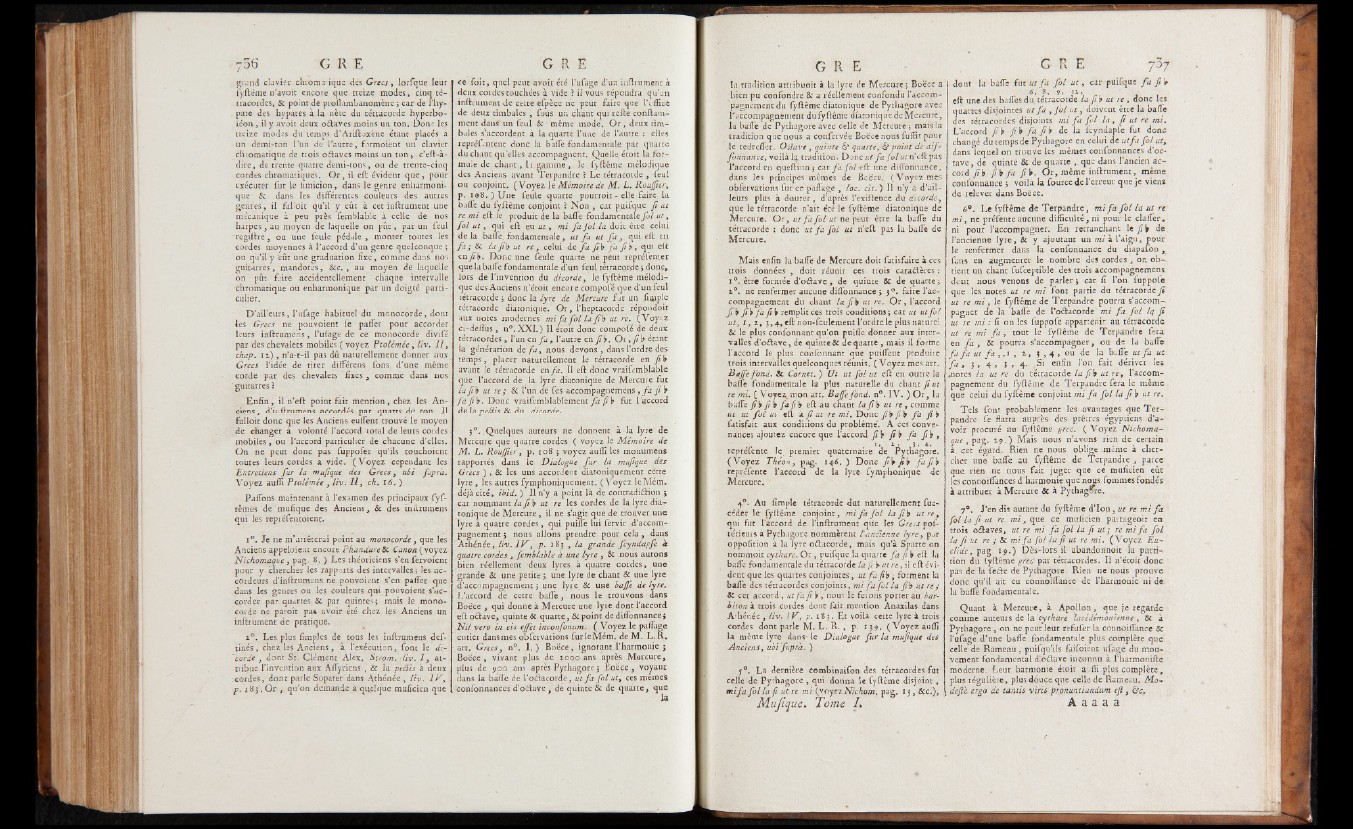
grand clavier chrom.riquc des Grecs, lorfque leur
fyftême n’ayoit encore que treize modes, cinq té-
tracordes, & point de prollambanomène ; car de l’hy-
pate des hypates à la nète du tétracorde hyperbo-
iéon , il y avoit deux oda ves moins un ton. Donc les
treize modes du temps d’Ariftoxène étant placés à
un demi-ton l'un de l’ autre, form oient un clavier
chiomatique de trois odaves moins un ton , c’eft-à-
dire, de trente quatre demi-tons, ou de trente-cinq
cordes chromatiques. O r , il eft évident q u e , pour
exécuter fur le fimicion, dans le genre enharmonique
& dans les différentes couleurs des autres
genres, il falloir qu’i l y eût à cet inftrument une
mécanique à peu près femblable à celle de nos
harpes, au moyen de laquelle on p û t , par un feul
regiftre, ou Une feule péd ale, monter toutes les
cordes moyennes à l ’accord d’un genre quelconque j
ou qu’il y eût une graduation fixe , comme dans nos
guitarres, mandores, & c . , au moyen de laquelle
on pût. faire accidentellement chaque intervalle
chromatique ou enharmonique par un doigté particulier.
D ’ailleurs, l’ufage habituel du monocorde, dont
les Grecs ne pouvoient fe paffer pour accorder
leurs inftrume’n s , l’ufage de ce monocorde divifé
par des chevalets mobiles ( v o y e z Ptolémée, liv. I l ,
chap. i z ) , .n’a-t-il pas dû naturellement donner aux
Grecs l’idée de tirer différens fons d’ une meme
corde par des chevalets f ix e s , comme dans nos
' guitarres ?
E n f in , il n’eft point fait mention, chez les Anciens
, d’ii.ftrumens accordés par quarts de ton. Il
falloit donc que les Anciens euffent trouvé le moyen
de changer à volonté l ’accord total de leurs cordes
mobiles, ou l ’accord particulier de chacune d’elles.
On ne peut donc pas fuppofer qu’ils touchoient
toutes leurs cordes à vide. (V o y e z cependant les
Entretiens fur la mufique des Grecs, ubi fupra.
V o y e z auflï Ptolémée , liv. I l , ch. 16.)
Paffons maintenant à l’examen des principaux fyf-
têmes de mufique des Anciens, & des inllrumens
qui les repréfentoient.
i ° . Je ne m’ arrêterai point au monocorde, que les
Anciens appeloienc encore Pkandure 3c Canon {voyez
Nichomaque, pag. 8. ) Les théoriciens s’en fervoient
pour y chercher les rapports des intervalles j les accordeurs
d’inftrumens ne pouvoiene s’en paffer que
dans les genres ou les couleurs qui pouvoient s’accorder
par quartes Sc par quintes ; mais le monocorde
ne paroît pas avoir été chez les Anciens un
inftrument de pratique.
z ° . Les plus fimples de tous les inftrumçns def-
tinés, chez.les Anciens , a l’exécution, font le di-
'corde , dont St. Clément Alex. Strqm. liv. / , attribue
l’invention aux Affyriens , & la peftis à deux
cordes, dont parle Sopater dans A thénée, liv. IV ,
p. 183. O r , qu’on demande à quelque, muficien que
ce foit, quel peut avoir été l’ufage d’un inflrument à
deux cordes touchées à vide \ il vous répondra qu’un
inftrument de cette efpèce ne peut faire que l’cfficô
de deux timbales , fous un chant qui refte confia aiment
dan£ un feul & même mode. O r , deux timbales
s’accordent à la quarte Tune de d’autre : elles
repréf-ntent donc la baffe fondamentale par quarte
du chant qu'elles accompagnent. Quelle étoit la formule
de ch an t, h gamme, le fyftême mélodique
des Anciens avant Terpandre ? Le tétracorde , feuj
ou conjoint. (V o y e z le Mémoire de M. L. Roujfitr,
p. i©8. ) Une feule quarte pourroit - elle faire la
baffe du fyftême conjoint ? Non , car puifque f i ut
re mi eft le produit de la baffe fondamentale fo l ut,
fo l ut y qui eft eu u t , mi fa fol La doit être celui
d e là baffe, fondamentale, ut fa ut f a , qui eft en
fujSc la fi}} ut re 3 celui de fa fik fa fi b , qui eft
en fi}}. Donc une feule quarte ne peut repréfentet
que la baffe fondamentale d’un feul tétracqr.de ÿ donc,
lors de l’invention du dicorde, le fyftême mélodique
des Anciens n’étoic encore compofé que d’un feul
tétracorde 5 donc la lyre de Mercure fut un fiojple
tétracorde diatonique. O r , l’heptacorde répondoit
aux notes modernes mi fa fo l la f iV ut reK (V o y e z
ci-deffus , n°. X X I .) 11 écoit donc compofé de deux
tétracordes, l’un en fa , l’autre en fi}}. Oc, fi}} étant
la génération de fa , nous devons , dans l’ordre des
temps , placer naturellement le tétracorde en f i b
avant le tétracorde en fa. Il eft donc vraifcmblable
que l’accord de la lyre diatonique de Mercure fut
la f i }} ut re y & l’un de fes accompagnemens , fa fi 9
fa y? b. Donc vraifemblablement fa [i b fut l ’accord
de la petits 3c du di corde.
30. Quelques auteurs ne donnent à la lyre de
Mercure que quatre cordes ( voyez le Mémoire de
M . L. Roujfitr, p. 108 ; voyez auflï les monumens
rapportés dans le Dialogue fur la mufique des
Grecs ) y & les uns accordent diatoniquement cëcte
ly re , les autres fymphoniquement. (V o y e z leMém.
déjà cité, ibid. ) Il n’y a point là de contradiction 3
car nommant là f i b ut re les cordes de la lyre diatonique
de Mercure, il ne s’agit que de trouver une
lyre à quatre cordes, qui puiffe lui fervir d’accompagnement
y nous allons prendre pour ce la , dans
Athénée, liv. IV ", p. 183 , la grande fcyndapfe a
quatre cordes ,. femblable a une lyre , & nous aurons
bien réellement deux lyres à quatre cordes, une
grande & une petite 5 une lyre de chant & une lyre
d’accompagnement > une lyre & une baJJ'e de lyre.
[/accord de cette baffe , nous le trouvons dans
Boëce , qui donne à Mercure une lyte dont l’accord
eft o d a v e , quinte Sc quarte, & point de diffonnance»
.Nil vero in eis ejfet inconfonum. ( V o y e z le paffage
entier dansmes obfervations fur leMém. de M . L.R.
art.' Grecss n°. 1. ) Boëce, ignorant l’harmonie ;
B o ë ce , vivant plus de zoqq ans après Mercure,
plus de 900 ans après Pythagore j Boéce , voyant
dans la baffe.de l’oda corde, ut fa fo l ut, ces mêmes
confonnances d’oda ve , de quinte & de quarte, que
la tradition attribuoit à la lyre de Mercure ; Boëce a
bien pu confondre &: a réellement confondu l’accompagnement
du fyftême diatonique de Pythagore avec
l’accompagnement du fyftême diatonique de Mercure,
la baffe de Pythagore avec celle de Mercure ; mais la
tradition que nous a confervée Boëce nous fuffic pour
le redreffer. Octave, quinte 6* quarte, & point de dif-
fonnance, voilà 1^, tradition. Donc ut fa fol ut n’eft pas
l’accord en queftion 3 car fa. fo l eft une dillonnance,
dans les principes mêmes de Bcëce. (V o y e z mes
obfervations fur ce paffage , loc. cit. ) Il n’y a d’a illeurs
plus à douter, d’après i’exiftencc du dicorde,
que le tétracorde n’ait été le fyftême diatonique de
Mercure. O r , ut fa fo lu t ne peut être la. baffe du
tétracorde : donc ut fa fo l ut n’eft pas la baffe de
Mercure.
Mais enfin la baffe de Mercure doit fatisfaire à ces
trois données , . doit réunir çes trois caradères :
i ° . être formée d’o d a v e , de quinte & de quarte j
z°. ne renfermer aucune diffonnance >3°. faire l’accompagnement
du chant la fi}} uc re. O r , l’accord
fi\} fib fa fib remplit ces trois conditions; car ut ut fol.
ut, i , z, 3,4, eft non-feulement l’ordre le plus naturel J
& le plus confonnant qu’on puiflè donner aux inter- j
vâlles d’oétave, de quinte & de quarte , mais il forme
l’accord le plus confonnanr que puiffent produite
trois intervalles quelconques réunis. ( V o y ez mes art.
Baffe fond. 3c Cornet. ) Ut ut fo l ut eft en outre la
baffe fondamentale la plus naturelle du chant f i ut
re mi. ( Voyez, mon art. Baffe fond. n°. IV . ) O r , la
baffe fi\} fi b fa fi}} eft au chant la f i b ut re, comme
uc ut fo l ut eft à f i ut re mi. Donc fi}} fi)} fa f i k
fatisfait aux conditions du problème'. A ces convenances
ajoutez encore que l’accord fi b fi}} fa fi}},
% ï, 1 , j, 4,
repréfente le premier quaternaire de Pythagore.
(V o y e z Tkéon, pag. 146. ) Donc f i b fi}} fa fi]}
repréfente l’accord de la lyre fymphonique de
Mercure.
4°. Au fimple tétracorde dut naturellement fuc-
céder le fyftême conjoint, mi fa fo l la f i b ut re y
qui fut l’accord de l’inftrument que les Grecs pof-
terreurs à Pythagore nommèrent l'ancienne lyre, p^r
oppofition à la lyre odacorde, mais qu’à Sparte on
nommoit cythare. Or , puifque la quarte fa fi^ tH la
baffe fondamentale du tétracorde lafiV ut re, il eft évident
que les quartes conjointes, ut fa f i 1», forment la
baffe des tétracordes conjoints, mi fa fo l la f i b ut rej
& cet accord, ut fa fi}} , nous le ferons porter au bar-
ihon à trois cordes dont fait mention Anaxilas dans
A'hénée , liv. IV, p. 183. E t voilà- cette lyre à trois
cordes dont parle M . L . R. , p. 139. (V o y e z auflï
la même lyre dans' le Dialogue fur la mufique des
Anciens, ubi fupra. )
j ° . La dernière combinaifon des tétracordes fut
celle de Pythagore , qui donna le fyftême disjoint,
mi fa folia fi ut re m i (y oy.ez Nichom. pag. 13, &c.),
Mufique. Tome I.
dont 0 baffe fut ut fa fo l u t , car puifque fa fi V
6, 8 , 9, i t ,
eft une des baffes du tétracorde la fi}> ut re, donc les
quartes disjointes ut fa , fo l ut, doivent être la baffe
des tétracordes disjoints mi fa fo l la , f i ut re mi.
L’accord fi}} f i V fa f i b de la fcyndapfe fut donc
changé du temps de Pythagore en celui de ut fa fo l u%
dans lequel on trouve les mêmes confonnances d’octa
v e , de quinte & de quarte ,.que dans l ’ancien accord
fi^9 fi b fa fi\}. O r , même inftrument, même
conformance j voilà la fource de l’erreur que je vienx
de relever dans Boëce.
6°. L e fyftême de Terpandre, mi fa fo l la ut rc
mi, ne préfente aucune difficulté, ni pour le claffer,
ni pour raccompagner. En retranchant le fi\ de
l’ancienne ly re , & y ajoutant un mi à l’aigu , pour
le renfermer dans la confonnancc du diapa fon,
fans en augmenter le nombre des cordes , on ob-,
tient un chant fufceptible des trois accompagnemens
dent nous venons de parler 5 car fi l’on fuppofe
que les notes ut re mi font partie du tétracorde f i
ut re m i, le fyftême de Terpandre pourra s’accompagner
de la baffe de l’oétacorde mi fa fo l Iq f i
ut re mi : fi on les fuppofe appartenir au tétracorde
ut f e mi f a , tout le fyftême de Terpandre fera
en fa , & pourra s’accompagner, ou de la baffe
'fa fa ut fa , . j , z , 3 , 4 , ou de la baffe ut fa ut
f a , 3, 4 , j , 4. ,S i enfin l’on fait dériver les
«notes la ut re du tétracorde la fi b ut re, l'accompagnement
du fyftême de Terpandre fera le même
que celui du fyftême conjoint mi fa fo l la fi}} ut re.
Tels font probablement les avantages que T e r pandre
fe flatta auprès des prêtres égyptiens d’avoir
procuré au fyftême grec. ( V o y e z Nichoma-~
que , pag. z $ .) Mais nous n’avons rien de certain
à cet égard. Rien ne nous oblige même à chercher
une baffe au fyftême de Terpandre , parce
que rien ne nous fait juger que ce raufîcien eût
les conooiffances d ’harmonie que nous fommes fondés
à attribuer à Mercure & à Pythagore.
7 0. J en dis autant du fyftême d’ io n , ut re mi fa .
fo l ia f i ut re m i, que ce mufïcien partageoit ca
trois odlaves, ut re mi fa fo l la f i ut ; re mi fa fol
la f i "ut re y & mi fa fo l la f i ut re mi. (V o y e z Eu-
clide, pag 19 .) Dès-lors il abandonnoit la parti-,
don du fyftême grec^par tétracordes. IJ n’étpit donc
pas de la fede de Pythagore. Rien ne nous prouve
donc qu’il ait eu connoiflance de fharràonie ni delà
baffe fondamentale.
Quant à Mercure, à A p o llon , que je regarde
comme auteurs de la cythare lacédémonienne-, & à
Pythagore, on ne peut leur refufer la connoiffance &
l’ufage d’ une baffe fondamentale plus complète que
celle de Rameau. puifqu’ils faifoiênt ufage du mouvement
fondamental d^odave inconnu à l’harmoniftc
moderne. Leur harmonie étoit av.flï plus complète,
plus régulière, plus dbuce que celle de Rameau. Mo-
l défié, ergo de tamis viris pronuntiandum efi,
A a a a a