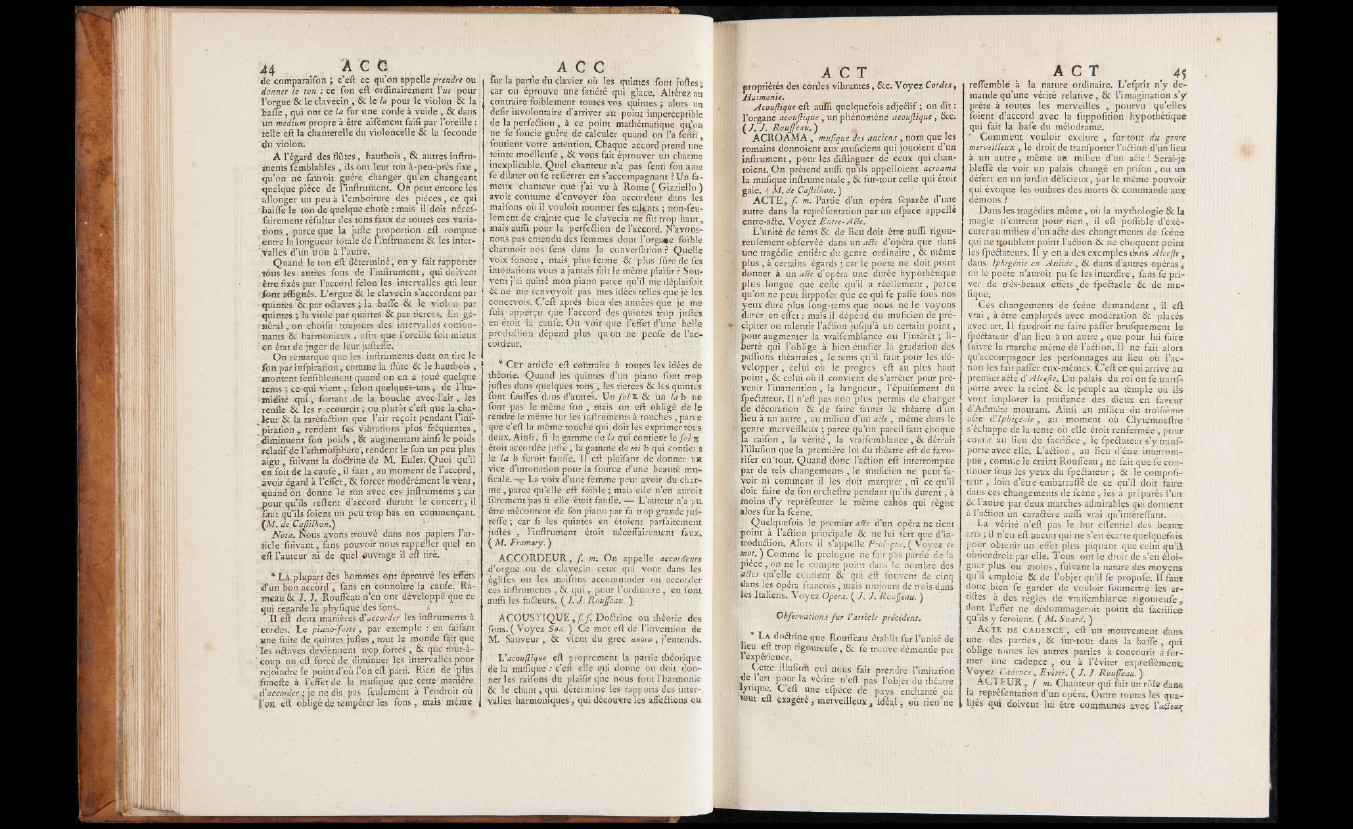
44 A C G
de comparaifon ; c’eft ce qu’on appelle prendre ou
donner le ton : ce fon eft ordinairement Vut polir
l’orgue & le clavecin , & le la pour le violon 8c la
baffe, qui ont ce la fur une corde à vuide , & dans
un medium propre à être aifément faifi par l’oreille :
telle eff la chanterelle du violoncelle 8c la fécondé
du violon.
A l’égard des flûtes, hautbois, & autres inftru-
ments Semblables , ils ont leur ton à-peu-près fixe ,
qu’on ne fauroit guère chàngër qu’en changeant
quelque pièce de l’inArumcnt. Oii peut encore les
allonger un peu à Temboîture des pièces , ce qui
baifîe le ton de quelque choie ; mais if doit nécessairement
réfulter des tons faux de toutes ces variations
, parce que la jufte proportion eft rompue
| entre la longueur ïotàle de l’ihffruinent 6c les intervalles
d’un trou à Tâütfey >
Quand le ton e*ft dêtërmiiiê^on'ÿ' fait tappèrtër
tous les autres fons de Tinftrument, qui doitent
i être fixés par l’accord félon les intervalles qui leur
font affîgaés. L’orgue & le clavecin s’accordent par
• quintes 6c par oélaves; la ;ba’ffe 6c - le violon: par
• quintes > la viole par quartes 6c par tierces. En général,
on choisit - toùjoiirs'des'. intervalles eonfon-
' nants 6c harmonieux , afin que l’oreille foit mieux
en état de juger de léur. jufteffe..
On remarque que les inftrüments dont on tire le ?
fon par infpiration, comme la flûte & le hautbois ,
montent fenfiblement quand on en a joué quelque
tems ; ce qui vient,: folon quelques-uns » de l’nu-
tnidïtè qui, Sortant de: la bouche avec l’air * les.
renfle 6c les raccourcit ^ ou plutôt e’eft que lacha-;
leur & la raréfadion que* l’air reçoit pendant l’inf-
piratjôn , rendent fes vibra tiofis 'plus ’ fréquentes ,
diminuent fon poids , & augmentant ainfi le poids
relatif de lathmofphèré, rendent le fon un peu plus
aigu , Suivant la 'doârinè de M. Euler. Quoi qu’il j
en foit de lacaufe , il.faut J au moment de l’accprd,
avoir égard à l’effet, & forcer modérément le vbnt
iqùa'nd on donne lé ton aVec cës- jnftruments ; car ;
pour qu’ils rèffent d’accord dürafft le concert, il
faut qu’ils Soient un peü trop bas en commençant.
([#ƒ. de Çqflilhon f)
Nota. Nous avons trouvé dans nos papiersTar-
ticle fuivant j fans pouvoir nous rappeîler quël en
«À l’auteur ni de quel Ouvrage il eff tiré..
* La plupart des hommes ©fit éprouvé les effets i
d’un bon accord , fans en cO’nnoître la eàufe. Rà- ,
meàu $c J. L :Kouffe^u n’ê'n ont développé que ce •
qui regarde Iè phyfique'des fions., *
Il eff deux manières S'accorder les înflruments à .
cordes. Le piano-forte , par exemple : en faifant
«ne fuite de quintes, juftes, tout le monde fait que
lès Graves., deyiènnent trop fortëé , &qùéfoüt-à-
coup oneff ïpreé de. .dtimhiiër lés ihtèmlles'pbùr •
rejoindre Te point d’ôù l’on eff parti. Rien de plus
fùnefte à l’effet de la mufiqiie que cette niàmère
d'accorder ; je ne dis pas feulement à l’epdrdit où .
çft obligé de. tempérer îè.s fons, mais même: j
a c c
fur la pattîe du clavier où les quintes font juftes ;
car on éprouve une fatiétê qui glace. Altérez au
contraire foiblement toutes vos quintes ; alors un
defir involontaire d’arriver au point imperceptible
de la perfeélion , à ce point mathématique qiipn
ne fe foucie guère de calculer quand on l’a tend ,
Soutientvotre attention. Chaque accord prend une
teinte moëlleufe , 8c vous fait éprouver un charme
inexplicable. Quel chanteur n’a pas fenti fon ame
fe dilater ou fe refférrer en s’accompagnant ?Un fameux
chanteur que j’ai vu à Rome ( Gizziello )
avoit coutume d’envoyer fon accordeur dans les
maifons où il voulpit montrer fes talents ; non-feulement
de crainte que le clavecin ne fut trop haut *
Biais auffi pour la perfèéiion de l’accord. Nayons-
noüS pas ëntendu des femmes dont l’orgaâe foible
chàrmôit nos'féns dans la converfation ? Quelle
voix Sonore , mais plus ferme 6c plus fûre de fes
intonations‘vous a jamais fait le même plaifîr ? Souvent
j’ai quitte mon piano parce qu’il me déplaifoit
6c ne me renvoyoit pas mes idées telles que je les
concevpis. C ’eff après bien des années que je me
fuis appërÇu que l’accord des quintes trop juftes
en êtôit l’a eaüfe. On :vôit: que l’effet d’une belle
production dépend plus qu on ne penfe de l’ac*
cordéur. • ' ;
* Cet article eff cohtraîre à toutes les idées de
théorie. Quand lés quintes d’un piano font trop
juftes dans quelques tons , les tierces 6c les quintes
font' fauffës "dans d’autres.' Un fo l £ 8c un la b ne
font pas le même fon , mais on eff obligé de le
rèndré le même fur les inftrumëms à touchés, parce
que c’eft la mêmetouthequi dôitles exprimer tous,
deux. Ainfi, fi la gamme de -l<z qui contient le fol g
étoit accordée jufte , la' gamme de mi b qui confiera
le la b feroit fauffe. 11 eff plaifant de donner ua
vice d’intonation pour la fource d’une beauté mu-
ficale. -x- La voix d’ünè femme peut avoir du charme
, parce qu’elle eff félble; mais elle n’en aùroit
furementpas fi elle 'étoit fauffe/--- L’auteur n’a pu
être mécontent dé fon piano par fa trop grande juf-
teffe ; car fi les quintes en étoient parfaitement
yùffes , rinftfument étoit néceffairement faux»,
f M. Framery. ).
ACCORDEU R , ƒ. m. On appelle accordeurs-
d’orgue ou de clavecin ceux qui vont dans les
egliles ou les. maifons accommoder ou accorder
ces inflruments , 6c qui „pour l’ordinaire , en. font
auffi les fadeurs. ^ J. J. Roujfcau y
A CO U S T IQ U E , f . f i Doéîrine ou théorie des
fons. ( Voyez Son. ) Ce mot eff de l’invention dé.
M. Sauveur, 6c vient du grec «»<»*>, j’èntends.
L’acouflique eff proprement la partie théorique:
dé la mufiqtie •* e’eff elle qui donne ou doit donner
lés raifons du plaifir qne nous font l’harmonie.-
6c le chant, qui détêrrninè les rapports des inter-,
vaUes. harmoniques, qui découvre les affedions. on*:
a c T
•p propriétés des cordes vibrantes, 6cc. Voyez Cordes 9
Harmonie.
Acouflique eff auffi quelquefois adjedif ; on dit :
l ’organe acouflique , un phénomène acouflique , 6ce.
f ï ( J. J. Rouffeau. ) jà
II A CR OAMA , muflque des anciens , nom que les
||| romains donnoient aux muficiens qui jouaient d’un
« infiniment, pour les diftinguer de ceux qui changé
toient. On prétend auffi qu ils appelloient acroama
| la mufique inflrumentale, 6c fur-tout celle qui étoit
|| gaie. ( M. de Caflïlhon. )
A C T E , f . m. Partie d’un opéra féparée d’une
§f autre dans la repréfentation par un efpace appell«
entre-ade. Vo yez Entre- ARe.
L ’unité de tems & de lieu doit être auffi rigou-
ïjÊt réufement obfervée dans un acte d’opéra que dans
•*|| line tragédie entière du genre ordinaire , & même
H plus , à certains égards ; car le poète ne doit point
M donner à un a&e d’opéra une durée hypothétique
plus longue quë celle qu’il a réellement, parce
qu’on ne peut fuppofer que ce qui fe paffe fous nos
III yeux dure plus long-tems que nous ne le voyons
fJI durer en effet : mais il dépend du muficien de pré-
m| cïpiter ou ralentir l’adion jufqu’à un certain point,
• pour augmenter la vraifemblance ou l’intérêt ; li-
berté qui l’oblige à bien étudier la gradation des
> paffions théâtrales , le tems qu’il faut pour les 'développer
, celui où le progrès eff au plus haut
H point, 8c celui où il convient de s’arrêter pouf prè-
® Venir l’inattention , la langueur, l’épuifement du
; fpeélateur. Il n’eff pas non plus permis de changer s
de décoration 6c de faire fauter le théâtre d’un
|1 lieu à un autre , au milieu d’un aSlt, même dans le
f f genre merveilleux ; parce qu’un pareil faut choque
la raifon , la vérité, la vraifemblance , 6c détruit
Tillufion que la première loi du théâtre eff de favo-
rifer en'tout. Quand donc l’aélion eff interrompue
par de tels changements , le muficien ne peut fa-
voir ni comment il les doit marquer, ni ce qu’il
doit faire de. fon orcheffre pendant qu’ils durent, à
moins d’y repréfenter le même cahos qui règne
(M alors fur la fcëne»
t Quelquefois le premier aSe d’un opéra ne tient
|| point à l’aélion principale 8c ne lui fert que d’in-
m troduélion. Alors il s’appelle Prologue. ( Voyez ce
H *not. y Comme le prologue ne fait p^s partie de la
pièce , on ne le compte point dans le nombre des
% a&es quelle contient 8c qui eff fouvent de cinq
| dans les opéra francois , mais toujours de trois dans
les Italiens. Voyez Opéra. ( J, J. Rouffeau. f
Obfcrvatïons fur Carticle précèdent.
* L a doélrine que Rouffeau établit for l’unité de
. lieu eff trop rigoureufe, 8c fe trouve démentie par
,/yi expérience.
i V>ette qu3 noils fait prendre rimitatîon
45^e . art P°5ur vérité n’eff pas l’objet du théâtre
^Aynque. C efl une efpèce de. pays enchanté où
tout eff exagéré, merveilleux, idéal, ©u rien'ne
A C T
reflemble à la nature ordinaire. L’efprit n’y demande
qu’une vérité relative, 8c l’imagination s'y
prête à toutes les merveilles , pourvu qu’elles
loient d’accord avec la foppofition hypothétique
qui fait la bafe du mélodrame.
* Comment vouloir exclure , fur-tout du genre
merveilleux , le droit de tranfporter l’aélion d’un lieu
à un autre, même am milieu d’un aâe ! Serai-je
blefle de voir un. palais changé en prifon , ou un
défert en un jardin délicieux, par le même pouvoir
qui évoque les ombres des morts 8c commande aux
démons ?
. Dans les tragédies même, où la mythologie 8c la
magie n’entrent pour rien, il eff poflible d’exécuter
au milieu d’un aéte des changements de fcène
qui ne tgôublent point l’aélion 8c ne choquent point
les fpeélateurs. 11 y en a des exemples d«ns Alcefle,
dans Iphigénie en Aulide , 8c dans d’autres opéras ,
où le poète n’auroit pu fe les interdire, fans fe priver
de très-beaux effets tde fpeéiacle 8c de mufique.
Ces changements de fcène demandent , il efl
v ra i, à être employés avec modération 8c placés
avec art. Il faudroit ne faire paffer brufquement le
fpèéiateur d’un lieu à un autre , que pour lui faire
fùivre la marche même de l’aâion. Il ne fait alors
qu’accompagner les perfonnages au lieu où l’action
les fait paffer eux-mêmes, C ’eft ce qui arrive au
premier.aâ:e d'Alcefle. Du palais du roi on fe transporte
avec la reine 8c le peuple au temple où ils
vont implorer la puiffance des dieux en faveur
d Admète mourant. Ainfi au milieu du troifième
aéte à'Iphigé/ n e , au moment où Clytemneftre -
s’échappe de la tente où elle étoit renfermée , pour
courir au lieu du Sacrifice-, le fpeéfatenr s’y transporte
avec elle. L’aélion, au lieu d’être interrompue
, comme le craint Rouff eau, ne fait que fe continuer
fous les yeux du fpeétateur , 8c le compofi-
-teur , loin d’être embarraffê de ce qu’il doit faire
dans ces changements de fcène , les a préparés l’un
6c l’autre par deux marches admirables qui donnent
à l’aétion un caraélère auffi vrai qu’intêreffant.
La vérité n’eff pas le but effentiel des beaux
arts ; U n’en eff aucun qui ne s’en écarte quelquefois
pour obtenir un effet plus piquant que celui qu’il
obtiendroit par elle. Tous ont le droit de s’en éloigner
plus ou moins , foivant la nature des moyens
qu’il emploie 8c de l’objet qu’il fe propofe. Il faut
donc bien fe garder de vouloir foumettre les ar-
tiftes à des. règles de vraifemblance rigoureufe 9
dont Teftèt ne dédommageroit point du facrifice
qu’ils y feroient, ( M. Suard. y
A cte de. cadencé , eff un mouvement dans
une des parties,. 8c fur-tout dans la baffe,, qui
oblige toutes l;es autres parties à concourir à former
une cadence , ou à l ’éviter expreffémentz
Voyez Cadence, Eviter. ( J. J. Rouffeau. y
A C T EU R , f m. Chanteur qui fait un rôle dans
la représentation d’un opéra. Outre toutes les qualités
qui doivent lui être communes av ec VaRaar