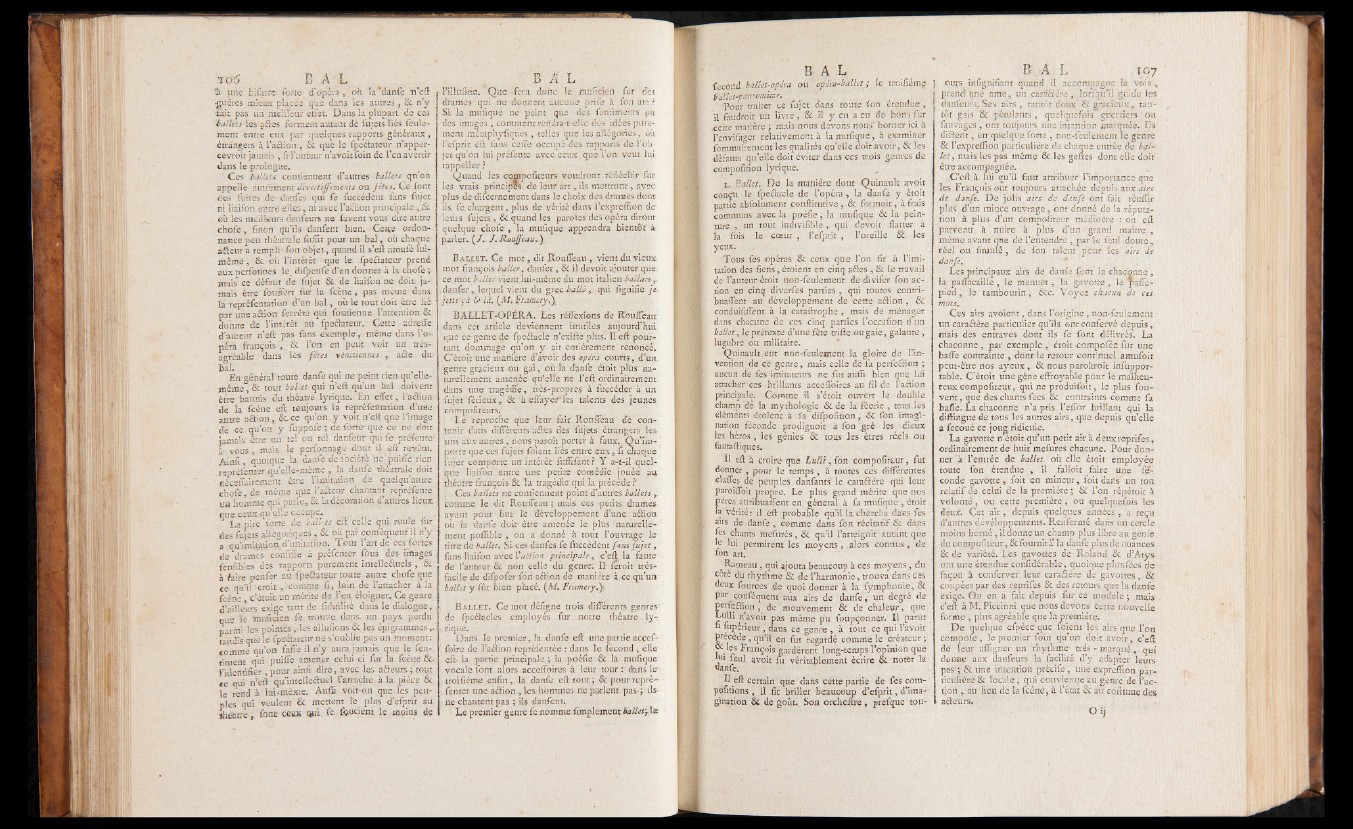
ï o6 B A L
& une bifarre forte d’opéra, /où, Ta^danfè u ’eft
•güères mieux placée que dans les autres , & n’y
•fait: pas un meilleur effet. Dans la plupart de ces
ballets les a&es forment autant dè fil jets liés feulement
entre eux par quelques rapports généraux,
étrangers à l ’action:; & que le fpe&ateur n’apper-
eevroit jamais , fi l’auteur n’avoitfoin de L’en avertir
dans le prologue.
Ces ballets contiennent d’autres ballets qn’on
appelle autrement divertiffements ou fêtes. Ce font-
ces fuites de danfes. qui fe fiiccèdent fans fujet
ni liaifon entre elles„ ni avec l’aélion principale ,.8c
où les meilleurs danfeurs ne Lavent vous dire autre
chofe, Linon qu’ils danfent bien. Cet-;e Ordonnance
peu théâtrale fiiffit pour un b a l, où chaque
aéleur a rempli fon objet, quand il s’eft amufé lui-
même , 8c où l’intérêt' que le fpeclateur prend
aux perforiries le, difpenfe d’en donner à la choie ;
mais ce défaut de fujet- & de liaifon ne doit ja-
être fouffert fur la f c è n e p a s même dans
fci repréfentation d’un b a l, où le tout doit être lié: ;
par une a&iorr fecrète qui foutienne l’attention 8c.
donne de l’intérêt au fpe&ateur. Cette adreffe-
d’auteur n’eft pas fans exemple ,• même dans l’o-
ttéra françois , & l’on en peut voir un très*
agréable dans les fêtes vénitiennes aûe du;
' & . ' _ . ' -, • . v „
En-général toute damé qui ne peint rien qu elle-
même, & tout ballet qui ii’eft qu’un bal doivent
être bannis du théâtre lyrique. En effet, l’aélion
de la fcène eft toujours la repréfentation d’uae
autre action , 8c.ce qu’on, y v o itn ’eft que l’image
de ce qu’on y fnppofe ; de forte- que ce ne doit
jamais' être un tel ou tel danLèur qui fe-préfente-'
à .v o u s , mais le perfonnage dont il -eft revêtu.
Ainfx, quoique la danfe de fociété ne puiffe rien
représenter qu’elle-même , la danfe théâtrale doit
néceffairement être limitation de quelqu’autre
chofe, de même que l’acteur chantant repréfente
un homme qui parle, 8c la décoration d’autres lieux
que ceux-qu’elle occupe.. , # .
La pire forte de b.alU.ts eit celle qui roule fur
des Sujets allégoriques , 8c oii par conféquent il n’y"
a qu’imi&tion, d’imitation. Tout l’art de ces fortes,
de drames conflite à préfènter fous des images
fenfib’es des rapports purement intelleduels , &
à faire- penfer au fpedateur toute autre chofe que
ce qu’il'croit jJcomme û , loin de l’attacher à la
fcène c?étoit. un mérite de l’en éloigner. Ce genre
d’ailleurs exige tant de Lîibtiiité dans le dialogue,
que le 'îmificien fe trouve, dans, un pays perdu
parmi les pointes,. les allufions 8c les épigrammes,.
tandis que le fpedateur ne s’oublie pas un moment:
comme qu’on faffe il n’y aura jamais que le fe,n-,
timent qui puiffe amener celui-ci fur la fc.ène &,
l’identifier , pour ainfi dire, avec les adeurs-; toyt
ce qui’ n’eft qu’inteîleduel L’arrache, à la pièce &
le rend à, lui-même. Aufû voit-on quelles peuples
qui veulent & mettent le plus d’efprit ait
shéatre, font ceux qui fe. fondent le moins de
U A L
Fillufîdn. "Que fera donc le muffcîen fur" des
drames qui ne-donnent aucune prife à fon art?.
Si la mufique ne peint que des femiments pu
des images , comment rendra-t-elle des idées pure--
ment .mérapliyfiques , -telles que les allégories, où
l’efprit eff fans ceffe occupé dés. rapports de-l’objet
qu’on lui préfente avec ceux que l’on, veut lui
- rappeiler? •
Quand les composteurs voudront réfléchir fur
les vrais principes de leur' a rt, ils mettront, avec
plus de discernement dans le choix des drames dont
ils fe. chargent , plus de vérité dans l’expreffion de-
leurs fujets , & quand les paroles des opéra diront
quelque chofe , la mufique apprendra bientof à
parler., ( ƒ . J. RouffeauJ)
Ballet. Ce mot, dit Kouffeau, vient du vieux;
mot françois haller, danfer, 8c il devoit ajouter que
ce mot b+ller vient lui-inême du mot italien ballare
. danfer lequel vient du g r c c b a l lô qui lignifie je-
jette çà & là. (Af. Framery.'f
BALLET-OPÉRA. Les réflexions de R’oufféair
dans cet article deviennent inutiles - aujourd’hui
que ce genre de fpeâacle n’exiffe plus. Il eft pourtant
dommage qu’on y ait entièrement renoncé.
C ’étoit une manière d’avoir des opéra courts , d ’ùn
genre gracieux ou gai, où la danfe êioit plus" naturellement
amenée quJene ne l’eft ordinairement
dans une tragédie, ; très-propres à fuccéder à un
fujet férieiixy 8c à effayerTes talents des jeunes
compofiteurs.
Le réproche que leur fait Rouflëau de contenir
dans différents aébes dès fujets étrangers les
uns aux autres , nous paroit porter à faux. Q u ’importe
que ces fujets foient liés entre eux, fi chaque
fujet comporte un intérêt fuififant ? Y a-t-il quelque
liaifon entre une petite comédie jouée au
théâtre françois & la tragédie qui la précède ?'
\ . Ces ballets ne contiennent point d’autres ballets,,
comme le dit Rcuffeau ; mais ces petits drames
ayant pour But- le 'développement d’une, adioh
où k danfe doit» être amenée lè plus naturellement
poflible , on a donné à tout l’ouvrage le -
titre de ballet. Si. ces danfes fe fuccèdent fans fu je t,
! fans liaifon avec Vaélion principale, c’eft la faute
de l’auteur 8c non celle du . genres II Leroit très-
facile de difpofer fon aéHan de manière à-ce,qu’un;
ballet y fût Bien pîkcé. (Ai. Framery.f.
Ballet. Ce mot défigne trois différents genres;
de fpedacles employés fur notre théâtre ly -
| rique. ,
Dans le premier, la danfè eft une partie acçef-
foire de l’a&ion repréfêntée : dans le fécond, elle
eft- la partie principale ; la poéfie & la mufique
vocale font alors acceffoires à leur tour : dans le
troifième enfin, la danfe eft tout ; & pour repré-
fenter une adion , les hommes ne parlent pas-;-; ils-
ne chantent pas ; ils danfent;
Le premier genre fe: nomme fimplement Hkllety las
B A L
fécond ballet-opéra ou. opéra-ballet ; le troifièmç
b'âllet-paniomime.
■ Pour traiter ce fujet dans toute fon étendue,
il faudroit un liv re , & il y en a eu de bons fur
cette matière ; mais nous devons nous' borner ici à
l’envifa^er relativement à la mufique, à examiner
fommairement les qualités qu’elle doit avoir, & les
défauts qu’elle doit éviter dans ces trois genres de
compofition lyrique.
i. Ballet. De la manière dont Quinault avoit
conçu, le fpedacle de l’opéra, la danfe y étoit
partie abfolument conftitutive, & formoit , à frais
communs avec la poéfie, la mufique & la peinture
, un tout indivifible » qui devoit flatter à
la fois le coeur , l’eLprit , l’oreille St les
yeux.
Tous fés opéras & ceux que l’on fit a l’imitation
des Liens, étoient en cinq ades , & le travail
de l’auteur étoit non-feulement de divifer fon ac-^
tion en cinq diverfes parties , qui toutes contri-
buaffent au développement de cette adion , &
coiiduififlent à la cataftrophe , mais de ménager
dans chacune de ces cinq parties l’oçcafion a’un
ballet, le prétexte d’une fête .trifte ougaie, galante ,
lugubre ou militaire.
Quinault. eut non-feulement la gloire de l’invention
de ce genre, mais celle dé fa perfedion ;
aucun de fes imitateurs ne fut aufli bien que lui
attacher' ces brillants acceffoires au fil de l’adion
principale. Comme il s’étoit ouvert le, double
champ 'dé la mythologie & de la féerie , tous les
éléments •■ 'étoient à La difpofition , & fon imagination
fécondé prodiguoit à fon gré les dieux
lés héros, les génies & tous le s êtres réels ou
fantaftiques.
Il eft à croire-que t u l l i , fon compofiteur, fut
donner , pour le temps , à toutes ces différentes
ciafles de peuples danfants' le caradère qui leur
paroiffoit propre. Le plus grand mérite que nos
pères attribuaffent en général à fa mufique , étoit
la vérité: il êft probable qu’il la chercha dans fes
a# de danfe , comme dans Lbn récitatif & dans
fes chants mefurés, & qu’il l’atteignit autant que
le lui permirent les moyens , alors connus, de
fon art.
a Rameau, qui ajouta beaucoup à ces moyens, du
coté du rhythme & de l’harmonie, trouva dans ces
deux fources de quoi donner à la .fymphonie, &
par coriféquenf aux airs de danfe, un degré de
perfedion , de mouvement & de chaleur, que
n’avoit pas même pu foupçonner. Il parut
h Liipérieur, dans cè genre , à tout ce qui l’avoit
précédé , qu’il en fut regardé comme le créateur ;
~Ves François gardèrent long-temps l’opinion que
avoit f i véritablement écrire & noter la
nanfe.
U eft certain que dans cette partie de fes compétitions
, il fit briller beaucoup d’efprit, d’imagination
Su de goût. Son orcheftre, prefque tou-
B Â L Î 07
| ours infignifiant quand il accompagne la v o ix ,
•prend une anxe, un cara'dère , lorfqu’Il guide les
danfeurs. Ses airs , tantôt doux & gracieux, tantôt
gais & pétulants, quelquefois guerriers'ou
fauyages , ont toujours une intention marquée. Ils
dident, en quelque forte , non-feulement le genre
& l’expreflion particulière de chaque entrée de ballet
, mais les pas même & les geftes dont elle doit
être accompagnée.
C ’eft à- lui qu’il faut attribuer l’importance que
les François ont toujours attachée depuis aux airs
de danfe. De jolis airs de danfe ont fait réuflir
plus' d’un mince ouvrage, -ont donné dé la réputation
à plus d’un compofitei:r médiocre : on eft
parvenu à nuire à plus d’un grand maître ,
même avant que de l ’entendre , par ie feul doute,
réel ou finjulê, de fon talent peur les airs de
danfè« '
Les principaux airs de danfe Lent la chaconne ,
la paffacaille, le menuet, la gavotte, le paffe-
pied, le tambourin , -Sec. Vo yez chacun de ces
mots.
Ces airs avoient, dans l’origine , non-feulement
un caradère particulier qu’ils ont confervé depuis,
mais des entraves dont ils fe font délivrés. La
chaconne, par exemple, étoit compoféé fur une
baffe contrainte , dont le retour continuel amufoit
peut-être nos ay eux , & nous paroîtroit infuppor-
table. C ’étoit une gêne effroyable pour lé malheureux
compofiteur, qui ne produifoit, le plus fou-
vent , que des chants fecs & contraints comme fa
baffe. La chaconne n’a pris l’effor brillant qui la
diftingue de tous les autres airs, que depuis qu’elle
a fecoué. ce joug ridicule.
La gavotte n etoit qu’un petit air à deux reprifes,
ordinairement de huit mefures chacuae. Pour donner
’à l’entrée de ballet où elle étoit employée
toute fon étendue , il falloit faire une féconde
gavotte, foit en mineur, foit darts un ton
relatif de celui de la première .; 8c l’on répétoit à
volonté, ou cette première, ou quelquefois les
deux. Cet air , depuis quelques années , a reçu
d’autres dévéloppements. Renfermé dans un cercle
moins borné, il donne un champ plus libre au génie
du compofiteur, 8c fournit a la danfe plus de nuances
8c de variété. Les gavottes de Roland 8c d’A tys
ont une étendue confidérable, quoique phrafées de
façon à conferver leur caraftère de gavottes, 8c
coupées par des reprifes 8c des retours que la danfe
exige. On en a fait depuis fur ce modèle ; mais
c’eft àM.Piccinnî que nous devons cette nouvelle
forme , plus agréable que la première.
De quelque efpèce que Loient les airs que l ’on
compote, le premier foin qu’on doit avoir, c’eft
dé leur afîigner un rhythme très - marqué, qui,
donne aux danfeurs la facilité d’y adapter leurs
pas ; 8c une intention précife, line expreflion particulière'
8c locale , qui convienne au genre de l’action
, au lieu de la fcène, à l’état 8cau ccftume des
afteurs.
O i j