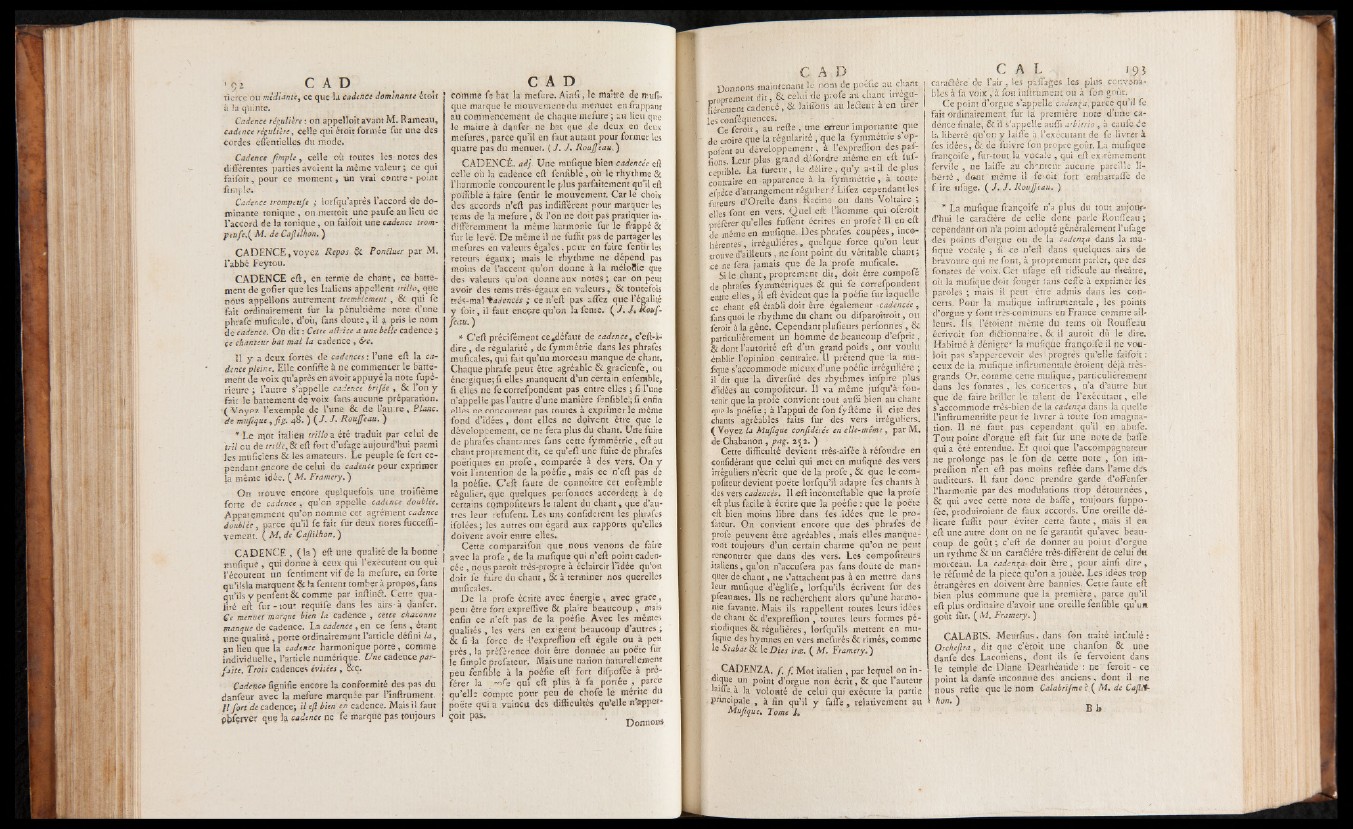
- 9.1 C A D
tierce ou mediante, ce que U cadence dominante étoit
à la quinte.
Cadence régulière : on appelloit avant M. Rameau,
cadence régulière, celle qui étoit formée fur une des
cordes éffentiellçs du mode.
Cadence fimple, celle où toutes les notes des
différentes parties avoient la même valeur ; ce qui
faifoit, pour ce moment, lin vrai contre - point
funple,
Cader.ce trompmfie ; lcrfqu’après l’accord de dominante
tonique , on mettoit une paufe au lieu de
l ’accord de la tonique, on faifoit une cadence trorn-
peufie.^ M. de Cajlilhon. )
C AD EN C E ,v o y e z Repos & Ponfluer par M.
l ’abbé Feytou.
CADENCE eft, en terme de chant, ce battes
ment de gofier que les Italiens appellent 'rillo, que
nous appelions autrement tremblement, 8c qui fe
fait ordinairement fur la pénultième note d’une
phrafe muficale, d’où, fans doute, il a pris le nom
de cadence. On dit ! Cette aftrice a une belle cadence ;
ce chanteur bat mal la cadence , &c.
11 y a deux fortes de cadences : l’une eft la cadence
pleine. Elle confifte à ne commencer le battement
de voix qu’après en avoir appuyé la note fupé-
rieure ; l’autre s’appelle cadence brïfte , & l’on y
fait le battement dç voix fans aucune préparation.
( Vo yez l ’exemple de l’une & de Uauire, Plane,
de mufique , f i g. 48. ) ( 7. 7. Roujfeau. )
* Le mot italien trillo a été traduit par celui de
)ril eu de trille, & eft fort d’ufage âujourdMrui parmi
les muficiens & les amateurs. Le peuple fe fert ce-
pendant.encore de celui de cadence pour exprimer
la même idée. ( M. Framery, )
On trouve encore quelquefois une troifième
forte de cadence , qu’en appelle cadence doublée.
Apparemment qu’on nomme cet agrément cadence
doublée, parce qu’il fe fait fur deux potes fuccefïi-
■ yement. ( Af. de Cajlilhon. )
C A D E N C E , ( la ) eft une qualité de la bonne
mufique , qui donne à ceux qui l’exécutent ou qui
l’écoutent un fentiment v if de la mefure, en forte
qu’ilsla marquent & la fentent tomber à propos, fans
qu’ils y penient & comme par inftinâ. Cette qua-
liré eft fur-tout requîfe dans les airs à danfer.
Ce menuet marque bien la cadence , cette chaconne
manque de cadence. La cadence , en ce fefls , étant
une qualité , porte ordinairement l’article défini la,
au lieu que la cadence harmonique porte , comme
individuelle, l’article numérique. Une cadence parfaite.
Trois cadences évitées , 8cc.
Cadette* fignifie encore la conformité des pas du
danfeur avec la mefure marquée par l’inftrument.
Jl fonde cadepce; il efl bien en cadence. Mais il faut
pbfçrver qpç lg cadence ne fe marqiié pas toujours
C A D
comme fe bat la mefure. Ainfi, le maître de nuifi-
que marque le mouvemenfrdu menuet en frappant
au commencement de chaque mefure ; au lieu que
le maître à danfer ne bat que ,dc deux en deux
mefures, parce qu’il en faut autant pour former les
quatre pas du menuet. ( 7. 7. Roujfeau.)
CADENCÉ, ad). Une mufique bien cadencée eft
celle où la cadence eft fenfible, où le rhythme 8c
l'harmonie concourent le plus parfaitement qu’il eft
poftible à faire fentir le mouvement. Car le choix
des accords nTeft pas indifférent pour marquer les
tems de la mefure, 8t l’on 11e doit pas pratiquer indifféremment
la même harmonie for le frappé &
fur le levé. De même il ne fuffit pas de partager les
mefures en valeurs égales. pour en faire fentir les
retours égaux ; mais le rhythme ne dépend pas
moins de l’accent qu’on donne à la méloBie que
des valeurs qu’on donne aux notes ; car on peut
avoir des tems très-égaux en valeurs, & toutefois
très-mal Cadencés ; ce n’eft pas affez que l’égaliçé
y foit, il faut encçre qu’on la fente. ( 7. /♦ Rouft
eau•)
* C ’eft précifément ee.défaut de cadence, c’eft-à-
dire , de régularité , de fymmétrie dans les phrafes
muficales, qui fait qu’un morceau manque de chant.
Chaque phrafe peut être agréable 8c gracieufe, ou
énergique; ft elles manquent d’un certain enfemble,
fi elles ne.fe correfpondent pas entre elles ; fi l’une
n’appelle pas l’autre d’une manière fenfible); fi enfin
elles ne concourent pas toutes à exprimer le même
fond dTdées, dont elles ne doivent être que le
développement, ce ne fera plus du chant. Une fuite
de phrafes chantantes fans cette fymmétrie, eft au
chant proprement dit, ce qu’eft une fuite de phrafes
poétiques en profe, comparée à des vers. On y
voit l’intention de la poéfie, mais ce n’eft pas de
la poéfie. C ’eft faute de connoître cet enfemble
régulier, que quelques perfonnes accordent à dç
certains cqmpofitewrs Je talent du chant, que d’autres
leur refufem. Les uns confiderent les phrafes
ifolées ; les autres ont égard aux rapports qu’elles
doivent avoir entre elles.
Cette comparaifon que ,nous venons de faire
avec la profe , de la mufique qui n’eft point cadencée
, nous paroît très-propre à éclaircir l’idée qu’on
doit fe faire du chant, $c à terminer nos querelles
muficales.
De la profè écrite avec énergie , avec grâce,
peut être fort expreflive & plaire beaucoup , mais
enfin ce n’eft pas de la poéfie. Avec les mêmes
qualités, les yers en exigent beaucoup d’autres ;
& fi 4a force de 4’expreflion eft égale ou à peu
près, la préférence doit être donnée au poète fur
le fimple profateur. Mais une nation naturellement
peu fenfible à la poéfie eft fort difpofée à préférer
la -ofe qui eft plus à fa portée , parce
qu’elle compte pour peu de chofe le mérite du
poète quia vaincu des difficultés qu’elle n>pper-
çoit pas.
Donnons
C A D
Donnons maintenant le nom de poéfie g | chant
proprement dit, & celai de profe au chant irrégulièrement
cadencé, & iaiffons au ledeur a en tuer
les conféquences.
Ce feroit, au refte , une erreur importante que
de croire que la régularité , que la fymmétrie s'opposent
au développement, à l’expreflîon des paillons.
Leur plus grand défordre même en eft lul-
ceptible. La fureur, le délire, qu’y a-til de plus
contraire en apparence à la fymmétrie, à toute
£{'pèce d’arrangement régulier ? Lifez cependant les
fureurs d’Orefte dans Racine ou dans Voltaire ;
elles font en vers. Quel eft l’homme qui oferoit
préférer qu’elles fuient écrites en profe ? 11 en eft
de même en mufique. Des phrafes coupées, incohérentes,
irrégulières „ quelque force qu’on leur
trouve cTgiUeurs, ne font point du véritable chant;
ce ne fera jamais que de la profe muficale.
Si le chant, proprement dit, doit être compofé
de phrafes fymmétriques & qui fe correfpondent
entre elles, il eft évident que la poéfie fur laquelle
ce chant eft établi doit être également cadencée ,
fans quoi le rhythme du chant ou difparoîtrolt, ou
feroit à la gène. Cependant plufieurs perfonnes , 8c
particuliérement un homme de beaucoup d’efprit,
& dont l’autorité eft d’un grand poids , ont voulu
établir l’opinion contraire. Il prétend que 4a mu-
iique s’accommode mieux d’une poéfie irrégulière ;
il dit que la diverfité des rhythmes iufpire plus
d’idées au compofiteur. Il va même jufqu’à fou-
tenir que la profe convient tout auffi bien au chant
que la poéfie ; à l’appui de fou fyftême il cite des
chants agréables faits fur des vers irréguliers.
( Voyez la Mufique confédérée en elle-même, par M.
de Chabanon , pag. 252. )
Cette difficulté devient très-aifée à réfoudre en
confidérant que celui qui met en mufique des vers
irréguliers n’écrit que de la profe, & que le compofiteur
devient poète lorfqu’il adapte fes chants à
des vers cadencés. Il eft inconteftable que la profe
eft plus facile à écrire que la poéfie : que le poète
eft bien moins libre dans fes-idées que le pro-
fateur. On convient encore que des phrafes de
profe peuvent être agréables , mais elles manqueront
toujours d’un certain charme qu’on ne peut
rencontrer que dans des vers. Les compofiteurs
italiens, qu’on n’ accufera pas fans douté de manquer
de chant, ne s’attachent pas à en mettre dans
leur mufique d’églife, lorfqu’ils écrivent fur des
pfeaumes. Ils ne recherchent alors qu’une harmonie
favante. Mais ils rappellent toutes leurs idées
de chant 8c d’expreflion , toutes leurs formes périodiques
8c régulières, lorfqu’ils mettent en mu-
fi.que des hymnes en vers mefurés & rimes, comme
le Stabat & le Dits iras. ( M. Framery.)
CADENZA. f i f i Mot italien , par lequel on indique
un point d’orgue non écrit, & que l’ auteur
laifle.à la volonté de celui riui exécute la partie
principale , à fin qu’il y faffe, relativement au
Mufique• Tome 1%
C A L 1 9 .Î
cara&ère de l’air, les paftages les plus convenables
à fa voix , à fon infiniment ou à fon goût.
Ce point d’orgue s’appelle caden^a, parce qu’il fe
fait ordinairement fur là première note d’une cadence
finale, 8c il s’appelle aufifi arbitrio , à ça Life de
la liberté qu’en y 1 aille à l’exécutant de fe livrer à
fes idées, 8c de fuivreTon propre goût. La mufique
françoife , fur-tout,la vocale , qui eft ex<-rêmement
fervile', ne laiïfe au ch-nteur aucune pareille liberté
, dont même il fe;oit' fort embàrraffè de
f ire tifage. ( 7. 7. Roujfeau. )
* La mufique françoife n’a plus du tout aujourd’hui
le caraâère de celle dont parle R.oufîeau ;
cependant on n’a point adopté généralement l’ufage
des points d’orgue ou de la. caden^a dans la mufique
vocale , 11 -ce n’eft dans quelques airs de
bravoure qui ne font, à proprement parler, que des
fonates de voix. Cet ufage eft ridicule au théâtre,
où la mufique doit fonger sans celle à exprimer les .
paroles; mais.il peut être admis dans les concerts.
Pour la mufique inftrumentale, les points
d’orgue y fout très-communs en France comme ailleurs.
Ils l’étoient même du tems où Roufleau
écrivoit fon diâionnaire, 8c il auroit dû le dire.
Habitué à dénigre’' la mufique françoife il ne vou-
loit pas s’appercevoir des ^progrès qu’elle faifoit:
ceux de la mufique iuftrumentàle étoient déjà très-
grands Or,comme cetie mufique, particuliérement
dans les fonates , les concertes , n’a d’autre but
que de faire briller le. talent de l’exéciitant, elle
s’accommode très-bien de la caden^a dans la quelle
l’inftrumentifte peut fe livrer à toute fon imagination.
Il né faut pas cependant qu’il en a bu fe.
Tout point d’orgue eft fait fur une note de baffe
qui a été entendue. Et quoi que l’accompaenateur
ne prolonge pas le fon de cette note , fon im-
prefiion n’en eft pas moins reftée dans l’ame dés
auditeurs. Il faut donc prendre garde d’offenfer
l’harmonie par des modulations trop détournées,
8c qui avec cette note de baffe, toujours fuppo-
fée, produiroient de faux accords. Une oreille délicate
fuffit pour éviter cette faute , mais il eu
eft une autre dont on ne fe garantit qu’avec beaucoup
de goût ; c’eft de donner au point d’orgue
un rythme 8c un caraéïêre très-différent de celui du
morceau. La caden%a> doit être , pour ainfi dire,
le réfumé de la piece. qu’on a jouée. Les idées trop
étrangères en doivent être bannies. Cette faute eft
bien plus commune que la première, parce qu’il
eft plus ordinaire d’avoir une oreille fenfible qu’un
goût fur. (AL Framery.)
CALABIS. Meurfius, dans fon traité inttulé :
Orch.eflra, dit que c’étoit une chanfon 8c une
danfe des Laconiens, dont Us fé fervoient dans
le temple de Diane Dearhéatide : ne feroit - ce
point la danfe inconnue des anciens , dont il ne
nous refte que le nom Calabrifme ?.( Af. de CaflO-
hem. )
B b