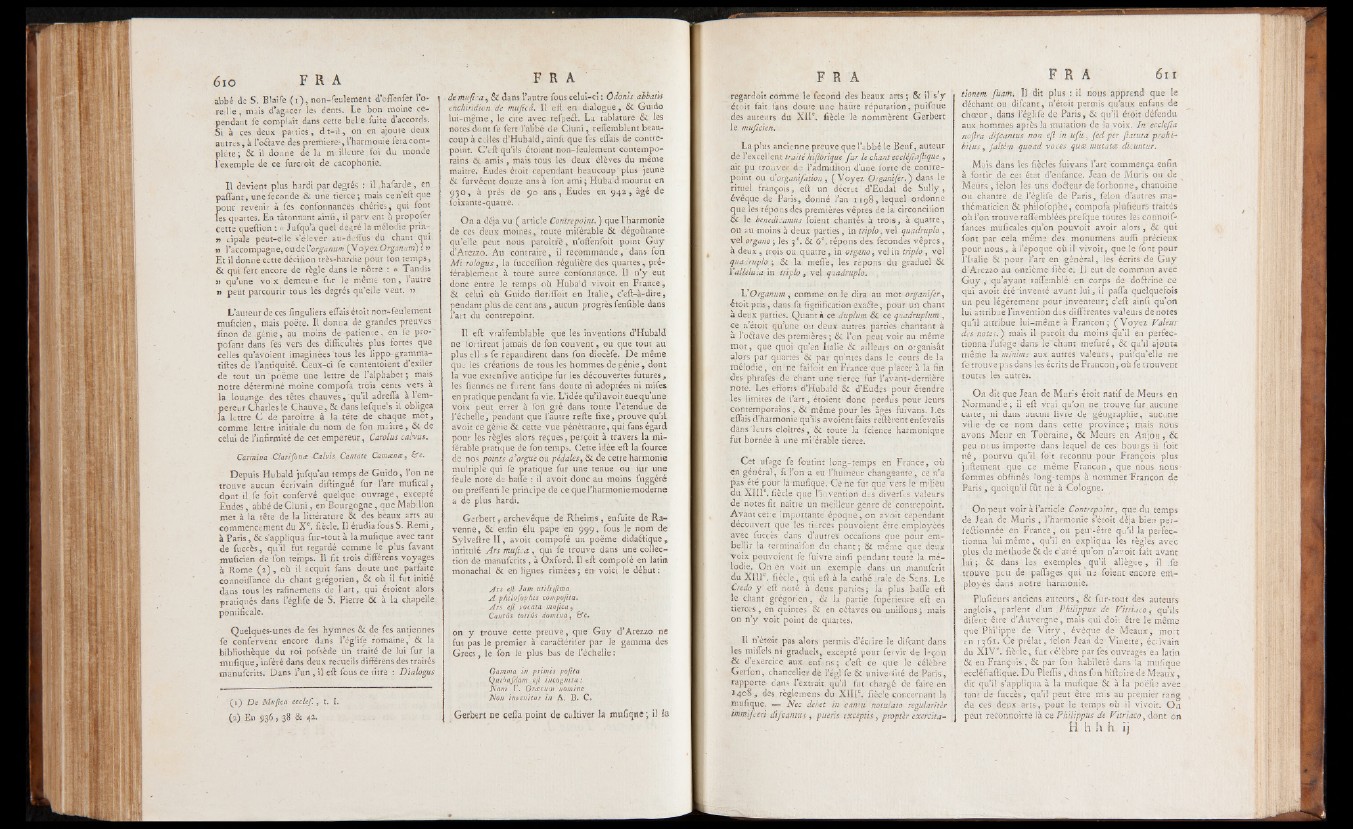
abbé de S. B'aife ( i ) , non-feulement d’offenfer l'o-
reille, mais d’agacer les dents. Le bon moine cependant
fe complaît dans cette belle fuite d’accords.
Si à ces deux paities, d t—i l , on en ajoute deux
autres, à l’o&ave des premières, l’harmonie fera complète;
& il donne de la milleure foi du monde
l’exemple de ce furcroît de cacophonie.
Il devient plus hardi par degrés : il ,hafarde, en
paffant, une fécondé & une tierce; mais cen’eft que
pour revenir à fes confonnances chéries, qui font
les quartes. En tâtonnant ainfi, il parvient à propofer
cette queftion : « Jufqu’à quel degré la mélodie prin -
y) cipale peut-elle s’élever au-deftus du chant qui
n l’accompagne, ou de Yorganum (Voyez Organum) ? »
Et il donne cette décifion très-hardie pour Ion temps,
& qui fert encore de règle dans le nôtre : « Tandis
» qu’une voix demeure fur le même ton, l’autre
3> peut parcourir tous lés degrés qu’eilé veut. »
L’auteur de ces finguliers effais étoit non-feulement
muficien, mais poète. Il donna de grandes preuves
finon de .génie, au moins de patience, en fe pro-'
pofant dans fes vers des difficultés plus fortes que
celles qu’avoient imaginées'tous les iippo-gramma-
tiftes de l’antiquité. Ceux-ci fe contentoient d’exiler
de tout un poëme une lettre de l’alphabet ; mais
notre déterminé moine compofa trois cents vers a
la louange des têtes chauves, qu’il adreffa à l’empereur
Charles le Chauve, & dans lefqueîs il obligea
la lettre C de paroître à la tête de chaque mot,
comme lettre initiale du nom de fon maître, & de
celui de l’infirmité de cet empereur, Carolus calvus.
Carmina Clanfonce Cafais Cantate Camoenee, &c.
Depuis Hubald jnfqu’au temps dé Guido, l’on ne
trouve aucun écrivain diftingué fur l’art mufical,
dont il fe foit confervé quelque ouvrage, excepté
Eudes, abbé de Cluni, en Bourgogne, que Mabillon
met à la tête de la littérature & des beaux arts au
commencement du X e. fiècle. Il étudia fous S. Remi,
à Paris, & s’appliqua fur-tout à la mufique avec tant
de fuccès, qu’il fut regardé^ comme le plus favant
muficien de fon temps. 11 fit trois différens voyages
à Rome (2 ) , ou il acquit fans doute une parfaite
connoiffance du chant grégorien, & où il fut initié
dans tous les rafinemens de la r t , qui étoient alors
pratiqués dans l’églife de S. Pierre & à la chapelle
pontificale.
Quelques-unes de fes hymnes & de fes antiénnes
fe confervent encore dans Péglife romaine, & la
bibliothèque du roi pofsède un traité de lui fur la
mufique, inféré dans deux recueils différens des traités
manufcrits. Dans l’un, il eft fous ce titre : D ïa h g u s
detnufica, & dans l’autre fous celui-ci: Odonls abbatis
enchiridion de muficâ. Il elt en dialogue, & Guido
lui-même, le cite avec refpeét. La tablature &. les
notes dont fe fert l’abbé de Cluni, reffemblent beaucoup
à cilles d’Hubald, ainfi que fes effais de contrepoint.
C ’eft qu’ils étoient non-feulement contemporains
&. amis, mais tous les deux élèves du même
maître, Eudes étoit cependant beaucoup plus jeune
& furvécut douze ans à fon ami ; Hubaid mourut en
930, à près de 90 ans, Eudes en 942, âgé de
foixante-quatre. .
On a déjà vu ( article Contrepoint. ) que l'harmonie
de ces deux moines, toute miférable & dégoûtante
qu’elle peut nous paroître, n’offenfoit point G uy
d’Arezzo. Au contraire, il recommande, dans fon
Mi rologus, la fucceffion régulière des quartes , préférablement
à toute autre conformance. 11 n’y eut
donc entre le temps où Huba’d vivoit en France,
& celui où Guido floriffoit en Italie, c’eft-à-dire,
pendant plus de cent ans , aucun progrès fenfible dans
l’art du contrepoint.
Il eft vraifemblable que les inventions d’Hubald
ne Sortirent jamais de fon couvent, ou que tout au
plus ell :s fe répandirent dans fon diocèfe. De même
que les créations de tous les hommes de génie, dont
la vue extenfive anticipe fur les découvertes futures ,
les fiennes ne furent fans doute ni adoptées ni ir.ifes
en pratique pendant fa vie. L’idée qu’il avoir eue qu’une
voix peut errer à fon gré dans toute l’étendue de
l’échelle, pendant que l’autre refte fixe, prouve qu’il
avoit ce génie & cette vue pénétrante, qui fans égard
pour les règles alors reçues, perçoit à travers la miférable
pratique de fon temps. Cette idée. eft la fource
de nos points d’orgue ou pédales, & de cetre harmonie
multiple qui fe pratique fur une tenue ou fijr une
feule note de baffe : il avoit donc au moins fuggéré
ou preffenti le principe de ce que l’harmonie-moderne
a de plus hardi.
Gerbert, archevêque de Rheims , enfuite de Ra-
venne, & enfin élu pape en 999, fous le nom de
Sylveftre I I , avoit compofé un poëme didaéfique,
intitulé Ars mufiua , qui fe trouve dâns une collection
de manufcrits, à Oxford. Il eft compofé en latin
monachal & en lignes rimées ; en- voici le début :
jérs eft Jam utiliifima
A philofopkis cotnpofita.
Ars eft vocata muftea,
CantÛs totiùs domina, &c.
on y trouve cette preuve, que Guy d’Arezzo ne
fut pas le premier à cara&ériier par le gamma des
Grecs, le fon le plus bas de l'échelle :
Gamma in primis pofita
Quibufdam eft incognito. :
Nam F. Groecum nomine
Non invenitur in A. B. C.
G e rb e r t ne ceffa p o in t de cultiver la mufique ; il fô
(1) De Muftea ecclef., t. I.
(2) En 936, 38 & 42*
regardoit comme le fécond des beaux arts ; & il s’y
étoit fait fans doute une haute réputation, puifque
des auteurs du XIIe. fiècle le nommèrént Gerbert
le muficien.
La plus ancienne preuve que l’abbé le Beuf, auteur
de l'excellent traité hiflôrique fur le chant eccléfiaflique
ait pu trouver d- l’adnuifion d’une forte de contrepoint
ou (ftorganifation, ( Voyez Organifer. ) dans le
rituel françois, eft un décret d’Eudal de Sully,
évêque de Paris, donné l’an 1198, lequel ordonne
que les répons des premières vêpres de la circoncifion
& le be ne die amus Soient .chantés à trois, à quatre,
ou au moins à deux parties, in triplo, vel quad rup la ,
vel organo ; les 3e. & 6e. répons des fécondés vêpres,
à deux, trois ou quatre, in organo, vel in triplo , vel
quadruplo ; & la meffe, les répons du graduel &
Xal Ulula in triplo , vel quadruplo.
\d O r g a n um , comme on le dira au mot organifer,
étoit pris , dans fa lignification exaéle, pour un chant
à deux parties. Quant à ce duplum & ce quadruplum,
ce n’étoit qu’une ou deux autres parties chantant à
à l’oélave des premières; & l’on peut voir au même
mot, que quoi qu’en Italie & ailleurs on organisât
alors par quartes & par quintes dans le. cours de la
mélodie, on ne faifoit en France que placer à la fin
des phrafes de chant une tierce fur l’a va nt - dernière
note. Les efforts d’Hubald & d’Eudes pour étendre
les limites de la r t, étoient donc perdus pour leurs
contemporains, & même pour les âges fuivans. Les
effais d’harmonie qu’ils avoient faits relièrent enfevelis
dans'leurs cloîtres, & toute la -fcience harmonique
fut bornée à une miférable tierce.
Cet ufage fe foutint long-temps en France, où
en général, fi Ton a eu l’humeur changeante., ce n’a
pas été pour là mufique. Ce ne fut que vers le milieu
du XIIIe. fiècle que l’invention des diverfes valeurs
de notes fit naître un meilleur genre de contrepoint.
Avantcerie importante époque, on avoit cependant
découvert que les tierces pouvoient être, employées
avec fuccès dans d’autres occafions que pour embellir
la terminaifon du chant ; & même que deux
voix pouvoient fe fuivre ainfi pendant toute la mélodie.
On èn voit un exemple dans un manuferit
du XIIIe. fiècle, qui eft à la cathéjrale de Sens. Le
Credo y eft noté à deux parties; la plus baffe eft
le chant grégorien, & la partie fupérieure eft en
tierces, en quintes & en oélaves ou unifions ; mais
on n’y voit point de quartes.
Il n’étoit pas alors permis d’écrire le difeant dans
les miffels ni graduels, excepté pour fervir de leçon
& d’exercice aux enflns ; c’eft ce que le célèbre
Gerfon, chancelier de l’églife & univemté de Paris,
rapporte dans l’extrait qu’il fut chargé de faire en
1408, des règlemens du XIIIe. fiècle concernant la
mufique. — Nec de'bet in canut noïulato regularit'er
immifeeri difeantus, pueris exceptis, proptèr exercitationem
fuam. 11 dit plus : il nous apprend que le
déchant ou difeant, n’étoit permis qu’aux enfans de
choeur, dans l’églife de Paris, & qu’il étoit défendu
aux hommes après la mutation de la voix. In ecclefia
nofira dijeantus non efi in ufu, fed per flatuta prohi-
bilus, Jaltem quoad voces quoi mutâtes, dicuntur.
Mais dans les fiècles fuivans l’art commença enfin
à fortir de cet état d’enfance. Jean de Mûris ou de
Meurs , félon les uns doâeur de forbonne, chanoine
ou chantre de l’églife de Paris,, félon d’autres mathématicien
& philofophe, compola plufieurs traités
où l’on trouveraffemblées prefque toutes les coniioif-
fances muficaies qu’on pouvoit avoir alors, & qui
font par cela même des monumens aufti précieux
pour nous, à l’époque où il vivoir, que Je font pour
l’Italie & pour l’art en général, les écrits de Guy
d’Arezzo au onzième fièc’e. Il eut de commun avec
Guy , qu’ayant raffemblé en corps de doéfrine ce
qui avoit été'inventé avant lui, il paffa quelquefois
un peu légèrement pouf inventeur; c’eft ainfi qu’on
lui attribue l’invention des différentes valeurs de notes
qu’il attribue lui-même à Francon ; (V oy e z Valeur
des notes.') mais il paroît du moins qu’il en perfectionna
-Image dans le‘ chant mefuré, & qu’il ajouta
même la minime aux autres' valeurs, puifqu’elle ne
fe trouve pas dans les écrits de Francon, où fe trouvent
toutes les autres.
On dit que Jean de Mûris étoit natif de Meurs en
Normandie; il eft vrai qu’on ne trouve fur aucune
carte, ni dans aucun livre de géographie, aucune
ville de ce nom dans cette province; mais nous
avons Meur en Tohraine, & Meurs en Anjou, &
peu nous importe dans lequel de ces bourgs il foit
né, pourvu qu’il foit reconnu-pour François plus
juftement que ce même Francon, que nous nous■
fommes obfiinés long-temps à nommec'Francon de
Paris , quoiqu’il fût né à Cologne.
On peut voir à l’article Contrepoint, que du temps
de Jean de Mûris , l’harmonie s’étoit déjà bien perfectionnée
en France, ou peut-être qu’il la perfectionna^
lui même, qu’il en expliqua les règles avec
plus de méthode & de carré qu’on n’avoit fait avant
lui; & dans les exemples qu’il allègue, il .fe
trouve peu de paffages. qui n i foient encore employés
dans notre harmonie.
Plufieurs anciens, auteurs, & fur-tout des auteurs
anglois, parlent d’un ,Philippus de Vitriaco f qu’ils
difènt être d’Auvergne , mais qui doit être le même
que Phi’ippè de V it r y , évêque de Meaux, mort
en 1361. Ce prélat, félon Jean de Vinette, écrivain
du XIVe. fiècle, fût célèbre par fes ouvrages en latin
& en François , & par fon habileté dans la mufique
eccléfiaflique. Du Pleffis, dans fon hiftoire de Meaux,
dit qu’il s’appliqua à la mufique & à la poëfie avec
tant de fuccès, qu’il peut être mis aù premier rang
de ces deyx arts, pour le temps où il vivoit. On
peut reconnoître là ce Philippus de Vitriaco, dont on
. H h h h ij