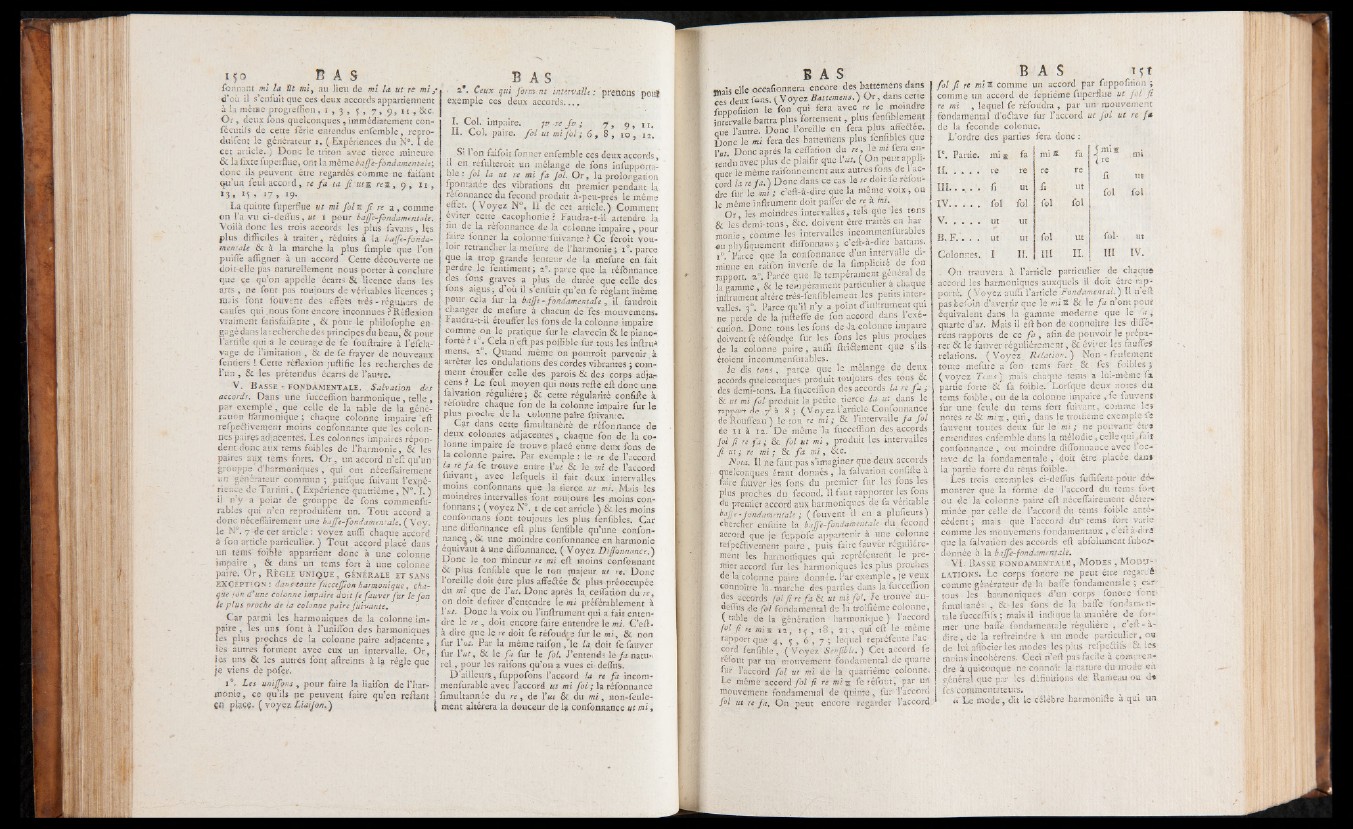
formant ml la ÏÏt mi, au lieu de mi la ut re mi y
d’où il s’enfuit que ces deux accords appartiennent
à la même progreffion , 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11- , &c.
O r , deux fons quelconques , immédiatement con-
fécutifs de cette férié entendus enfemble, repro-
duifent le générateur x, ( Expériences du N®. X de
cet article. ) Donc le triton avec tierce mineure
& la lixte fuperflue, ont la même baffe-fondamentale,
donc ils peuvent être regardés comme ne faifant
qu’un feul accord, re fa ta f i ut % re%, 9 , x i ,
13 » M ? 17 , 19.
La quinte fuperflue ut mi fo l s f i re a , comme
on l’a vu ci-deflùs, ut 1 pour baffe-fondamentale.
Voilà donc les trois accords les plus favans, Içs
plus difficiles à traiter, réduits à la baffe-fondamentale
& à la marche la plus fimple que l’on
puiffe affigner à un accord. Cette découverte ne
doit-elle pas naturellement nous porter à conclure
que ce qu’on appelle écarts & licence dans les
arts , ne font pas toujours de véritables licences ;
mais font fpuvent des effets très - réguliers de
caufes qui .nous font encore inconnues ? Réflexion
vraiment fatisfaiTante , & pour le philofophe engagé
dans la recherche des principes du beau, & pour
l ’artifte qui a le courage de fe fouftraire à l’efcla-
vage de l’imitation , & de fe frayer de nouveaux
fentiers !. Cette réflexion juftifie les recherches de
l’un, & les prétendus écarts de l’autre.
V . B asse -t fondamentale. Salvation des
accords. Dans une fucceffion harmonique, telle ,
par exemple , que celle de la table de la. génération
harmonique ; chaque colonne impaire "eft
rfffpe&ivement moins confonnante que' les colonnes
paires adjacentes. Les colonnes impaires répondent
donc aux teins foibles de l’harmonie, & les
paires aux tems forts. O r , un accord n’eÆ qu’un
grouppe- d’harmoniques, qui ont néceflairement
un générateur commun ; pulfque fuivant l’expé-
, rieuée de Tartini, ( Expérience quatrième , N°. I. )
il n y a point de grouppe de fons cpmmenfu-
rables qui n?cn reproduisent un. Tout accord a
donc néceflairement une baffe-fondamentale. ( Voy.
le N°. 7 de cet article : voyez suffi chaque accord
à fon article particulier. ) Tout accord placé dans
un tems foible appartient donc à une colonne
impaire , & dans un tems fort à une colonne
paire. Or , R ÈG L E U N IQ U E , GÉNÉRALE E T SANS
EX C E PT IO N : dans-toute fucceffion harmonique, chaque
ton d*une colonne impaire doit fe fauver fur le fon
le plus proche de la colonne paire fuivante.
Car parmi les harmoniques de la colonne im*»
paire , les uns font à l’uniffon des harmoniques
les plus proches de la colonne paire adjacente,
les autres forment avec eux un intervalle. Or ,
les uns & les autres font astreints à la règle que
je viens de pefer.
i° . Les uniffoRs, pour faire la liaifon de l’harmonie,
ce qu’ils ne peuvent faire qu’en reftam
ÇV, pfôçç. ( voyez Liaiï&n. )
Ceux qui-forment intervalle : prenons pouï
exemple ces deux accords.. . .
I. Col. impaire. jv -re Jo ; .7 9 , 1 1
IL Col. paire, fo l ut mi fo l ; 6 , 8 , 10 , 12,
Si 1 on faifoit fonner enfemble ces deux accords,
il en réfulteroit un mélange de fons infupporta-
ble : fol la ut re mi fa Jol. O r , la prolongation
fpontanee des vibrations du premier pendant la
réfonnance au fécond produit à-peu-près le même
effet. (Voyez N°, 11 de cet article.) Comment
éviter cette cacophonie ? Faudra-t-il attendre la
nn de la réfonnance de la colonne impaire , pour
faire fonner la colonne fuivante ? Ce feroit vouloir
retrancher la mefure de l’harmonie ; i 6. parce
que la trop grande lenteur de la mefure en fait
perdre Je fentiment ; 20. parce que la réibnnance
des fons graves a plus de durée que celle des
fons aigus ; d’où il s’enfuit qu’en fe réglant même
pour cela fur la baffe-fondamentale, il faudroit
changer de mefure à chacun de Tes mouvemens.
Faudra-t-il étouffer les fons de la colonne impaire
comme on le pratique furie clavecin & le piano-
forte ? i°. Cela n eft pas poffible fur tous les inflriH
a°* Quand même on pourroit parvenir à
arrêter les ondulations des cordes vibrantes ; comment
etouffer celle des parois & des corps adja^
cens ? Le feul moyen qui nous reftè eft donc une
falvation régulière; St cette régularité confifte à
réfoudre chaque fon de la colonne impaire fur le
plus proche de la colonne paire fuivante.
Cfir dans cette iimultanéité de réfonnance de
deux colonnes adjacentes, chaque fon de la colonne
impaire fe trouve placé entre deux fons de
la colonne paire. Par exemple: le re de l’accord
la rè fa fe trouve entre l'ut & le mi de l’accord
fuivant, avec lefquels il fait deux intervalles
moins confonnans .que la tierce ut mi. Mais les
moindres intervalles font toujours les moins confonnans
; (voyez N°. 1 de cet article ) & les moins
confonnans font toujours les plus ienfibles. Car
J une diffcmnance eft plus fenûble qu’une confon-
l nanc^, & une moindre confonnance en harmonie
équivaut à une diffonnance. ( Voyez Diffonnance.)
Qonc le ton mineur re mi eft moins conformant
& plus fenfible que le ton majeur, ut re. Donc
l’oreillç doit être plus affeâée & plus préoccupée
du mi que de l'ut. Donc après la ceffation du re,
on doit defirer d’entendre le mi préférablement à
Vut- Donc la yoix ou l’inftrument qui a fait entendre
le re , doit encore faire entendre le mi. C ’eft-
à dire que le re doit fe réfoucke fur le mi, & non
fur Y ut. Par la même raifpn, le tk doit fè fauver
fur Y ut, & le f a fur le jo l. J’entends le fa naturel
pour les raifons qu’on a vues ci- deffus.
D ’ailleurs, fuppofons l’accord la re fa ineom-
menfurable avec l’accord ut mi fo i ; la réfonnance
ftmul tannée du re, de Y ut St du mi, non-feulement
altérera la douceur de la confonnance ut mi,
wais eue occauuiiiiwa -----— k s î b .
deux fons. (V o y e z Battemens.) O r , dans cette
fuppofirion le fon qui fera avec ra le _momdre
intervalle battra plus fortement plus fenfiblement
nue l’autre. Donc l’oreille en fera plus affeftee.
Donc le mi fera des battemens plus fenfibles que
IV/ Donc après la ceffation du re, le nu fera en-
tendu avec plus de plaifir que l’«r. ( On peut appliquer
le même raifonnement aux autres fons de 1 ac-
cord lu re fa .) Donc dans ce cas le re doit fe réfou-
dre fur le m i; c’eft-à-dire que la même v o ix , ou
le même infiniment doit paffer de re à inu
O r , les moindres intervalles, tels que les tons
& les demi-tons, &c. doivent être traités en har
monie, comme les intervalles incommenfurables
©u phyfiquement diffonnaas ; c’eft-à-dire battaiis.
i°. Parce que la confonnance d’un intervalle diminue
en raifdn inverfe, de la ftmplicite de fon
rapport. a°. Parce que le tempérament general de
la gamme, & le tempérament particulier à chaque
infiniment altère très-fenfiblement les petits intei-
valles. 30. P a r c e 'qu’il n’y a point d’infirument qui
ne perde de la jufteffe de fon accord , dans I execution.
Donc tous les fons de la-colonne impaire
doivent fe réfoudre fur les fons les plus proches
de la colonne paire, auffi ftriéiement que s ils
étoient incommenfurables.
Je dis tons , parce que le mélange de deux
accords quelconques produit toujours des tons et
des demi-tons. La fucceffion. des accords la re fa ; v
& ut mi fo l produit la petite tierce la ut dans le
rapport de .7' à 8 ; (V o y e z l’article Confonnance
de Rouffeau ) le ton re mi ; & l’intervalle fa fol
de 11 à 12. De même Ta fucceffion des-accords
fol fi re fa ; & fol ut mi, produit les intervalles
fi ut ; re mi ; 8t fa mi , OCC.
Nota. 11 ne faut pas s’imaginer que-deux accords
• quelconques étant donnés , la falvation confifte à
faire fauver les fons du premier fur les fons les
plus proches du fécond 11 faut rapporter les fons
du premier accord aux harmoniques de fa véritable
baj/e - fondamentale ; (fouvent il en a plusieurs)
chercher enfuite la. baffe-fondamentale du fécond
accord que je fuppôfe appartenir a une colonne
refpe&ivement paire , puis faire fauver régulièrement
les harmoiliques qui repréfentent le premier
accord fur les harmoniques les plus proches
de la colonne paire donnée. Par exemple , je veux
cônnoître la marche des'parties, dans la fucceffion
des accords fol f i re fà & ut mi fol. Je trouve au-
deflus vdè fo l fondamental de la troifieme colonne,
(table de la génération harmonique)- 1 accord
fol f i re mim. ia , i <j , 1 8 , a r , qui eft le même
rapport que 4, 5 , 6 , 7 ; lequel repréfente l’accord
fenfible , ( Voyez SenfibU. ) Cet accord fe
réfout par un mouvement fondamental de quarte
Éur l’accord fol ut mi de la quatrième colonne.
Le même accord fol fi re mi g fe réfout, par un
mouvement fondamental de quinte, fu i'l’accord
fol ut re fa. On peut encore regarder l’accord
B A S m *
fol f i re mix comme un accord par fuppofîtion ;
comme un accord de feptième fuperflue ut fo l f i
re mi , lequel fe rèfoùdra , par uii' mouvement
fondamental d’oéfave fur l’accord ut fo l ut re fa
de la fécondé colonne.
j mi s
(re
fi
fol
L ’ordre des parties fera donc :
Ie. Partie. mi® fa mi s fa
n .............. re re re re
i n . . . . . . n ut x. ut
I V . . . . . fol fol fol fol
V. , . . . ut ut
B. F.'. . . ut ut fol ut
Colonnes. I n . III n .
faill
i
fol
IV.
.. On trouvera à l’article particulier de^ chaquô
accord les harmoniques auxquels il doit être rapporté,
(V o y e z auffi l’article Fondamental.) Il n eft
pas b.efoin d’avertir que le mi s & le fa n’ont pouf
équivalent dans la gamme moderne que 1e f a *
quarte d7ut. Mais il eft bon de connoitre les diffé-
réns rapports de ce f a , afin de pouvoir le préparer
& le fauver régulièrement, & évûer les rauffes
relations. ( V o y e z , Relation. ) Non - feulement
toute mefure a fon tems fo r t . & fes foibles ;
(v o y e z mais chaque tems a lui-même fa
partie forte & fa foible. Lorfque deux notes du
tems foible , ou de la colonne impaire , fe fauvent
fur une feule du tems fort fuivant, comme les
notes re & mis. , qui, dans le troifième exemple le
fauvent toutes deux fur 1 s mi ; ne pouvant' êtr#
entendues enfemble dans la mélodie , celle qui Tait
confonnance , ou moindre diffonnance avec l’oc- '
tave de la fondamentale , doit être placée dans
la partie forte du tems foible.
Les trois exemples ci-deffus fuffifent-pour démontrer
que la forme' de l’accord du tems fort
ou de la colonne paire eft néceflairement déterminée
par celle de l’accord du tems foible antécédent;
mais que l ’accord d ir tems fort varie
comme les mouvemens fondamentaux , c’eft à-dire
que la falvation des accords eft absolument fubor-
donnée à la baffe-fondamentale.
VI. Basse fondamentale , Modes , Mod tj - ■
lations. Le corps fonore ne peut être rega: . é
comme générateur dç la baffe fondamentale ; car •
: tous les harmoniques d’un corps fonore font-
fimulianéi , & - les fons de la baffe fondanun-
I taie fucceffifs ; mais il indique la manière de former
une baffe fondamentale régulière , c’e ft-à -
dire, de la reftreindre à un mode particulier, ou
de lui affocier les modes les plus refpeétifs Sl les
moins incohérens. Ceci n’eft pas facile à comprendre
à quiconque ne connaît la nature du< mode en
général que par les définitions de Rameau ou
Tes commentateurs.
•*' Le mode, dit le célèbre harmonifie à qui un