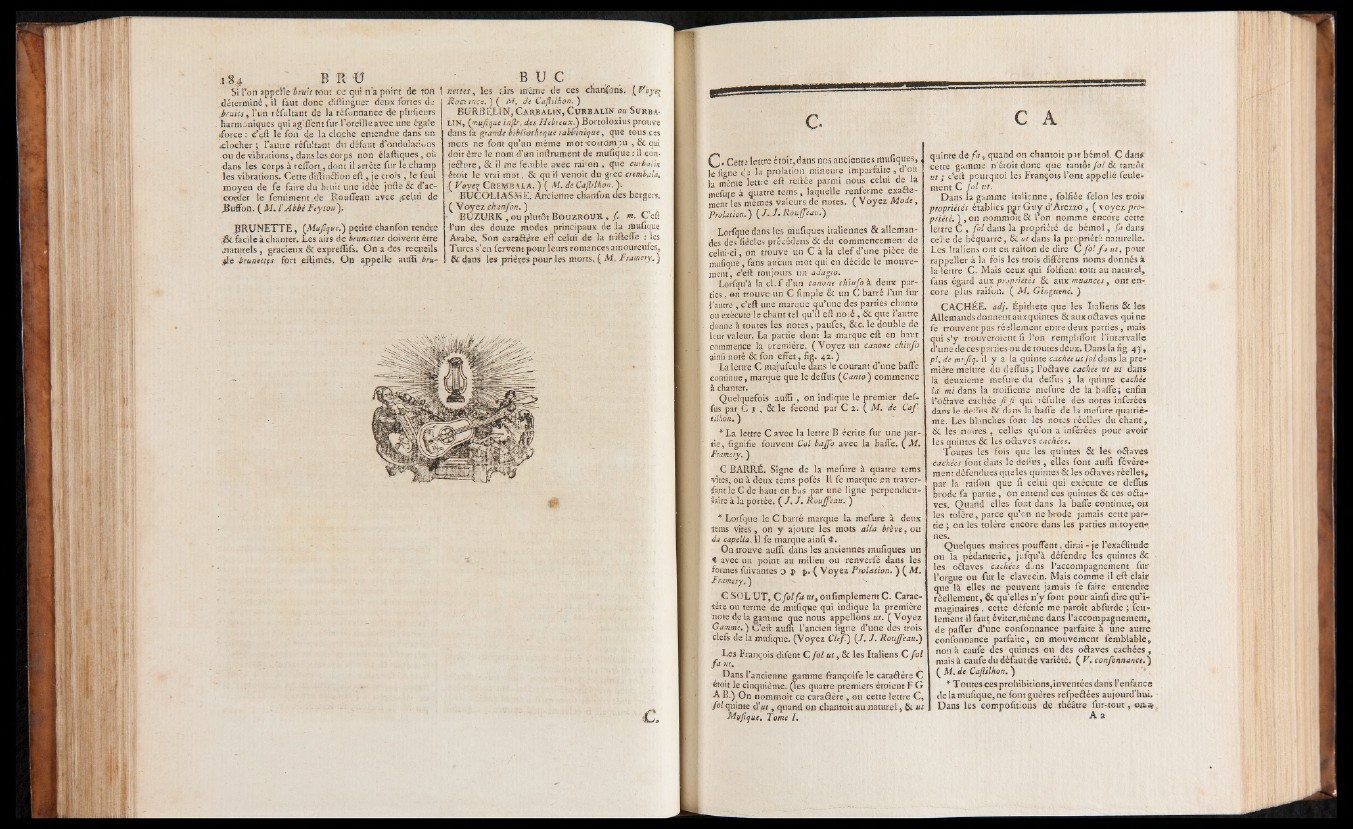
.184 B R V
Si Ton appelle bruit tout £e qui n a point de ton 1
.déterminé , il faut donc cfiftinguer deux fortes de
bruits, l’un réfultant de la réfonnanee <|e plufieurs
harmoniques qui agiffent fur-l’oreille avec une égale
iforce : C*çft le fon qe la clçtche entendue dans un jj
«clocher ; l’autre réfultant du défaut d’ondulations
ou de vibrations j.dans.les. corps non élaftiques, où
dans les corps à refforr , dont il arrête fur le champ
les vibrations. Cette diftin&ion eft., je croîs , le feul
moyen de fe faire du bruit une idée jufte & d’accorder
le feu «ment de JRouflean avec jÇelui dje
JSuffon. I M. l'Abbé Fc y tou').
JBRUNETTE, {Mufique.) petite chanfon tendre
facile à chanter. Les airs de brûnates doivent être
jiaturels , gracieux & expreflifs. On a des recueils
$le bruntt:es fort eftimés. .On appelle auffi bru-
B U C
n e t t e s les airs même de ces chansons.
Rom irree. } ( M. de Cafhlhon. )
BURBÇJÜN., Ca RBAUN, CuRBALIN OU SURBA*
LIN, ([mufique inflr. 4es.Hébreux?) Boi toloxius prouve
dans la grande bibliothèque rahpinique, que tous-.ces
mots ne font qu’un même mot’■corrompu , & qai
doit être le nom d’un inflrutnent de mufique : il co r *
je$u re, & il me femble avec rai'on , que curbalin
était le vrai mot, 6c qui! venoit du grec ciembala,
;( V o y e ^ Crembala. ) ( M . de C a fiith o n .fi
BUCOLIASiViE. Ancienne chanfon des bergers.
( V oyez chanfon. )
* BUZÜRK, ou plutôt BouzrouR. t / . m. Ceft
l'un des douze modes principaux de lia mufique
Arabe. Son cara&ère eft celui de la frifteffe : les
Turcs s’en fervent pour leurs romances amoureufes,
& dans les prières pour-les morts. ( M . Framery*)
C- C A
C. Cette lettre étoit,dans nos anciennes mufiques, ,
le ftp ne de la prolation mineure imparfaite , d’ou |
la même lettre eft reliée parmi nous celui de la
mefuj:e à quatre tems, laquelle renferme .exactement
les mêmes valeurs de notes. (V o y e z Mode,
Prolation. ) ( /. /. Roujf’.au.)
Lorfque dans les mufiques italiennes & allemandes
des fiécles précédens & du commencement de
celui-ci, on trouve un C à la clef d’une pièce de
mufique, fans aucun mot qui en décide le mouvement,
c’eft toujours un adagio.
Lorfqu’à la c L f d’un canone chiufo à deux parties
, on trouve un C fimple & un C barré l’un fur
l ’autre, c’eft une marque qu’une des parties chante
ou exécute le chant tel qu’il eft no:é , & que l’autre
donne à toutes les notes, paufes, &c. le double de
leur valeur. La partie dont la marque eft en haut
commence la première. (V o y e z un canone chiufo
ainfi noté & fon effet, fig. 42. )
La lettre C majufcule dans le courant d’une baffe
continue, marque que le deffus ( Canto ) commence
à chanter.
Quelquefois aufli , on indique le premier deffus
par C 1 , & le fécond par C 2. ( M. de Caf
tilhon. )
* La lettre C avec la lettre B écrite fur une partie,
fignifie fouvent Col bajfo avec la bafle. ( M.
Framtry. )
C BARRÉ. Signe de la mefure à quatre tems
vîtes, ou à deux tems pofés II fe marque en frayeron
t le G de haut en bas par une ligne perpendiculaire
à la portée. ( J. J. Rouffeau. )
* Lorfque le C barré marque la mefure à deux
tems vîtes, on y ajoute les mots alla brève, ou
da cape lia. 11 fe marque ainfi <£.
On .trouve aufli dans les anciennes mufiques un *
< avec un point au milieu ou renverfé dans les ;
formes fuivantes O J> j>. ( Vo yez Prolation. ) ( M.
framery. ) ^ ^
C SOL U T , C fo l fa ut, oufimplement C. Caractère
ou terme de mufique qui indique la première
note de la gamme que nous appelions ut. (V o y e z
Gamme. ) C’eft aufli l’ancien frgne d’une des trois
clefs de la mufique. (Voyez Clef.) (J. J. Roujfeau.)
Les François difent C fo l u t, & les Italiens C fo l
fa ut. .
Dans l’ancienne gamme françoife le caraftère C
etoit le cinquième. (Tes quatre premiers étoient F G
A B.) On nommoit ce caraâère , ou cette lettre C,
fol quinte d'ut, quand on chantoit au naturel, & ut
Myfique. Tome I.
quinte de f a , quand on chantoit bar bémol. C danl
cette garftme n'étoit donc que tantôt fol & tantôt
ut ; c'eft pourquoi les François l’ont appelle feulement
C fo l ut. '
Dans la gamme italienne , folfiée félon les trois
propriétés établies pgr G uy d’Arezzo , ( voyez propriété.)
, on nommoit & l’on nomme encore cette
lettre C , fol dans la propriété de bémol, fa dans
celie de béquarre, & ut dans la propriété naturelle.
Les Italiens ont eu rai(on de dire C fol fa ut, pour
rappeller à la fois les trois différens noms donnés à
la lettre C. Mais ceux qui folfient tout au naturel,
fans égard aux propriétés & aux muances, ont encore
plus raifon. ( M. Ginguvné. )
CACHÉE, adj. Épithete que les Italiens & les
Allemands donnent aux quintes &. aux octaves qui ne
fe trouvent pas réellement entre deux parties, mais
qui s’y trouveroient fi l’on rempliffoit l’intervalle
d’ une de ces parties ou de toutes deux. Dans la fig 43',
pl, de mufiq. il y a la quinte cachée ut fo ld ans la première
melure du deffus ; Foétave cachée ut ut dans
la deuxieme mefure du deffus ; la quinte cachée
la mi dans la troifieme mefure de la baffe ; enfin
l’oétave cachée f i f i qui réfulte des notes inférées
dans le deffus & dans la baffe de la mefure quatrième.
Les blanches font les notes réelles du chant,
& les noires , celles qu’on a inférées pour avoir
les quintes & les o&aves cachées.
Toutes les fois que les quintes & les oftaves
cachées font dans le deffus , elles font aufli févère-
njent défendues que les quintes & les oftaves réelles,
par la raifon que fi celui qui exécute ce deffus
brode fa partie, on entend ces quintes & ces oâa-
ves. Quand elles font dans la baffe continue, oii
les tolère, parce qu’on ne brode jamais cette partie
; on les tolère encore dans les parties mitoyennes
.Q
uelques maîtres pouffent, dirai - je l’exaélitude
ou la pédanterie, jufqu’à défendre les quintes &
les oâaves cachées d^ns l’accompagnement fur
l’orgue ou fur le clavecin. Mais comme il eft clair
que là elles ne peuvent jamais fe faire entendre
réellement, & quelles n’y font pour ainfi dire qu’ imaginaires
, cette défenfe me paroît abfurde ; feulement
il faut éviter,même dans l’accompagnement,
de paffer d’une confonnance parfaite a une autre
confonnance parfaite, en mouvement femblable,
non à caufe des quintes ou des oâaves cachées,
mais à caufe du défaut de variété. ( V. confonnance.)
( M. de Cafiilhon. )
* Toutes ces prohibitions,inventées dans l’enfance
de la mufique, ne font guères refpeélées aujourd’hui.
Dans les compofitions de théâtre fur-tout,
A a