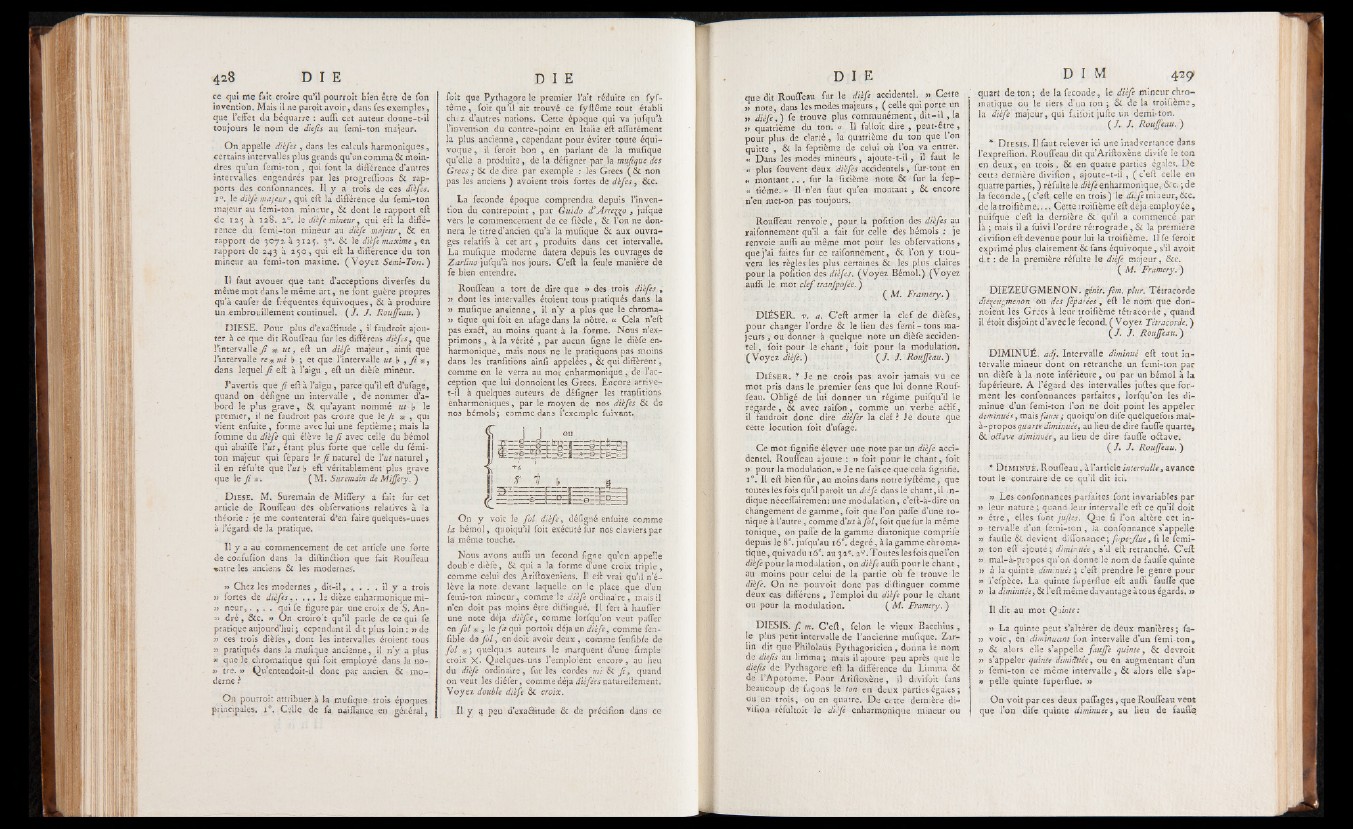
428 D I E D I E
ce qui me Tait croire qu’il pourroit bien être de fon
invention. Mais il ne paroît avoir, dans Ces exemples,
que l’effet du béquarre : aufli cet auteur, donne-t-il
toujours le nom de diefis au femi-ton majeur.
On appelle dièfes , dans les calculs harmoniques,
certains intervalles plus grands qu’un comma & moindres
qu’un femi-ton, qui font la différence d’autres
intervalles engendrés par les progreflions & rapports
des confonnances. Il y a trois de ces diètes.
i° . le dièfe majeur, qui eft la différence du femi-ton
majeur au femi-ton mineur, & dont le rapport eft
de 1 25 à 128. 2.0* le dièfe mineur, qui eft la différence
du femi-ton mineur au dièfe majeur, & en
rapport de 3072 à 3125. 30. & le dièfe maxime, en
rapport de 243 à 250, qui eft la différence du ton
mineur au femi-ton maxime. (V o y e z Semi-Ton. )
Il faut avouer que tant d’acceptions diverfes du
même mot dans le même art, ne font guère propres
qu’à caufer de fréquentes équivoques, & à produire
un .embrouillement continuel, (ƒ . J. Rouffeau.)
DIESE. Pour plus d’exaâitude , il faudroit ajouter
à ce que dit Rouffeau fur les différëns dièfes, que
l’intervalle f i *s ut, eft un dièfe majeur, ainfi que
l’intervalle re # mi b ; et que l’intervalle ut b , f i * ,
dans lequel y? eft à l’aigu , eft un dièfe mineur.
J’avertis que fi. eft à l’aigu , parce qu’il eft d’ufage,
quand on défigne un intervalle , de nommer d’abord
le plus grave, & qu’ayant nommé ut^ le
premier, il ne faudroit pas croire que le f i # , qui
vient enfuite , forme avec lui une feptième ; mais la
fomme du dièfe qui élève le f i avec celle du bémol
qui abaiffe Yut, étant plus forte que celle du fémi-
ton majeur qui fépare 1 e f i naturel de Yut naturel,
il en réfirte que Yut b eft véritablement plus grave
que le f i (M . Suremain de Miffery. j
D iese. M. Suremain de Miffery a fait fur cet
article de Rouffeau des obfervations relatives à la
théorie ; je me contenterai d’en faire quelques-unes
à l’égard de la pratique.
Il y a au commencement de cet article une forte
de confufïon dans la diftinélion que fait Rouffeau
entre les anciens & les modernes.
» Chez les modernes , dit-il, « . . . il y a trois
» fortes de dièfes, . . . . le dièze enharmoniquemi-
» neur,. , . . qui fe figure par une croix de S. A n -
M d ré , &c. » On croiro’t qu’il parle de ce qui fe
pratique aujourd’hui ; cependant il dit plus loin : » de
j> ces trois dièfes, dont les intervalles étoient tous
» pratiqués dans la mufique ancienne,.il n’y a plus
* que le chromatique qui foit employé dans la no-
» tre. » Qu’entendoit-Û donc par ancien & moderne
|
On pourroit attribuer à la mufique trois époques
principales. i° . Celle de fa naiffance.en général,
foit que Pythagore le premier l’a't réduite en fyf-
tême, foit qu’il ait trouvé ce fyftême tout établi
ch, z d’autres nations. Cette époque qui va jufqu’à
l’invention du contre-point en Italie eft affurément
la plus ancienne, cependant pour éviter tçute équivoque
, il feroic bon , en parlant de la mufique
qu’elle a produite, de la défigner par la mufique des
Grecs ; & de dire par exemple : les Grecs ( & non
pas les anciens ) avoient trois fortes de dèfes, &c.
La fécondé époque comprendra depuis l’invention
du contrepoint , par Guido d’Arreçço , jufque
vers le commencement de ce fiècle, & l’on ne donnera
le titre d’ancien qu’à la mufique & aux ouvrages
relatifs à cet art , produits dans cet intervalle.
La mufique moderne datera depuis les ouvrages de
Zarlino jufqu’à nos jours. C ’eft la feule manière de
fe bien entendre.
Rouffeau a tort de dire que » des trois dièfes ,
j> dont les intervalles étoient tous pratiqués dans la
» mufique ancienne, il n'y a plus que le chroma-
» tique qui foit en ufage dans la nôtre. « Cela n’eft
pas exaéf, au moins quant à la forme. Nous n’exprimons
, à la vérité , par aucun figne le dièfe enharmonique,
mais nous ne le pratiquons pas moins
dans les tranfitions ainfi appelées , & qui diffèrent,
comme on le verra au mot enharmonique, de l’acception
que lui donnoientles Grecs. Encore arrive-
t-il à quelques auteurs de défigner les tranfitions
enharmoniques, par le moyen de nos dièfes & de
nos bémols; comme dans l’exemple fuivant.
p —»ë—gP—P-Q-1—
£
- m m s m
w S S b t&
On y voit le fol dièfe, dé (igné enfuite comme
la bémol, quoiqu’il foit exécuté fur nos claviers par
la même touche.
Nous avons aufli un fécond figne qu’cn appelle
doub'e dièfe, & qui a la forme d’une croix triple,
comme celui des Ariftoxemens. 1! eft vrai qu’il n’élève
la note, devant laquelle en le place que d’un
femi-ton mineur, comme'le dièfe ordinaire, mais il
n’en doit pas mç>ins être diftingué. Il fert à hauffer
une note déjà dièfée, comme lorfqu’on veut paffer
en fo l # , le fa qui portoit déjà un dièfe, comme fen-
fible de f o l , en doit avoir deux , comme fenfibie de
fo l *■ ; quelques auteurs le marquent d’une fimple
croix X- Quelques-uns l’emploient encore, au lieu
du dièfe ordinaire, fur les cordes mi & f i , quand
on veut lès cliéfer, comme déjà dïèfées naturellement.
Voyez double dièfe & croix.
Il y a peu d’exa&itude & de précifion dans ce
que dit Rouffeau fur le dièfe accidentel. » Cette
j> note, dans les modes majeurs , ( celle qui porte un
» dièfe,) fe trouve plus communément, dit—il , la
» quatrième du ton. « 11 falloir dire , peut-etre ,
pour plus de clarté, la quatrième du ton que l’on
quitte , & la feptième de celui oh l’on va entrer.
« Dans les modes mineurs , ajoute-t-il, il faut le
« plus fouvent deux dièfes accidentels, fur-tout en
« montant. . . fur la fixième note & fur la fep-
« tième. » Il n’en faut qu’en montant , ôt encore
n’en met-on pas toujours,
Rouffeau renvoie, pour, la pofition des dièfes au
raifonnement qu’il a fait fur celle des bémols : je
renvoie aufli au même mot pour les obfervations,
que j’ai faites fur ce raifonnement, & l’on y trouvera
les règles les plus certaines & les plus claires
pour la pofition des dièfes. (Voyez Bémol.) (Voyez
aufli le mot clef tranfpofée. )
( M. Framery. )
DIÉSER. v. a. C ’eft armer la cle£ de dièfes,
pour changer l’ordre & le lieu des fëmi-tons majeurs
, ou donner à quelque note un dièfe accidentel
, foit pour le chant, foit pour la modulation.
(V o y e z dièfe.) (ƒ . J. Rouffeau.)
D iéser. * Je ne crois pas avoir jamais vu ce
mot pris dans le premier fens que lui donne Rouffeau.
Obligé de lui donner un régime puifqu’il le
regarde, & avec raifon, comme un verbe aélif,
il faudroit donc dire diéfer la clef? Je doute que
cette locution foit d’ufage.
Ce mot lignifie élever une note par un dièfe accidentel.
Rouffeau ajoute : » foit pour le chant, foit
» pour la modulation. » Je ne fais ce que cela fignifie.
i° . Il eft bienfûr, au moins dans notre fyftême, que
toutes les fois qu’il paroît un dièfe dans le chant, il indique
néceffairement une modulation, c’eft-à-dire un
changement de gamme, foit que l’on paffe d’une tonique
à l’autre, comme d’ut à fo l, foit que fur la même
tonique, on paffe de la gamme diatonique comprife
depuis le 8e. jufqu’au 16e. degré, à la gamme chromatique,
qui va du 16e. au 3 2e. 20. Toutes les fois que l’on
dièfe pour la modulation, on dièfe aufîi pour le chant,
au moins pour celui de la partie où fe trouve le
dièfe. On ne pouvoit donc pas diftinguer comme
deux cas différëns , l’emploi du dièfe pour le chant
ou pour la modulation. ( M. Framery. )
DIESIS. ƒ m. C ’eft, félon le vieux Bacchius ,
le plus petit intervalle de l’ancienne mufique. Zar-
lin dit que Philolaüs Pythagoricien, donna le nom
de diefis au limma ; mais il ajoure peu après que le
diefis de Pythagore eft la différence du Limma &
de l’Apotome. Pour Ariftoxène, il divifoit fans
beaucoup de façons le ton en deux parties égales ;
ou en trois, ou en quatre. De cette dernière di-
vifion réfultoit le dièfe enharmonique mineur ou
quart de ton; de la fécondé, le dièfe mineur chromatique
o,u le tiers d’un ton ; & de la troifième,
la dièfe majeur, qui fàifoit jufte un demi-ton.
( /. J. Rouffeau. j
* D iesis. Il faut relever ici une inadvertance dans
l’expreffion. Rouffeau dit qu’Ariftoxène divife le ton
en deux, en trois, & en quatre parties égales. De
cette dernière divifion , ajoute-t-il, ( c ’eft celle en
quatre parties, ) réfulte 11 dièfe enharmonique, &c. ; de
la fécondé, (c ’eft celle en trois) le dièfe mineur, & c.
de la troifième.. .. Cette troifième eft déjà employée ,
puifque c’eft la dernière & qu’il a commencé par
là ; mais il a fuivi l’ordre rétrograde, & la première
divifion eft devenue pour lui la troifième. Il fe feroit
exprimé plus clairement & fans équivoque, s’il a voit
d.t : de la première réfulte le dièfe majeur, &c.
( M. Fratnery. )
DIEZEUGMENON. génit. fem. plur. Tétracorde
die^eu^menon ou des féparées, eft le nom que don-
nôient les Grecs à leur troifième tétracorde , quand
il étoit disjoint d’avec le fécond. ( Voyez Tétracorde. )
( / . J. Rouffeau.j
DIMINUÉ, adj.. Intervalle diminué eft tout intervalle
mineur dont on retranche un femi-ton par
un dièfe à la note inférieure, ou par un bémol à la
fupérieure. A l’égard des intervalles juftes que forment
les confonnances parfaites, lorfqu’on les diminue
d’un femi-ton l’on ne doit point les appeler
diminués, mais faux ; quoiqu’on dife quelquefois malà
propos quarte diminuée, au lieu de dire fauffe quarte,
& otfave diminuée, au lieu de dire fauffe o&ave.
( /. J. Rouffeau. )
* D iminué. Rouffeau, à l’article intervalle a avance
tout le contraire de ce qu’il dit ici.
» Les confonnances parfaites font invariables par
» leur nature ; quand leur intervalle eft ce qu’il doit
» être, elles font jufies. Que fi l’on altère cet in-
» tervalle d’un femi-ton, la confonnance s’appelle
» faufle & devient diffonance; fuperJlue, fi le femi-
>j ton eft ajouté ; diminuée, s’il eft retranché. C ’eft
» mâl-à-propos qu’on donne le nom de fauffe quinte
» à la quinte diminuée ; c’eft prendre le genre pour
1» i’efpèce. La quinte fuperflue eft aufli fauffe que
» la diminuée, & l’eft même davantage à tous égards. »
Il dit au mot Quinte:
» La quinte peut s’altérer de deux manières; fa-
» v o ir , en diminuant fon intervalle d’un femi-ton,
» & alors elle s’appelle fauffe quinte, & devroit
» s’appeler quinte diminuée, ou en augmentant d’un
» femi-ton ce même intervalle , & alors elle s’ap-
» pelle quinte fuperflue. »
On voit par ces deux paffages, que Rouffeau vent
que l’on dife quinte diminuée, au lieu de fauffe