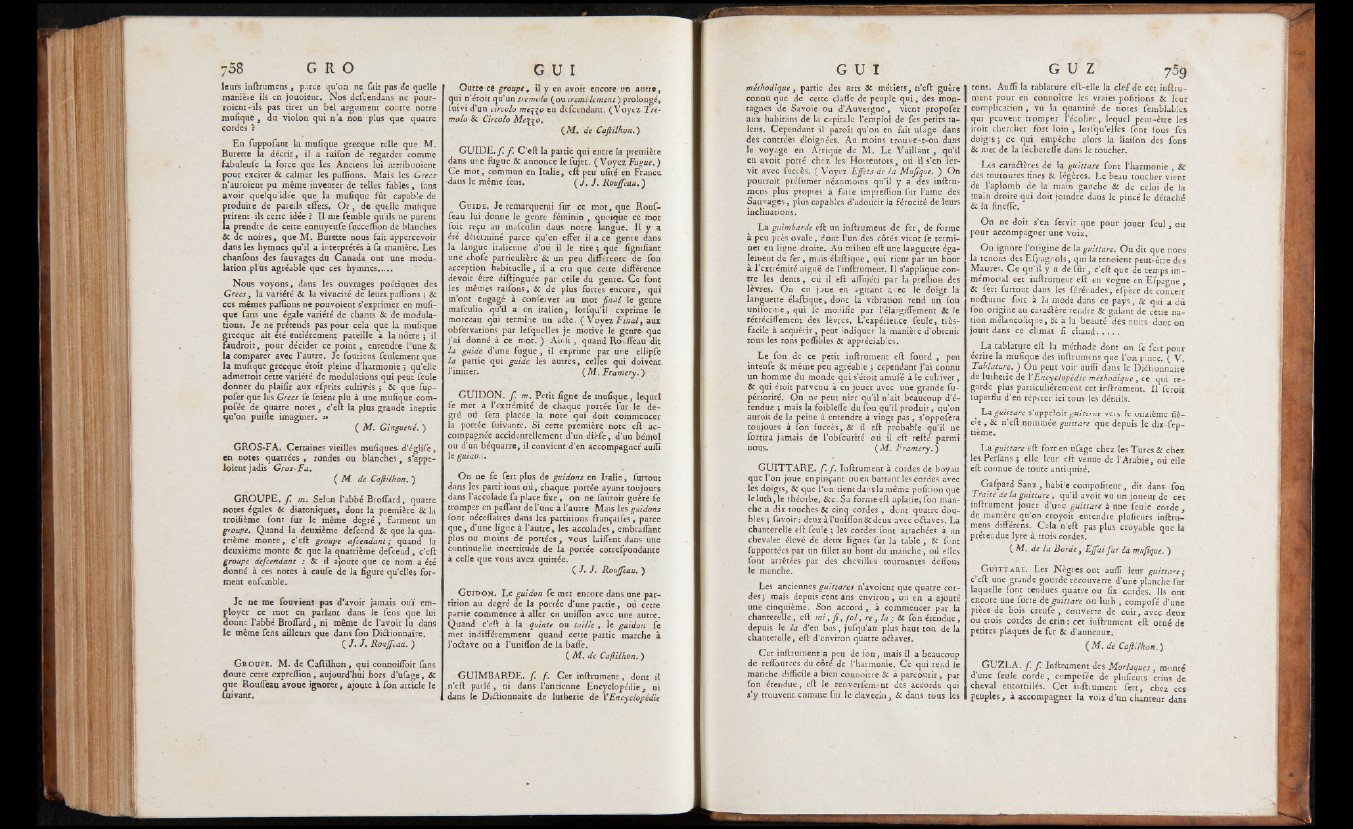
leurs inftrumens, parce qu'on ne fait pas de quelle
manièie ils en jouoient. Nos defeendans ne pourraient
ils pas tirer un bel argument contre notre
mufique , du violon qui n a non plus que quatre
cordes }
E n fuppofant la mulique grecque telle que M .
Burette la décrit, il a raifon de regarder comme
fabuleufe la force que les Anciens lui attribuoient
pour excicer & calmer les pallions. Mais les Grecs
n’auroient pu même inventer de telles fables , fans
avoir quelqu'idte que la mufique fût capable de
produire de pareils effets. O r , de quelle mufique
f»rirenc- ils cette idée ? Il me femble qu’ils ne purent
a prendre de cette ennuyeufe fucceflïon de blanches
& de noires, que M . Burette nous fait appercevoir
dans les hymnes qu’il a interprétés à fa manière. Les
chanfons des fauvages du Canada ont une modulation
pi us agréable que ces hymnes.......
Nous voyons , dans les ouvrages poétiques des
Grecs, la variété & la vivacité de leurs, pallions ; &
ces mêmes pallions ne pouvoient s’exprimer en mufique
fans une égale variété de chants & de modulations.
Je ne prétends pas pour cela que la mufique
grecque ait été entièrement pareille à la nôtre ; il
faudrait, pour décider ce p o in t , entendre Tune &
la comparer avec l’autre. Je foutiens feulement que
la mufique grecque étoit pleine d’harmonie; qu’elle
admettoit cette variété de modulations qui peut feule
donner du plaifir aux efprits .cultivés 5 & que fup-
pofer que les Grecs fe foient plu à une mufique com-
pofée de quatre notes , c’eil la plus grande ineptie
qu'on puiffe imaginer. »
( M. Ginguené. )
G R O S -F A . Certaines vieilles mufiques- d’é g life ,
en notes quarrées , rondes ou blanches, s’appe-
loient jadis Gros-Fa.
( M de C a f iilh o n . )
G R O U P E , f . m. Selon l’abbé Broflard, quatre
notes égales & diatoniques, dont la première & la
troifième font fur le même d e g ré, forment un
groupe. Quand la deuxième defeend & que la quatrième
monte, c ’eft groupe afeendant ; quand la
deuxième monte & que la quatrième defeeud, c’eft
groupe descendant : & il ajoute que ce nom a été
donné à ces notes à caufe de la figure qu’elles forment
enfcmble.
Je ne me fou viens pas d’avoir jamais o u ï employer
ce mot en parlant dans le fens que lui
donne l’abbé Brollard, ni même de l’avoir lu dans
le même fens ailleurs que dans fon Diftionnaire.
( J. J. Roujfeau. )
G roupe. M . de Ca ftilh on , qui connoifloit fans
doute cette exprelfion, aujourd'hui hors d’u fage, &
que Rouffeau avoue ignorer, ajoute à fon article le
Suivant.
1 Outre ce groupe, il y en avoit encore un autre,
qui n’étoit qu’un trémolo ( ou tremblement) prolongé,
luivi d’un circolo me\^o en defeendanr. (Voyez Trémolo
& Circolo Me[[0.
(M . de Cafiilhon.')
GUIDE, f . f C ’eft la partie qui entre la première
dans une fugue & annonce le fujet. (Voyez Fugue.)
Ce mot, commun en Italie, eft peu ufité en France
•dans le même fens. ( J . J. Roujfeau.)
Guide. Je remarquerai fur ce mot, que Rouffeau
lui donne le genre féminin , quoique ce mot
foit reçu au mafeulin daus notre langue. Il y a
été déterminé parce qu’en effet il a ce genre dans
la langue italienne d’où il le tire ; que lignifiant
une chofe particulière & un peu différente de fon
acception habituelle, il a cru que cette différence
devoir être diftinguée par celle du genre. Ce font
les mêmes raifons, & de plus fortes encore, qui
m’ont engagé à confier ver au mot final le genre
mafeulin qu’il a en italien, lorfqii’il exprime le
morceau qui termine un a<fte. ( Vovez Final, aux
obfervations par lefquclles je motive le genre- que
j’ai donné à ce mot.-) Ainfi, quand Rouffeau dit
la guide d’une fugue, il exprime par une ellipfe
la partie qui guide les autres, celles qui doivent
l’imiter. ( M. Framery. )
GUIDON, f . m. Petit ligne de mufique, lequel
fe met à l’extrémité de chaque portée fur le degré
où fera placée la note qui doit commencer
la portée fuivante. Si cette première note eft accompagnée
accidentellement d’un dièfe, d’un bémol
ou d’un béquarre, il convient d'en accompagner aulfi
le guido.i.
On ne fe fert plus de guidons en Italie, furtout
dans les partirons où, chaque portée ayant toujours
dans l’accolade fa place fixe , on ne fauroit guère fe
tromper en paffant de l’une à l’autre Mais les guidons
font néceffaires dans les partitions françaifes, parce
que, d’une ligne à l’autre, les accolades, embraflant
plus ou moins de portées, vous laiffent dans une
continuelle incertitude de la portée correfpondante
à celle que vous avez quittée.
( /. J. Roujfeau. )
G uidon. Le guidon fe met encore dans une partition
au degré de la portée d’une partie, où cette
partie commence à aller en uniffon avec une autre.
Quand c’eft à la quinte ou taille, le guidon fe
met indifféremment quand cette partie marche à
l’o&ave pu à l’uniffon de la baffe.
( M. de Caftilhon. )
GUIMBARDE, f . f . Cet inftrument, dont il
-n’eft parlé, ni dans l’ancienne Encyclopédie, ni
dans le Dictionnaire de lutherie de l‘Encyclopédie
méthodique 3 partie des arts & métiers, n’eft guère
connu que de cette dalle de peuple qui, des montagnes
de Savoie ou d’Auvergne, vient propofer
aux habitans de la capitale l’emploi de fes petits ta-
lens. Cependant il paroît qu’on en fait ufage dans
des contrées éloignées. Au moins trouve-t-on dans
le voyage en Afrique de M. Le Vaillant , qu’il
en avoit porté chez les Hottentots, où il s’en fer-
vit avec fuccès. ( Voyez Effets de la Mufique. ) On
pourroit préfumer néanmoins qu’il y a des inftru-
mens plus propres à faire impreflïon fur l’ame des
Sauvages, plus capables d’adoucir la férocité de leurs
inclinations.
La guimbarde eft un inftrument de fer, de forme
à peu près ovale , dont l’un des côtés vient fe terminer
en ligne droite. Au milieu eft une languette également
de fer, mais élaftique, qui tient par un bout
à l ’extrémité aiguë de l’inftrurpent. Il s’applique contre
les dents, où il eft affùjéti par la preflion des
lèvres. On en joue en agitant 2. ec le doigt la
languette élaftique, dont la vibration rend un fon
uniforme, qui fe modifie par l’élargtffement & le
rétréciffement des lèvres. L’expérience feule, très-
facile à acquérir, peut indiquer la manière d’obtenir
tous les tons poffibles & appréciables.
Le fon de ce petit infiniment eft fourd , peu
intenfe & même peu agréable ; cependant j’ai connu
un homme du monde qui s’étoit amufé à le cultiver,
& qui étoit parvenu à en jouer avec une grande fu-
périorité. On ne peut nier qu’il n’ ait beaucoup d’étendue
; mais la foibleffe du fon qu’il produit, qu’on
auroit de la peine à entendre à vingt pas , s’oppofera
toujours à ion fuccès, & il eft probable qu’il ne
fortira jamais de l’obfcurité où il eft refté parmi
nous. | (ÏH. Framery.)
GUITTARE. f . f . Infiniment à cordes de boyau
que l’on joue, en pinçant ou en battant les cordes avec
les doigrs, & que Ton tient dans la même pofition que
le luth, le théorbe., &c. Sa forme eft aplatie; fon manche
a dix touches & cinq cordes , dont quatre doubles
; favôir: deuxà l’uniffon&deux avecoélaves. La
chanterelle eft feule ; les cordes font attachées à un
chevalet élevé de deux lignes fur la table , & font
fupportées par un fîllet au bout du manche, où elles
font arrêtées par des chevilles tournantes deffous
le manche.
Les anciennes guittares n’avoient que quatre cordes;
mais depuis cent ans environ, on en a ajouté
une cinquième. Son accord, à commencer par la
chanterelle, eft mi, f i , fo l, re , la ; & fon étendue,
depuis le la d’en bas, jufqu’au plus haut ton de la
chanterelle, eft d'environ quatre oélaves.
Cet inftrument a peu de fon , mais il a beaucoup
de refiources du côté de rharmonie. Ce qui rend le
manche difficile à bien connoître & à parcourir, par
fon étendue, eft le renverfement des accords qui
s'y trouvent comme fur le clavecin,, & dans tous les
tons. Auffi la tablature eft-elle la clef de cet inftrument
pour en connoître les vraies pofitions & leur
complication , vu la quantité de notes fembiablcs
qui peuvent tromper récolier, lequel peut-être les
iroit chercher fort lo in, lorfqu’elIeS font fous fes
doigts; ce qui empêche alors la liaifon des fons
& met de la féchereffe dans le toucher.
Les car-a&ères de la guittare font l’harmonie , &
des tournures fines & légères. Le beau toucher vient
de l’aplomb de la main gauche & de celui de la
main droite qui doit joindre dans le pincé le détaché
& la fineffe.
On ne doit s’en fervir que pour jouer feul, ou
pour accompagner une voix.
On ignore l’origine de la guittare. On dit que nous
la tenons des Efpagnols, qui la tenoienr peut-être des
Maures. Ce quïL y a de fur^ c’eft que de temps immémorial
cet inftrument eft en vogue en Efpagne ,
& fert furtout dans les férénades, efpèce de concert
nodlurne fort à la mode dans ce pays, & qui a du
fon origine au caractère rendre & galant de cette nation
mélancolique, & à la beauté des nuits dont on
jouit dans ce climat fi chaud.........
La tablature eft la méthode dont on fe fert pour
écrire la mufique des inftrumens que l’on pince. ( V .
Tablature. ) On peut voir auffi dans le Diélionnaire
de lutherie de l’Encyclopédie méthodique , ce qui regarde
plus particuliérement cet inftrament. Il feroit
fuperflu d’en répéter ici tous les détails.
La guittare s appefoit guiterne vers le onzième fiè-
oe , & n’eft nommée guittare que depuis le dix-fep-
tième.
La guittare eft fort en ufage chez les Turcs & chez
les Perfans ; elle leur eft venue de l'Arabie, où elle
eft connue de toute antiquité.
Gafpard Sanz, habi'e compofiteur, dit dans fon
Traité delà guittare, qu’il avoit vu un joueur de cet
inftrument jouer d’une guittare à une feule corde
de manière qu’on croyoit entendre plufieurs inftrn-
mens différens. Cela n'eft pas plus croyable que k
prétendue lyre à. trois cordes.
( M. de la Borde, Effai fur la mufique. )
Guittare. Les Nègres ont auffi leur g u itta r e;
c’eft une grande gourde recouverte d’une planché fur
laquelle font tendues quatre ou fix cordes. Ils ont
encore une forte de guittare ou luth , compofé d’une
pièce de bois creufe, couverte de cuir, avec deux
ou trois cordes de crin : cet inftrument eft orné de
petites plaques de fer & d’anneaux.
( M. de Cafiilhon. )
GUZLA. f . f . Inftrument des Morlaques , monté
d’une feule corde , compofée de plufieurs crins de
cheval entortillés. Cet inftiument fert, chez ces
peuples, à accompagner la voix d’un chanteur dans