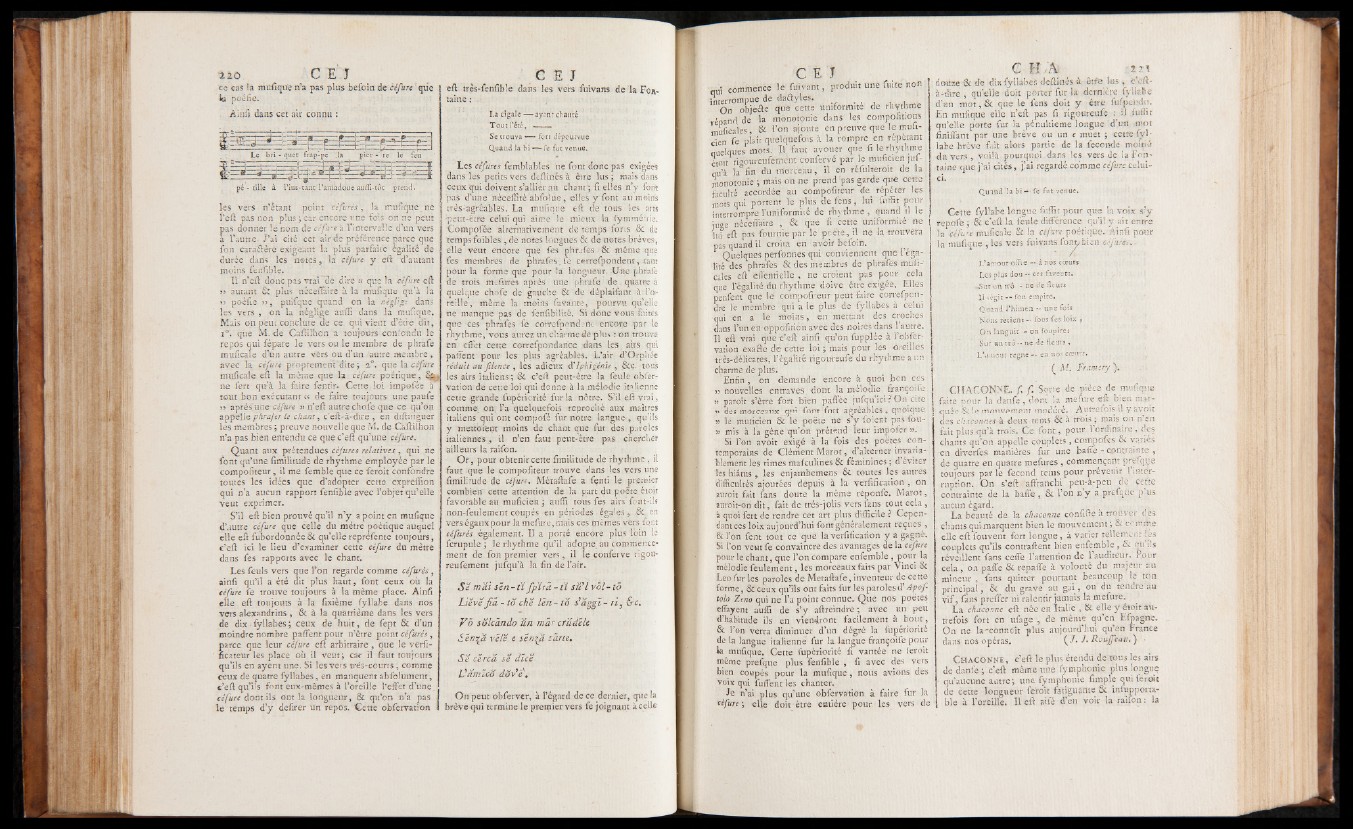
t io C E . J
ce cas la miifiqu'e n’a pas plus befoin àtcèfure que
la poulie. . ' - f . •. ;
Ainfi dans cet air connu :
, Le bri - quet frap-pe .la pièr -' re lé feu
pé - tille à Pins-tànt 'l’amadoue aufli-tôt prend/
les vers n’étant point céfurés, la mufique, ne ■
i’eft pas non plus ; car encore une fois on ne peut
pas donner le nom de céfure à l’intervalle d’un vers •
à l’autre. J’ai cité cet air de préférence parce que ;
fon caractère exigeant la plus parfaite égalité de ■
durée dans les notes, la céfure y eft d’autant
moins fentible.
11 n’eft donc pas vrai de dire « que la céfure eft
sa autant St plus néceffaire à la imifique qu’à la
33 poéfie 33, puifique quand on la néglige dans
les vers , on la néglige aufli dans la mufiqiie.
Mais on peut .conclure de ce qui vient d’être dit,
i°'. que M. de Cardlhon a toujours- con! ou du le
repos qui fépare le vers ou le membre de phrafe
muficale d’un autre vers ou d’un autre membre ,
avec la céfure proprement dite ; 2°. que la céfure
muficale eft la même que l a . céfure poétique,
ne fert qu’à la faire fentir- Cette , loi impoiée à •:
tout bon exécutant ce de faire toujours une paufe '
33 après une céfure » n’eft autre chofe que ce qu’on :
appelle phràfer le chant, c’eft-â-dire , en diftinguer \
les membres ; preuve nouvelle que M. de Caftilhon
n’a pas bien entendu ce que c’eft qu’une céfure.
Quant aux prétendues cèfures relatives, qui ne
font qu’une fimilitude de rhythme employée par le
compofiteur, il me femble que ce feroit confondre
toutes les idées que d’adopter cette expreffion
qui n’a aucun rapport fenfible avec l’objet qu’ elle
veut exprimer.
S’il eft bien prouvé qu’il n’y a point en mufique
d’autre céfure que celle du mètre poétique auquel ,
elle eft fubordonnée & qu’elle repréfente toujours ,
c’eft ici le lieu d’examiner cette céfure du mètre
dans fes rapports avec le chant.
Les feuls vers que l’on regarde comme céfurés,
ainfi qu’il a été dit plus haut, font ceux où la
céfure le trouve toujours à la même place. Ainfi
elle eft toujouts à la fixième fyllabe dans nos
vers alexandrins , & à la quatrième dans les vers
de dix • fyllabes ; ceux de huit, de fept & d’un
moindre nombre paffent pour n’être point céfurés,
parce que leur céfure eft arbitraire, que le verfi-
ncateur les place où il veut; car il faut toujours
qu’ils en ayent une. Si les vers très-courts, comme
ceux de quatre fyllabes, en manquent abfolunient,
c ’eft qu’ils font eux-mêmes à l’oreille l’effet d’une,
céfure dont ils ont la longueur, & qu’on n’a pas I
le temps d’y defirer un repos. Cette obfervation i
C EJ
eft trè s -fen fib le dans le s v e r s fu iv a n s d e la Fon taine
:
I.a cigale — ayant chance
Tout l’été , ...
Se trouva— fore dépourvue
Quand la bi —~ le fut venue.
Les céfurés femblables ne font donc pas exigées
dans les petits vers deftinés à être lus ; mais dans
ceux qui doivent s’allier ail chant\ fi elles n’y font
pas d’une nécefîité abfolue, elles y font au moins
très-agréables. La mufique eft de tous les arts
■ peut-être celui qui aime le mieux la fymmé-iie.
Compofée alternativement de temps forts 8c de
tempsfoibles,de notes longues & de notes brèves,
elle veut encore que fes phrafes 8c même que
fes membres de phrafe*». le ccrrefpondent , tant
pour la forme que pour la longueur. Une phrafe
de trois mefures après une phrafe d e . quatre a
quelque chofe de gauche & de déplaifant àTa-
r cille, même la moins fa vante, pourvu qu’elle
ne manque pas de fenfibilitê. Si donc vous faites
que ces phrafes fe correfpondjm encore par le
rhythme, vous aurez tm charme de plus I on trouve
en effet cette correfpondance dans les airs qui
paffent pour les plus agréables. L’air d’Orphée
réduit au filence , les adieux d'Iphigénie , 8cç. . tous
les airs italiens ; & c’eft peut-être la feule obfervation
de cette loi qui donne à la mélodie italienne
cetie grande fupériorité fur la notre. S’il eft vrai,
comme on l’a quelquefois reproché aux maîtres
italiens qui ont compofé fur notre langue-, qu’ils
ÿ m e t ten t moins de chant que fur des paroles
italiennes , il n’en faut peut-être pas chercher
ailleurs la raifon.
O r , pour obtenir cette fimilitude de rhythme , il
faut que le compofiteur trouve dans les vers line
fimilitude de cifu re. Métaftafe a fenti le premier
combien cette attention de la part du poète étoit
favorable au muficien ; au fil tous fes airs font-ils
non-feulement coupés en périodes égales, 8c en
vers égaux pour la mefure,mais ces mêmes vers font
eéfurés également. 11 a porté encore plus loin le
fcrupule ; le rhythme qu’il adopte au commencement
de fon premier vers, il le conferve rigou-
reufement jufqu’à la fin de l’air.
Se mai sert - tï fpïra - lî sifl vol - tô
Lïevefia - to che len-to s’aggi- ri, &c,
Vb solcàndo un mâr cru de U
Sen^d vîle e sen^a tarte.
Se cercd se due
Vamlco dôvë,
On peut obferver, à l’égard de ce dernier, que la
brève qui termine le premier vers fe joignant à celle
C E J
nui commence le fuivant, produit une fuite non
interrompue de daâÿles. . , J j l / i
On objéâe que cette uniformité de rhythme
répand de la monotonie' dans' les compofitions
ntuficaies, & l ’on ajoute en preuve que le muft-
cien fe plaît quelquefois à la rompre en répétant
Quelques mots. Il faut avouer que fi le rhythme
étoit rigoureufement confervé par le muficien jui-
quà la fin du morceau, il en rêfulteroït de la;
monotonie ; mais on ne prend-pas garde que cette
faculté accordée au compofiteur de repeter les
mots qui portent le plus de fens, lui fuffit pour
interrompre funiformité de rhythme , quand ü le
juge néceffaire , 8c que fi cette uniformité' ne
lui eft pas fournie par le poète, il ne la trouvera
pas quand il croira en avoir befoin.
Quelques perfonnes qui conviennent que l’égalité
des phrafes 8c des membres de phrafes rami-1
cales eft effentielle , ne croient pas pour cela
que l’égalité du rhythme doive être exigée. Elles
penfent que le' compofiteur peut faire correfpcn-
dre le membre qui a le plus de fyllabes à celui
qui en a le moins, en mettant des croches
dans l’un en oppofiticn avec des noires dans l’autre.
Il eft vrai que c’eft ainfi qu’on fupplee à l’obfer-
vation exafte de cette loi ; mais pour les oreilles;
très-délicates, l’égalité rigoureufe du rhythme ai:n
charme de plus.
Enfin, on demande encore à quoi bon ces
33 nouvelles entraves dont la mélodie ; françoife
paroît s’être fort bien paffée jufqu’icr? On cite
3> des morceauxjpii font fort agréables, quoique
» le muficien 8c le poète ne s’y fotent pas fou-y
33 mis à la gêne qu’on prétend leur impofer 33.
Si l’on avoit exigé à la fois des poètes contemporains
de Clément Marot, d’alterner invariablement
les rimes maficulines 8c féminines ; d éviter
les hiatus , les enjambemens 8c toutes les autres
difficultés ajoutées depuis à la yerfification , on
auroit fait fans doute la même réponfe. Marot,
auroit-on dit, fait de très-jolis vers fans tout cela ,
à quoi fert de rendre cet art plus difficile ? Cependant
ces loix aujourd’hui font généralement reçues ,
& l’on fent tout ce què la verfification y a gagné.
Si l’on veut fe convaincre des avantages de la céfure
pour le chant, que l’on compare enfemble , pour la
mélodie feulement, les morceaux faits par Vinci 8c
Léo fur les paroles de Metaftafe, inventeur de cette
forme, 8c ceux qu’ils ont faits fur les paroles d’ Apof-
tolo Zeno qui ne l’a point connue. Que nos poètes
effayent auffi de s’y aftreindre ; avec un peu
d’habitude ils en viendront facilement à bout ,
8c l’on verra diminuer d’un dégré la fupériorité
de la langue italienne fur la langue françoife pour
la mufique. Cette fupériorité fi vantée ne leroit
même prefque plus fenfible , fi avec des vers
bien coupés pour la mufique, nous avions des
voix qui fuffent les chanter.
Je n’ai plus qu’une obfervation à faire fur la
céfure ; elle doit être entière pour les vers de
G H/'Aj :%t\
douze 8c de dix fyllabes deftinés à être lus , c ’eft-
à-dire , qu’elle doit porter' fur la dernière fyllabe
d’an mot, 8c que le fens doit y être fufpehdu.
En mufique elle n’eft pas fi rigoureufe : il fuffit
qu’elle porte fur la pénultième longue d’un mot
finiffant par une brève ou un e muet ; cette fyl -
labe brève fait alors partie de la fécondé moitié
du vers , voilà pourquoi dans les vers de la Fontaine
que j’ai cités, j.’ai regardé comme céfure celui-
ci.
Quand la bi -• fe fut venue.
Cette fyllabe longue fuffit pour que la voix s’y
repofe ; & c’eft la feule différence qui! y ait entre
la Céfit'e muficale & la cifim poétique. Ainfi pour
la mufique , les vers fuivans fom, bien c i farts.-
L’amouroicie — d nos coeurs
Les pi us dou - ces faveurs.
«»Sur mi trô - ne de fleurs
Il légit -- fort empire*
Quand l’himen. - une fois
Nous retient — fous fes loix ,
On languir — on foupire:
Sur kq trô -- ne de fleurs ,
L ’amour régné — en nos ccsurs.
ï| M. Framery ) .
CÎIACONNE. f f . Sorte de pièce de mufique
; faite pour la danfe, dont la me fur e eft bien mar-
j- qué'e & le mouvement modéré. Autrefois il y avoit
des ck.icûnnts à deux tems 8c à trois \ mais on n’en
fait plus qu’à trois. Ce fon t, pour 1 ordinaire , des
chants qu’on appelle couplets, compo'&s 8c varies
en diverfes manières fur une baffe - contrainte ,
de quatre en quatre mefures , commençant prefque
toujours parle fécond tems pour prévenir 1 .interruption.
On s’eft affranchi peu-à-peu f e cette
contrainte de la baffe , 8c l’on n’y a prefque p us
aucun égard.
La beauté de la chaconne confifte à troüvèr dès
chants qui marquent bien le mouvement; 8c comme
elle eft fouvent fort longue, à varier tellement les
couplets qu’ils contraftent bien enfemble , 8c qu ils
réveillent fans ceffe l’attention de l ’auditeur. Pour
cela, on paffe 8c repaffe à volonté du majeur au
mineur , fans quitter pourtant beaucoup le ton
principal, 8c du grave au g a i, ou du tendre au
v i f , fans preffer ni ralentir jamais la mefure.
La chaconne eft née en Italie , 8c elle y étoit autrefois
fort en ufage , de même qu’en Ëlpag-ne.
On ne la^conncît plus aujourd’hui qu’en France
dans nos opéras. ( ƒ . J. Roujfeau. ) •
C h a co n n e , c’eft le plus étendu de fous les airs
de danfe ; c’eft même u n e fy si phonie plus longue
- qu’aucune autre; une fymphonie fimple qui feroit
de cette longueur feroit fatiguante 8c infupporta-
■ ble à l’oreille. Il eft aifé d’en voir la raifon : la