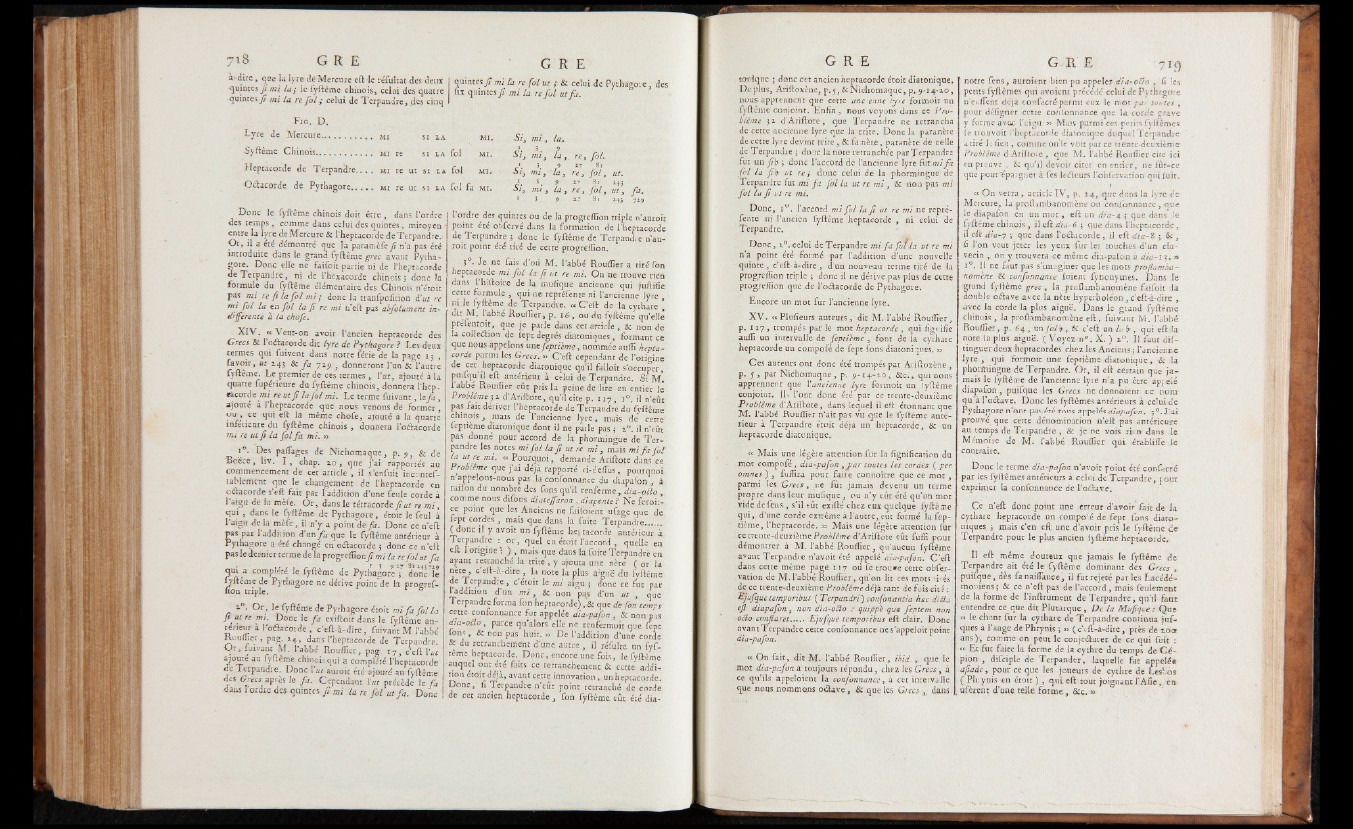
a-d ire, que la lyre dé Mercure eft le réfuitat dés deux I
quintes/ /mi la^ le fyftême chinois, celui des quatre
•quintes y? mi la re fo l ,• celui de Terpandre, des cinq 1
quintes f i mi la re fol ut ; & celui de Pythagore , des
ux quintes f i mi la re fo l ut fa.
Fig . D .
Ly re de M e r c u r e . . . . . .............mi s i la m i . Si, m i, la.
Syftême C h i n o i s . . . . . . ............. mi re s i là fol mi. S i, mi, L , r e , f o l . -
Heptacorde de T e rp a n d r e .... m i re ut s i la fol m i . S i, mi, la, re, fo l , ut.
O&acorde de Pythagore.......... m i re ut si la fol fa m i . Si, m i, la , re, fo l , ut*, fa.
1 3 | X7 . 3i i 4j 7i 9
Donc le fyftême chinois doit ê t re , dans l ’ordre
des temps , comme dans celui des quintes, mitoyen
entre^ la lyre de Mercure & l’heptacorde de Terpandre.
O r , il a été démonrré que la paramèfey* n’a pas été
introduite dans le grand fyftême grec avant Pythagore.
Donc elle ne faifoit partie ni de l’heptacorde
de Terpandre, ni de l'hexacorde chinois ; donc la
formule du fyfteme élémentaire des Chinois n’étoit
pas mi re fi la fo l mi ,• donc la tranfpofition d'ut re
mi fo l la en fo l la f i re mi h’eft pas abfolument indifférente
a la chofe.
X IV . «e Veut-on avoir l’ancien heptacorde des
Grecs & 1 oCtacorde dit lyre de Pythagore ? 'Les deux
termes qui fuivent dans notre férié de la page 13 ,
fa voir, ut 243 & fa 725) , donneront l’un ^ l ’autre
fyftême. Le premier de ces termes , Y ut, ajouté à la
quarte fupérieure du fyftême chinois, donnera l’hep-
fâcorde mi re ut f i la fo l mi. Le terme fuivan t, le f a ,
ajoute à 1 heptacorde que nous venons de former,
ou , ce qui eft la même ch ofe, ajouté à la quarte
inferieure du fyftême chinois , donnera l’oétacorde
mi re ut f i la fo l fa mi. »
i ° . Des partages de Nichomaque, p. 9 , & dé
F îoëce, liv . I , chap. 2 0 , que j ’ai rapportés au
commencement de cet article , il s'enfuit incontef-
tablemcnt que le changement de l’heptacorde en
oCtacorde s eft fait par l’addition d’une feule corde à
1 aigu de la mèfe. O r , dans le tétracorde f i ut re mi,
qui , dans le fyftême de Pythagore, étoit le feul à
l ’aigu de la mèfe, il n’y a point àéfa. Donc ce n’eft
pas par 1 addition d’un f a que le fyftême antérieur à
Pythagore a été changé en oétacorde j donc ce n’eft
pas le dernier terme de la progreflion f i mi la re fo l ut fa
qui a complété le fyftême de Pythagore j, donc le
fyftême de Pythagore ne dérive point de la progreflion
triple. &
2 . v_>r, le lyltenre de Pythagore étoit mi fa fo l l
f i acre mi. Donc le fa exiftoit dans le fyftême an
rérieur à Kodatorde , c eft-à-dire, fuivant M l’abb
Rou fljer, pag. 24, dans l'heptacorde de Terpandre
C r i fuivant M. l’abbé Rouflier, pag. 1 7 , e’eft Vu
ajouté au fyfteme chinois qui a complété l’heptacord
de Terpandre. Donc l'ut auroit été ajouré au fyftêm
des Grecs après le fa . Cependant l'ut précède le f
dans I ordre des quintes f i mi la re fo l ut fa . D on
1 ordre des quinres ou de la progreflion triple n’auroit
point été obfervé dans la formation de l ’heptacorde
de Terpandre j donc le fyftême de Terpandre n’auroit
point été tiré de cette progreflion.
30. Je ne fais d’où M . l ’abbé Rouflïer a tiré fon
heptacorde mi fo l la f i ut re mi. On ne trouve rien
dans l’hiftoire de la muflque ancienne qui juftifie
cette formule , qui ne repréfente ni l’ancienne lyre
ni le fyftême de Terpandre. ce C ’eft de la cythare *
dit M . l’abbé Rouflier, p. 16 , ou du fyftême qu’elle
prefentoit, que je parle dans cet article , & non de
la collection de fept degrés diatoniques, formant ce
que nous appelons une feptième, nommée aufli hepta-
- corde parmi les Grecs. » C ’eft cependant de l’origine
de cec^ heptacorde diatonique qu’il falloit s’occuper,
puifqu’ îl eft antérieur à celui de Terpandre. Si M*.
l’abbé^ Rouïfier eût pris la peine de lire en entier lé
Problème 3 2 d’Ariftoce, qu’il cite p. 1 1 7 , i ° . il n’eût
pas fait dériver l’heptacorde de Terpandre du fyftême
chinois, mais de l’ancienne ly r e , mais de cette
feptième diatonique dont il ne parle pas ; 2°..il n’eût
pas donné pour accord de la phormingue de T e r pandre
Tes notes mi fo l la f i ut re mi, mais mi fa fo l
la ut re mi. « Pourquoi, demande Ariftote dans ce
Problème que j’ai déjà rapporté ci-deflus, pourquoi
n’appelons-nous pas .la confonnance du diapafon , à
raifon du nombre des fons qu’il renferme,.dia-ofto ,
comme nous difons diateffaron, diapente ? Ne feroi:-
ce point que les Anciens ne faifoi-ent ufage que de
fept cordes , mais que dans la fuite Terpandre........
(d on c il y avoir un fyftême hej tacorde antérieur à
•Terpandre : o r , quel en étoit l'accord , quelle en
eft 1 origine ? ) , mais que dans la fuire Terpandre en
ayant retranché la trite , y ajouta une nète ( or la
nète , c eft-à.-dire , la note la plus aiguë du fvftême
de Terpandre, cécoir le mi aigu 5 d'onc ce fut par
1 addition d un m i, 8c non pas d’un ut , que
Terpandre forma fon heptacorde) que de fon temps
cette- confonnance fut appelée dia-pafon, & non pas
dia-oÜo, parce qu alors elle ne renfermoit que fept-
ion«, & non pas huit. 33 De l’addition d’une corde
& du retranchement d’une autre , il réfui te un f y f teme
heptacorde. D o n c , encore une fois, le fyftême
auquel ont ƒ té faits ce retranchement & cette addition
étoit déjà, avant cette innovation, un heptacorde.
D o n c , fi Terpandre n’eût point retranché de corde
de cet ancien heptacorde, fon fyftême eut été diatonique
j donc cet ancien heptacorde étoit diatonique.
Déplus, Ariftoxène, p.y, & Nichomaque, p .5-14-20,
nous apprennent que cette anc enne lyre formoit un
fyftême conjoint. E nfin, nous voyons dans ce Problème
32 d’A r ifto te , que Terpandre ne retrancha
de cette ancienne lyre que la trite. Donc la paranète
de cette lyre devint trite, & fa nète, paranète de celle
de Terpandre 3 donc la note retranchée par Terpandre
fut un fibÿ donc l ’accord de l’ancienne lyre fut mi fa
fo l la f i 1» ut re ; donc celui de la phormingue de
Terpandre fut mi fa fo lia ut re m i, & non pas mi
fo l la f i ut re mi.
Donc, i ° . l’accord mi fo l la f i ut re mi ne repréfente
ni l’ancien fyftême heptacorde , ni celui de
Terpandre.
D o n c , 2°. celui de Terpandre mi fa fo l la vt re mi
n’a point été formé par l’addition d'une nouvelle
quinte, c’eft-à-dire, dun nouveau terme tiré de la
progreflion triple ; donc il ne dérive pas plus de cette
progreflion que de l ’odtacorde de Pythagore.
Encore un mot fur l’ancienne lyre.
X V . ccPlufieurs auteurs, dit M. l’abbé Rouflier,
p. 1 1 7 , trompés par le mot heptacorde , qui fl'gnifie
aufli un intervalle de feptième , font de la cythare
heptacorde un compofé de fept fons diatoniques. »
Ce s auteurs ont donc été trompés par Ariftoxène ,
p. 5 , par Nichomaque , p. 5 - 14 -2 0 , &c.', qui nous
apprennent que P ancienne lyre formoit un îyflême
conjoint. Ils l’ont donc été par ce trente-deuxième
Problème d’Ariftote, dans lequel il eft étonnanc que
M . l’abbé Rouflier n’ait pas vu que le fyftême antérieur
à Terpandre étoit déjà un heptacorde, & un
heptacorde diatonique.
cc Mais une légère attention fur la lignification du
mot compofé, dia-pafon , par toutes les cordes ( per
omnes ) , fuffira pour, faire connoître que ce m o t ,
parmi les Grecs, ne fût jamais devenu un terme
propre dans leur mulique, ou n’y eût été qu’un mot
vide de feus , s’ il eût exifté chez eux quelque fyftême
qui, d’une corde extrême à l ’autre, eue formé la feptième,
l’heptacorde. sa Mais une légère attention fur
ce trente-deuxième Problème à' Ariftote eût fuffi pour
démontrer à M . l'abbé Rouflier, qu’aucun fyftême
avant Terpandie n’avoit été appelé dia-pafon. C ’ eft
dans cette même page 1 1 7 où fe trouve cette obfer-
vation de M . l ’abbé Rouflier, qu'on lit ces mots iivés
de ce trente-deuxième Problème déjà tant de fois cité :
Ejufquc temporibus ( Terpandri) confonantia h&c ditta
eft diapafon, non dia-oHo ; quippè que feptem non
o5ho conftaret...... Ejufque temporibus eft clair. Donc
avant Terpandre cette confonnance ne s’appeloit point
dia-pafon-
« On fait, dit M . l’abbé Rouflier, ibid. , epue le
mot dia-pafon a. toujours répondu, chez les Grecs, à
ce qu’ils appeloienc la confonnance, à cet intervalle
que nous nommons oda.ve , & que les Grecs x dans
notre fen s, auroient bien pu appeler dia-octo , fi les
petits fyftêmes qui avoient précédé celui de Pythagore
neuffent déjà c o u f acre parmi eux le mot par toutes ,
pour défigner cette confonnance que la corde grave
y forme avec l’aigu. »3 Mais parmi ces petits fyftêmes
le trouvoit »’heptacorde diatonique duquel Terpandre
a tiré le lien, comme on’ le voit parce tiente-dcuxièmer
Problême d Ariftote , que M . l’abbé Rouflier cite ici
en preuve , & qu’il dévoie citer en entier, ne fût-ce
que pourépargner à fes le&eurs i’obfervation qui fuit.
« On verra, article IV , p. 24, que dans la lyre de
Mercure, la proflambanomène ou conionnance, que
le diapafon en un m o t , eft un dia-4.; que dans le
fyftême chinois -, .il eft dia-6 5 que dans riupracorde
il eft dia-7 5 que dans l’octacorde , il eft dia-Z ; & ,
fi l’on veut jeter les yeux fur les touches d’un clavecin
, on y trouvera ce même dia-palon à dia-i 3. »
1°. 11 ne faut pas s’ imaginer que les mots proflambe-
nom'ene & cpnfonnance (oient fv non y mes. Dans .le
grand fyftême grec , la .prollambanomène faifoit la
double o&ave.avec la nète hyperboléon, c’eft-à-dire ,,
avec la corde la plus aiguë. Dans le grand fyftême
chinois, la prollambanomène e f t , fuivant M. l’abbé
Rouflier , p. 64 , un fo l b , & c’eft un lu lr■ , qui eft .Ia
note la plus aiguë. (V o y e z np. X. ) 20. Il faut d il-
tinguerdeux heptacordes chez les Anciens; l’ancienne
l y r e , qui formoit une feptième diatonique, & la
phormingue de Terpandre. O r , il eft eerrain que ja mais
le fyftênre de l’ancienne lyre n’a pu être appelé
diapafon, puifque les Grecs ne donnoient ce nom
qu à l’otftave. Donc les fyftêmes antérieurs à celui de
Pythagore n’ont pas été tous appelés diapafon. 30. J’ai
prouvé que cette dénomination n’eft pas antérieure
au temps de Terpandre , & je ne vois rien dans le
Mémoire de M . l’abbé. Rouflier qui .établifle le
, contraire.
Donc le terme dia-pafon n’avoit point été confacrë
par les fyftêmes antérieurs à celui de Tetpandre, pour
exprimer la confonnance de l’otftave.
C e n’eft donc point une erreur d’avoir fait de la
cythare heptacorde un composé de fept fons diatoniques
; mais c’en eft une d’avoir pris le fyftême de-
Terpandre pour le plus ancien lyftême heptacorde.
Il eft même douteux que jamais le fyftême de
Terpandre ait été le fyftême dominant des Grecs ,
puifque, dès fanaiflance, il fut rejeté parles Lacédémoniens;
& ce n’eft pas de l’accord, mais feulement
de la forme de I’inftrument de Terpandre, qu’il faut
entendre ce que dit Plutarque, De la Mufique : Que
« le ch ant fur la cythare de Terpandre continua ju f-
ques à l’aage de Phrynis ; » ( c ’eft-à-dire, près de 20a
ans)-, comme on peut le conjecturer de ce qui fuit :
ce Et fut faite la forme de la cythre du temps de C é -
piom , difciple de Terpander, laquelle fut appelée
afiade, pour ce que les joueurs de cythre de Lesbos
( Phrynis en étoit ) , qui eft tout joignant l ’A f ic , en
ufèrent d’une telle fo rm e , & c . »