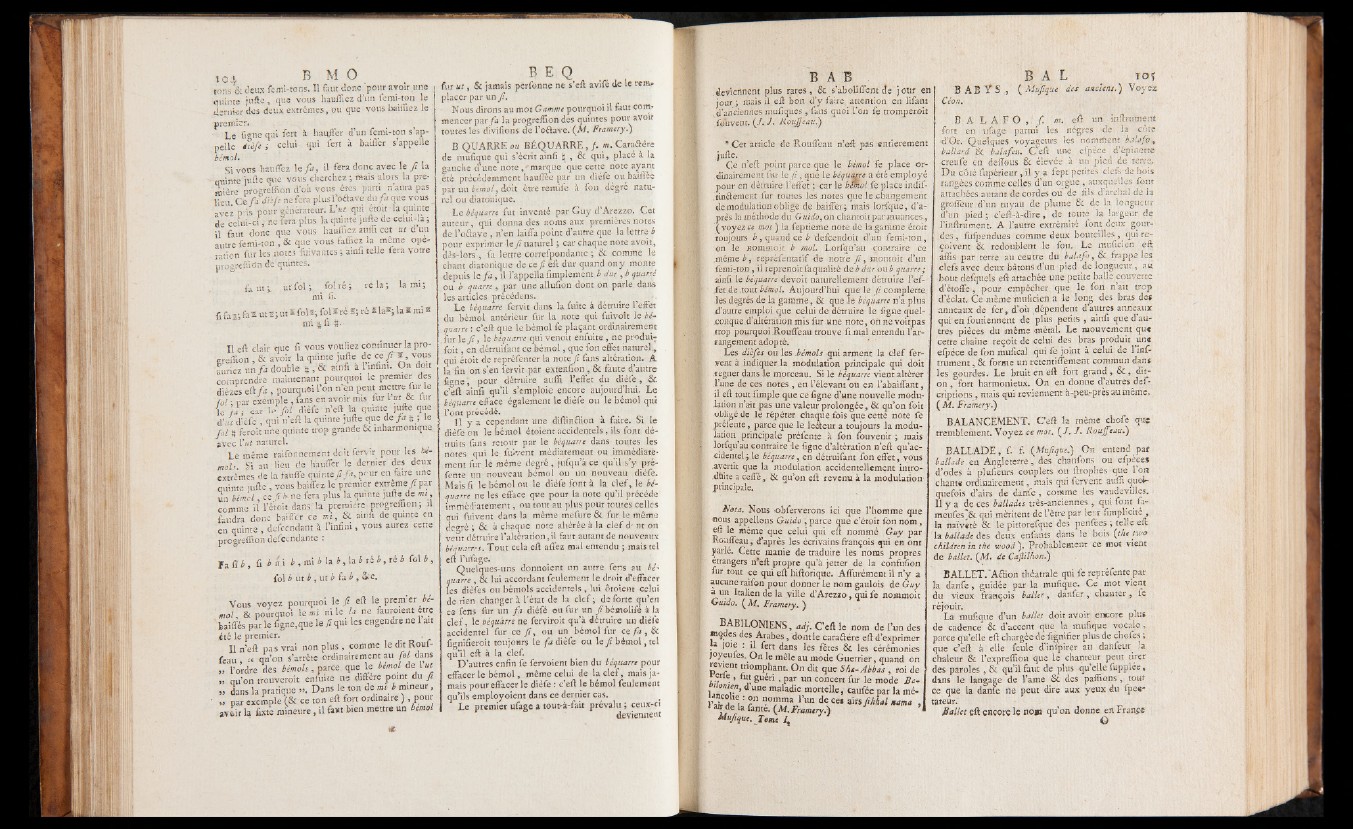
io4 B M O
tons & deux femi-tons. Il faut donc pour avoir une
quinte ju S e , que vous hauffiez d’un femi-ton le
dernier des deux extrêmes, ou que vous bailliez le ;
premier« - N •
Le figne qui fart à-hauffer d’un femi-ton s’appelle
élife ; celui qui lert à bailîèr s’appelle
bémol.
Si vous hauflez le fa , il fera donc avec le f i la
quinte iufle que vous cherchez ; mais alors la première
progreffion d’où Vous êtes parti n aura pas
lieu Ce f °d ii(c nefera plusl’oftave du/n que vous
avez pris pour générateur. Lfit qui étoit la quinte
de celui-ciJ ne fera plus la quinte jufte de celui-là ;
il faut donc que vous hauffiez auffi cet ut d un
autre femi-ton , & que vous faffiez la même ope-
. ration f e les .notes fi Vantes ; ainfi telle fera votre
progreffiOn de quintes. -
fa ut ii ut'fol ; fo ir é ; r ë la ; la mi;
mi 15.
fi fa s ; fa £ uns; ut * fols; fol Srê s ; ré s la*; la s mi s
mi $ fi #•
Il eft clair que fi vous vouliez continuer la pro-
ereffion , & avoir la quinte jufte de g e f ï , vous
auriez un fa double # , & ainfi a 1 infini. On doit
comprendre maintenant pourquoi le premier des
dièzes eft fa , pourquoi l’on n’en peut mettre fur le
fol • par exemple , fans en avoir mis fur 1 ut tic fur
le t f f car le f i l dièfe n eft la quinte jufte que
d’«t dièfe , qui n’eft la quinte jufte que de fa « le
fo l # feroit une quinte trop grande & inharmonique
avec l’ut naturel. .
Le même raifonnernent doit fervir pour les fie-
moh. Si au lieu de h'auffer le dernier des deux
extrêmes de la fauffe q u in te / fa, peur en faire une
quinte jufte , vous baillez le premier extrême / par
un b ém o l, ce fi b- ne fera plus la quinte jufte de mt
comme il l’étoit dans la première progreffion ; il
faudra donc bailler ce mi, & ainfi de quinte en
en quinte , défendant à l’infini, vous aurez cette
progreffion défendante :
p a ff b , fi b n i b , mi b la b , la b ré b , ré b fol b ,
fol b ut b , ut b fa b , Sic,
Vous voyez pourquoi le / eft le: prem er bémol,
8e pourquoi le mi ni le la ne fauro.ent erre
’ baiffés par le ligne,que le /? qui les engendre ne 1 ait
été le premier.
Il n’eft pas vrai non plus , comme le ditRouf-
feau « qu’on s’arrête ordinairement au f i l dans
„ l’ordre des bémols , parce que le bémol de 1 ut
„ qu’on trouveroit enfuite ne différé point du /
„ dans la pratique ». Dans le ton de- m b mineur,
' „ par exemple (& ce ton eft fort ordinaire ) .pour
avait la fixte mineure, il faut bien mettre un bcmol
B E Q
I fur u t , 8c jamais perfonne ne s’eft avifé de le tenir
placer par un fi»
Nous dirons au mot Gamme pourquoi il faut commencer
par fa la progreffion des quintes pour avoir
toutes les divifions de l’o&ave.'(A/. Framery.)
B QUARRE ou BÉQUARRE ,ƒ .ƒ» . CaraSère
de mufique qui s’écrit ainfi fc| , & qui, placé à la
gauche d’une n o tem a rq u e que cette note ayant
été précédemment hauftee par un dièfe ou baiffée
par un bémol, doit être remile à fon degré naturel
ou diatonique.
Le béquarre fut inventé par G uy d’Arezzo. Cet
auteur, qui donna des noms aux premières notes
de l’oétave , n’en laiffa point d’autre que la lettre b
pour exprimer le f i naturel ; car chaque note avoir,
dès-lors , fa lettre correfpondante ; & comme le
chant diatonique de ce f i eft dur quand on y monte
depuis le f a , il l’appella fimplement b dur, b quand
ou b quarre , par une allufion dont on parle dans
les articles précédens. _
Le béquarre fervit dans la fuite à détruire l’effet
du bémol antérieur fur la note qui fuivoît le bè-
quarre : c’eft que le bémol fe plaçant.ordinairement
fur le f i , le béquarre qui venoit enfuite , ne produi-
fo it, en détruifant ce bémol, que fon effet naturel
qui étoit de repréfenter la note f i fans altération. A
la fin on s’en fer vit.par extenfion , & faute d’autre
figne, pour détruire auffi l’effet du diè fe, &
c’eft ainfi qu’il s’emploie encore aujourd’hui. Le
béquarre efface également le dièfe ou le bémol qui
l’ont précédé.
11 y a cependant une diftinèlion à faire. Si le
‘ dièfe ou le bémol étoient accidentels, ils font détruits
fans retour par le béquarre dans toutes les
notes qui le-, fiùvent médiatement ou immédiatement
fur le même degré, jufqu’à ce qu’il :s’y préfente
un nouveau bémol ou un nouveau dièfe.
Mais fi le bémol ou le dièfe font à la c le f, le R*
quarre ne les efface que pour la note qu’il précède
immédiatement, ou tout au plus pour toutes celles
qui fuivent dans la même mefure & fur le même
degré ; & à chaque note altérée à la cle f d 'nt on
veut détruire l’altération,il faut autant de nouveaux
bèquarrrs. Tout cela eft affez mal entendu ; mais tel
eft Tufage.
Quelques-uns donnoient nn autre fens au béquarre
, & lui accordant feulement le droit d’effacer
les dièfes ou bémols accidentels, lui ôtotent celui
de rien changer à l ’état de la c l e f ; de forte qu’en
ce fens fur un fa diéfé ou fur un ƒ bémolifé à la
c l e f , le béquarre ne ferviroit qu’à détruire un dièfe
accidentel fur ce ƒ , ou un bémol fur ce fa 9 &
fignifieroit toujours le fa dièfe ou le f i b ém o l, tel
qu’il eft à la clef.
D ’autres enfin fe fervoient bien du béquarre pour
effacer le bémol, même celui de la cle f, mais jamais
pour effacer le dièfe : c’eft le bémol feulement
qu’ils employoient dans ce dernier cas.
Le premier ufage a tout-à-fait prévalu ; ceux-ci
deviennent
B A B
. deviennent plus rares, & s’aboliffent de j otir en
jour ; mais il eft bon d’y fairev attention en lifant
^d’anciennes mufiques ,-fans quoi.l’ôn fe.tromperoit
fou vent. (AV- éioujjcau.)
* Cet article de HouiTeau n’eft pas entièrement
Jufte.
Ce n’eft point parce que le bémol fe place ordinairement
fur le f i , que le béquarre a. été employé
pour en détruire .l’effet; car le kMol.fe place indif-
.tinftement fur toutes les .notes que le .changement
de modulation oblige de baiffer; mais Iorfque, d’après
la méthode du Guido.,on chan toit par muances,
(v o y e z« mot ) la feptieme note dé la gamme étoit
.toujours b , quand ce b defeendoit d’un femi-ton,
on le jiommoit b mol. Lorfqu’au contraire ce
.même é , repréfentatif de notre ƒ , montoit d’un
femi-rton., il. reprenoit fa qualité deb dur oub quarre;
ainfi le béquarre devoit naturellement détruire l’ef-
,fet debout bémol. Aujourd’hui que le f i complette,
les degrés de la gamme, & que le béquarre n’a plus
d’autre emploi que celui de détruire le figne quel- .
..conque.d’altération mis fur une note, oh ne voitpas
.trop pourquoi Houffeau trouve fi.mal entendu l’ar- ;
rangement adopté.
Les dièfes ou les .bémols qui arment la clef fervent
à indiquer la modulation principale qui doit
.fegiier dans le morceau. Si le béquarre vient altérer
iune de ces notes , en l’élevant ou en l’abaiffant,
il eft. tout fimple que ce figne d’une nouvelle modulation
n’ait pas une valeur prolongée, & qu’on foit
•obligé .de lé répéter chaque fois que cette note fe
préfente, parce que le leâeur a toujours la modulation
principale préfente à fon fouvenir ; mais
lorfqu’au contraire le figne d’altération n’eft qu'accidente
lle béquarre, en détruifant fon effet, vous
.avertit que la modulation accidentellement intro-
dùite a celle, & qu’on eft revenu à la modulation
principale.
Nota. Nous obferverons ici que l’homme que
nous appelions Guido ; parce que c ’étoit fon nom,
eft le même que celui qui eft nommé Guy par
Ronffeau, d’après les écrivains françois qui en ont
parle. Cette manie de traduire les noms propres
etrangers n*eft propre qu’à jetter de la confufion
fur tout ce qui eft hiftorique. Affurément il n’y a
aucune raifon pour donner le nom gaulois de Guy
a un Italien de la ville d’A rezzo, qui fe nommoit
Guido. (A/, Framery. )
■— --xi-xw, uuj. v e i l îc nom ae 1 un aes
mqaes des Arabes, dont le cara&ère eft d’exprimer
• ,01® : “ ^ert dans les fêtes & les cérémonies
joyeuies. On le mêle au mode Guerrier, quand on
revient triomphant. On dit que S ha-Abbas , roi de
»•ƒ e. » fut guéri, par un concert fur le mode Bc-
l °ni‘ n, d une maladie mortelle, caufée par la mé-
S e, : W j a i’un de ce« airsfihhal nama ,
1 fanté* Framery.) 9
Mufique. Terne
B A L TOjf
B A B Y S , {Mufique dis anciens.) Voyez
Céon.
B A L A F O m. eft un inftrument
fort en ufage parmi les nègres de la côté
'd’Or. Quelques voyageurs les nomrfcent balafo,
ballar.d gc bulafeu. C ’eft une efpèce d’épinette
•creufe en deffous 8c élevée à un pied de terre.
Du côté fupérieur, il y a fept petites clefs de bois
rangées comme celles d’un orgue , auxquelles font
attachées autant de cordes ou de fils d’archal de la
grofteur d’un tuyau de plume & de la longueur
d’un pied ; c’eft-à-dire , de toute la largeur de
l’inftrument. A l’autre extrémité font deux gourdes,
fuljpendues comme deux bouteilles , qui reçoivent
& redoublent le fon. Le muficien eft
aftis par terre au centre du. balafo, & frappe les
clefs avec deux bâtons d’un pied de longueur, au
bout defquels eft attachée une petite balle couverte
d’étoffe, pour empêcher que le fon naît trop
d’éclat. Ce même muficien a le long des bras des
anneaux de fer, d’où dépendent d autres anneaux
qui1 en foutiennent de plus petits , ainfi que d autres
pièces du même métal. Le mouvement qu«
cette chaine reçoit de celui des bras produit un*
efpèce de fon mufical qui fe joint a celui de 1 inftrument
, & forme un retenti Bernent commun dans
les gourdes. Le bruit en eft fort grand, & , dit-
o n , fort harmonieux. On en donne d autres def-
criptions , mais qui reviennent à-peu-près au même*
( M. Framery.)
BALANCEMENT. C ’eft la même chofe que
tremblement. Voyez ce mot, ( / . /. Roujfeau.)
B A L L A D E , fi fi {Mufique.) On entend paf
ballade en Angleterre, des chanfons ou efpeces
d’odes à plufieurs couplets ou ftrophes que l’on
chante ordinairement, mais qui fervent auffi quelquefois
d’airs de danfe, comme les vaudevilles. -
Il y a de ces ballades très-anciennes , qui font &“
meufes qui méritent de l’être par lerr fimpbeité ,
la naïveté & le pittorefque des penfées ; telle eft
la ballade des deux enfants dans le bois (the two
children in the wood ). Probablement ce mot vient
de ballet. (M. de Cafiilhon.)
BALLET.'Aâion théâtrale qui fe repréfente par
la danfe, guidée par la mufique. Ce mot vient
du vieux françois b aller, danfer , chanter, fe
réjouir. .
La mufique d’un ballet doit avoir encore plus
de cadence & d’accent que la mufique vocale, .
parce qu’elle eft chargée de fignifier plus de chofes ;
que c ’eft à elle feule d’infpirer au danfeur la
chaleur & l’expreflion que le chanteur peut tirer
des paroles , & qu’il faut de plus qu’elle fupplée,
dans le langage de l’ame & des pallions, tout
ce que la danle ne peut dire aux yeux du fpe«-
tateurV
Ballet eft encore le n o» qu’on donne en France