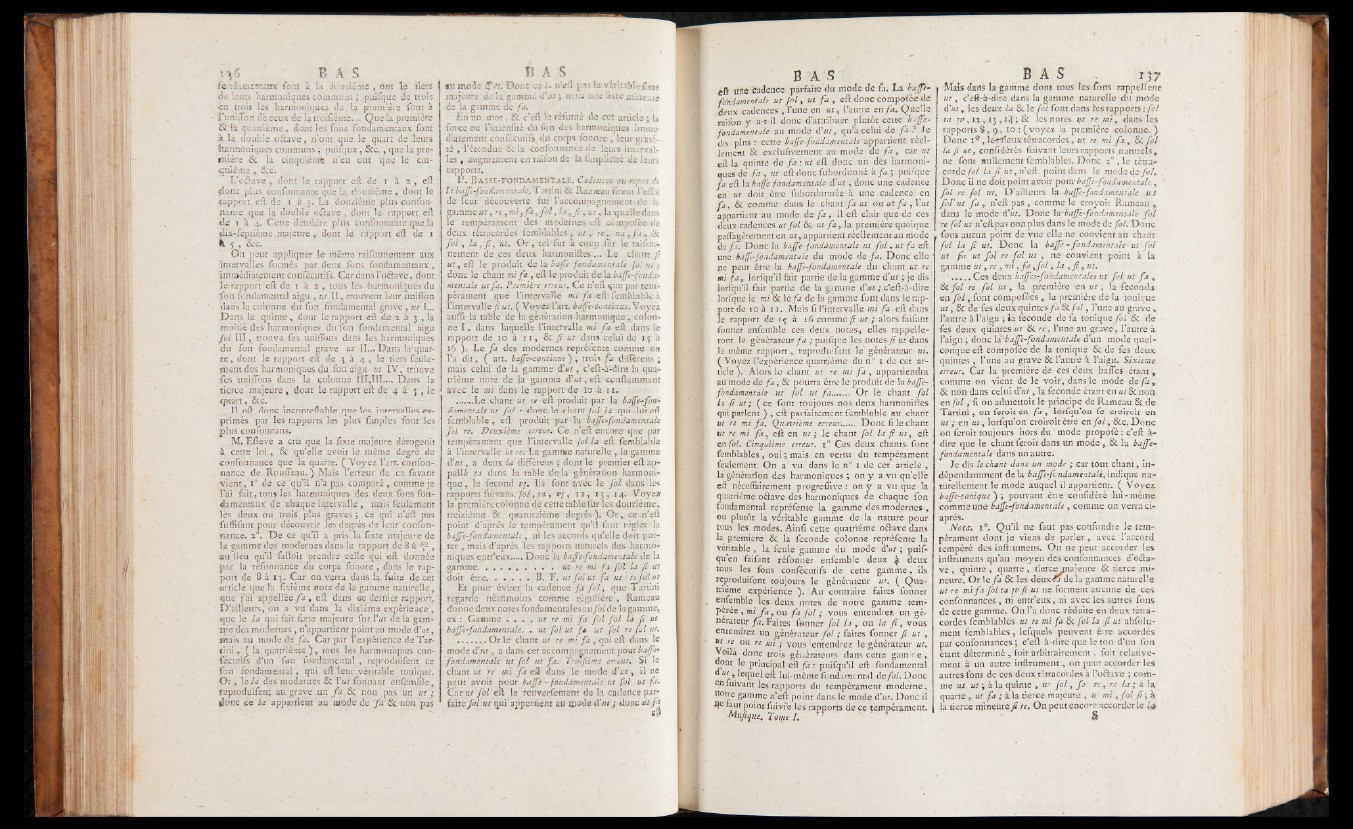
m s b a s
fondamentaux font à la douzième , ont le tiers
<le lents harmoniques communs ; puifque de trots
en trois les harmoniques de la première font à
l ’uni ffon de ceux de la troifieme.... Que la première
& la quatrième, dont les fons fondamentaux font
à la double .o&ave, n’ont que le quart de leurs
liàrmoniques communs ; puifque, &c., que la première
& la cinquième n’èn ont que le cinquième
, &C. ;
L’o&ave , dont le rapport eft de i à 2 , eft '
ffoiic plus conformante que la douzième ., dont le
l’apport eft de 1 à 3. La douzième plus confon-
nante -que la double o&ave , dont le- rapport eft
«le t à 4. Cette dernière plus confonnante queja
jdix-feptiènte majeure dont lé ràpport eft de 1
k 5 , &c.
On peut appliquer le même raifonnemënt aux
intervalles formés par deux /ons fondamentaux ,
immédiatement confécutifs. Cardans l’oélaVe, dont
le-rapport eft de 1 à 2 , tous les ^harmoniques du
Con fondamental aigu , ut II., trouvent leur uniffon
dans la colonne du fôn fondamental grave , ut I...
.Dans la quinte, dont le rapport eft de 2 à 3 , la
moitié des harmoniques du ion fondamental aigu
fo l II I, trouve, fes unifions dans les harmoniques
du fon fondamental grave ut II... Dans la?quarte
, dont le rapport eft de 3 à 4 , le tiers feüle-
snent des harmoniques du fon aigu- ut IV, trouve
des imiffons dans la colonne. III,III.... Dans la
tierce majeure , dont le rapport eft'de 4 à 5 , le
quart, &c.
11 eft donc inconteftable que les intervalles exprimés
par les rapports lés plus fimples font ’les
©lus confonnans.
M, Efteve a crû que la fixte majeure dérogeoît
à cette lo i, & qu’elle avoit le même degré de
confennance que la quarte. ( Voyez l’art, confon-
33 an ce de Rouffeau. ) Mais l’erreur de ce favant
vient, i° de ce qu’il n’a pas comparé comme je
l’ai‘ fait, tous les harmoniques des deux fons fondamentaux'de
chaque intervalle , mais feulement
lès deux ou trois plus graves ; ce qui n’eft pas
fuffifant pour découvrir les. degrés de leur confon-
nance. 20. De ce qu’il a pris la fixte majeure de
la gamme des modernes dans le rapport de 8 à ~ ;
au lieu qu’il falloit prendre celle qui eft donnée
par la réfonnance dû corps fonore , dans le rapport
de 8 à 13. Car on verra cia As la fuite de cet
article que la fixième note de la gamme naturelle,
que j’ai appelle é fa * eft dans ce dernier ràppprt.
D’ailleursOn a vu dans là dixième expérieaee ,
que le la qui fait fixte majeure fur Y ut de ia gamine
des modernes , n’appartient point au mode d’«r,
jnais au mode de fa. Car par 1 expérience de Tartini
, ( la. quatrième ) , tous les harmoniques con-
iecntifs d’un fon fondamental , reproduifent ce
Con fondamental, qui. eft leur véritable tonique.
O r , le la des modernes & Y ut fonnànt ènfêiûhle,
teprodüifent au grave.un f a .& non pas tin u t ;
donc ce la appartient au mode de fa & non pas
B A S
an mode cj*ùt. Donc ce U «eft pas la véritable fixte
majeure de la gamme ci "ut ; mais une fixte mineure
de la gamme de fa.
En un mot, 8c c’éft le réfume de cet article ; la
force ou l’intenfité du fon des harmoniques immédiatement
confécutifs du corps fonore , leur gravité
, l’étendue 8c la confonnance de leurs intervalles
, augmentent en ràifon de la fimphcité de leurs
rapports.
1F. Basse-fondamentale. Cadences ou repos ât
la baffe-fondamentale. Tartini & Rameau firent l’effâi
de leur découverte fur l’accompagnement de la
gamme u t , re ,-mi, f a , f p f , la :, f i , u t , la quelle dans
le tempérament ' des modernes eft compofée. de
deux tétracordes femblables ; u t , re, - mi, f a ,, >&
f o l , la , f i , "ut. Or , tel fut à coup .Cûr le raifo'r.®
nement de .ces deux harmoniftes.... Le chant f i
ut, eft le produit de la-baffe fondamentale fo l ut ;
donc le chant mi f a , eft le prod uit de la baffe-fonda1-
mentale ut fa . Première eneur. Ce n’eft que par tempérament
que l’intervalle mi fa eft femblabie à
l’intervalle yz ut. ( Voyezl’art. baffe--continue. Voyez
aufti la table de la génération harmoniquecolonne
I , dans laquelle l’intervalle ml fa eft dans le
rapport de 10 à 11, & f i ut dans celui de 15 à
16 ). Le fa des modernes repréfente comme on
l’a dit, (a rt. baffe-continue ) , trois fa diffère ns ;
mais celui de la gamme d'ut, c’eft-à-dire la quatrième
noté de la gamme à'ut, eft conftamment
avec le mi dans le rapport de 10 à 11.
...... Le chant ut, re eft produit par la baffe-fondaniéntalë
ut fo l : donc-le chant fo l la qui- lui eft
femblable , eft produit par- la baffe fondamentale
fo l re. Deuxième ,erreur. Ce n’eft encore que par
tempérament que l’intervalle fo lia eft .femblable
à l’intervalle ut re. La gamme naturelle , la gamme
d'ut, a deux la différens ; dont le premier eft.appel!
é ta dans la table de-la génération harmonique,
le fécond vj. Ils ! font avec le fol dans les
rapports fpivans./o/, v j , 12 , 13, 14. Voyez
la première colonne de cette table fur les douzième,
treizième - & quatorzième degrés ). O r, ce n ’eft
point d’après le tempérament qu’il faut régler la
baffe-fôndamentaU , ni les accords qu’elle doit porter
, mais d’après les rapports naturels des. harmoniques
eotr’eux....Donc la baffe-fondamentale: de la
gamme, . . . . . . . . . ut- re mi fa fo l' la f i ift
doit être. . . . . . B. F. ut fo l Ut fa ut re folut
Et pour éviter la cadence f(t fo l, que Tartini
regarde néanmoins; comme régulière , Rameau
donne deux notes fondamentales au fo l de la gamme,
ex : Gamme . . . . ut re mi fa fo l fo l la f i ut
baffe-fondamentale. . ut fo l ut fa ut fo l re fol ut.
...........Or le chant ut re mi fa , qui eft dans le
mode d’zzf , a dans cet accompagnement pour baffe*
fondamentale ut fo l ut fa. Trqrfième erreur. Si le
chant ut re mi fa eft dans le mode d'ut, il ne
peut avoir pour baffe - fondamentale ut fol ut fa.
Car ut fo l eft le renverfement de la cadence parfaitefo
l ut qui appartient au mode d'ut ; donc ut fa
B AS
eft une cadence parfaite du mode de fa. La baffe-
fondamentale ut f o l , ut fa , eft donc compofée de
deux cadences , l’une en u t, l’autre en fa. Quelle
raifon y a-t-il donc d’attribuer plutôt cette b>ffe-
fondaéentale au mode d'ut, qu’à celui de fa ? Je
dis plus : cette baffe-fondattieritale -appariant. réellement
& exclufivement au mode d e f a , car ut
eft la quinte de fa : ut eft donc un dès harmoniques
de fa , ut eftdoncfubordonné h. fa ; jàuifque
fa e ft la baffe fondamentale d'ut, donc une cadence
en ut doit être fubordonnée à une cadence en
f a , & comme dans le chant fa ut ou ut fa , Y ut
appartient au mode de fa * il eft clair que de ces
deux cadences ut fo l &- ut fd , la première quoique
paflagèrement en ut, appartient réellement au mode
de fa. Donc la baffe-fondamentale ut f o l , ut fa eft
une baffl-fondamentale du mode de fa . Donc elle
pe peut être la baffe-fondamentale du chant ut re
mi fa t lorfqu’il fait partie de la gamme d'ut ; je dis
lorlqu’il fait ’partie de la gamme d'ut ; c’eft-à-dire
lorfque le mi 6c le fa de fa gamme font dans le rap- ;
port de to à 11. Mais fi l’intervalle mi fa eft dans
îe rapport de 15 à 16 comme f i ut ; alors faifant
fonner enfemble ces deux notes, elles rappelleront
le générateur fa ; puifque les notes j? ut dans
le même rapport, reproduifent le générateur ut.
( Voyez l’expérience quatrième du n° 1 de cet article
). Alors le chant ut re mi fa , appartiendra
au mode de fa , 8c pourra être le produit de la baffefondamentale
ut fo l ut fa ....... Or le chant fo l
la fi ut; ( c e font toujours nos deux harmoniftes
qui parlent ) , eft parfaitement femblable au chant
ut re mi fa. Quatrième -erreur...... Donc fi le chant
tit re mi fa , eft en ut ; le chant fol la f i ut, eft
en fol. Cinquième erreur. i ° Ces deux chants- font
femblables , oui ; mais en vertu du tempérament
feulement. On a vu dans le n° 1 de cet article ,
la génération des harmoniques ; on y a vu qu’elle
eft. néceflàirement progrefiive : on y a vu que la
quatrième o&ave des harmoniques de chaque fon
fondamental repréfente la gamme des modernes ,
©u plutôt la véritable gamme de la nature pour
tous les modes. Ainfi cette quatrième oftave dans
la première & la fécondé colonne repréfente la
véritable, la feule gamme du mode dW ; puif-
qu’en faifant réfonner enfemble deux ^ deux
tous les fons confécutifs de cette gamme, ils
reproduifent toujours le générateur uâ||| Quatrième
expérience ). Au contraire faites fonner
enfemble les deux potes de notre gamme tem-
peree , mi fa , ou fa fo l ; vous entendrez un générateur
fa. Faites fonner fo l la , ou la f i , vous
entendrez un générateur fol ; faites fonner f i ut ,
ut re ou re mi ; vous 'entendrez le générateur ut.
Voilà donc trois générateurs dans cette gamme,
dont le principal eft fa : puifqu’il eft fondamental
d w , lequel eft lui-même fondamental defol. Donc
en luivant les rapports du tempérament moderne,
notre gamme n’eft point dans le mode d'ut. Donc il
l?e faut point fuivfe les rapports de ce tempérament.
Mufique, Tome ‘
B A S , i } 7
Maïs ctarts la gamme dont tous les fotis rappellent
u t , c’eft-à-dire dans la gamme naturelle du mode
d'ut, les deux la 8c le fol font dans l’es rapports : fol
ta jv , 1 2 ,13 , i^T; & les notes qt re mi, dans les
rapports S , 9 , 10 : ( voyez la première colonne. )
Donc iQ, letrtfeux tétracordes , ut re mi f a , & fo l
la f i ut, confidérés fuivant leurs rapports naturels,
ne font Huilement femblables. Donc 20 , le tétra-
eorde fo l la f i ut, n’eft point dans le mode de fol. ,
• Donc il ne doit point avoir pour baffe-fondamentale,
fo l re fol ut. D ’ailleurs la baffe-fondamentale ut
fo l' ut fa , n’eft pas , comme le croyoit Rameau
dans le mode d’/zr. Donc la '‘baffe-fondamentale fo l
re fo l ut’ n’eft pas non plus dans le mode de fol: Donc
fous aucun point de vue elle ne convient au chant
fo l la f i ut. Donc la baffe - fondamentale-ut fo l
ut fa ut fol re fo l ùt , ne convient point à la
gamme ut, ré, mi, f a yf o l , la
........Ces deux baffes-fondamentales ut f o i ut fa ,
& fo l re fol. u t, la première en ut , la féconda
en f o l , font corapofées , la première de la tonique
u t, & de fes deux quintes fa 8c. fo l, l’une au grave,
l’autre à l’aigu ; ia fécondé de fa tonique fo l oc de
fes deux quintes ut & re, l’une au grave, l’autre à
l’aigu ; donc la'baffe-fondamentale d’un mode quelconque
eft compofée de la tonique & de fes deux
quintes , l’une au grave & l’autre à l’aigu. Sixième
erreur. Car la première de ces deux baffes étant,
comme on vient de le voir, dans le mode de fa 9.
8c non dans celui d'ut, la fécondé étant en ut 8c non
en fo l ; fi on aclmettoit le principe de Rameau 8t.de
Tartini, on ferait en fa , lorfqu’on fe croiroit en
ut ; en u t, lorfqu’on croiroit être en f o l , &c. Donc
on feroit toujours hors du ' mode propofé : c’eft à-
dire que le chant feroit dans un mode, & la baffe- <
fondamentale dans un autre.
Je dis le chant dans un mode ; car tout chant, indépendamment
delà baffe-fcndamentali, indique naturellement
le mode auquel il appartient. ( Vo yez
baffe-tonique') ; pouvant être confidéré lui-même
comme une baffe-fondamentale , comme on verra ci-
après.
Nota. i°. Q u’il ne faut pas confondre le tempérament
dont je viens de parler, avec l’accord
tempéré des inftrumens. On ne peut accorder les
inftrumens qu’au moyen des confonnances d’ofta-
ve , quinte , quarte , tierceinaj eure & tierce mineure.
Or le fa & les déux^Tde la gamme naturelle
ut re mi fa fol ta p f i ut ne forment aucune de ces
confonnances , ni entr’eux, ni avec les autres fons
de cette gamme. On l’a donc réduite en deux tétracordes
femblables ut re mi fa 8c fol la f i ut abfolu-
ment femblables, lefquels peuvent être accordés
par confonnances ; c’eft à-dire que le ton d’un fon
étant déterminé , foit arbitrairement , foit relativement
à un autre infiniment, on peut accorder les
autres fons de ces deux tétracordes à i’o&ave ; comme
ut ut ; à la quinte , ut f o l , fo re, re la ; à la
quarte , ut fa ; à la tierce majeure , u- mi x fo l f i ; à
la tierce mineure f i re. On peut encore accorder le