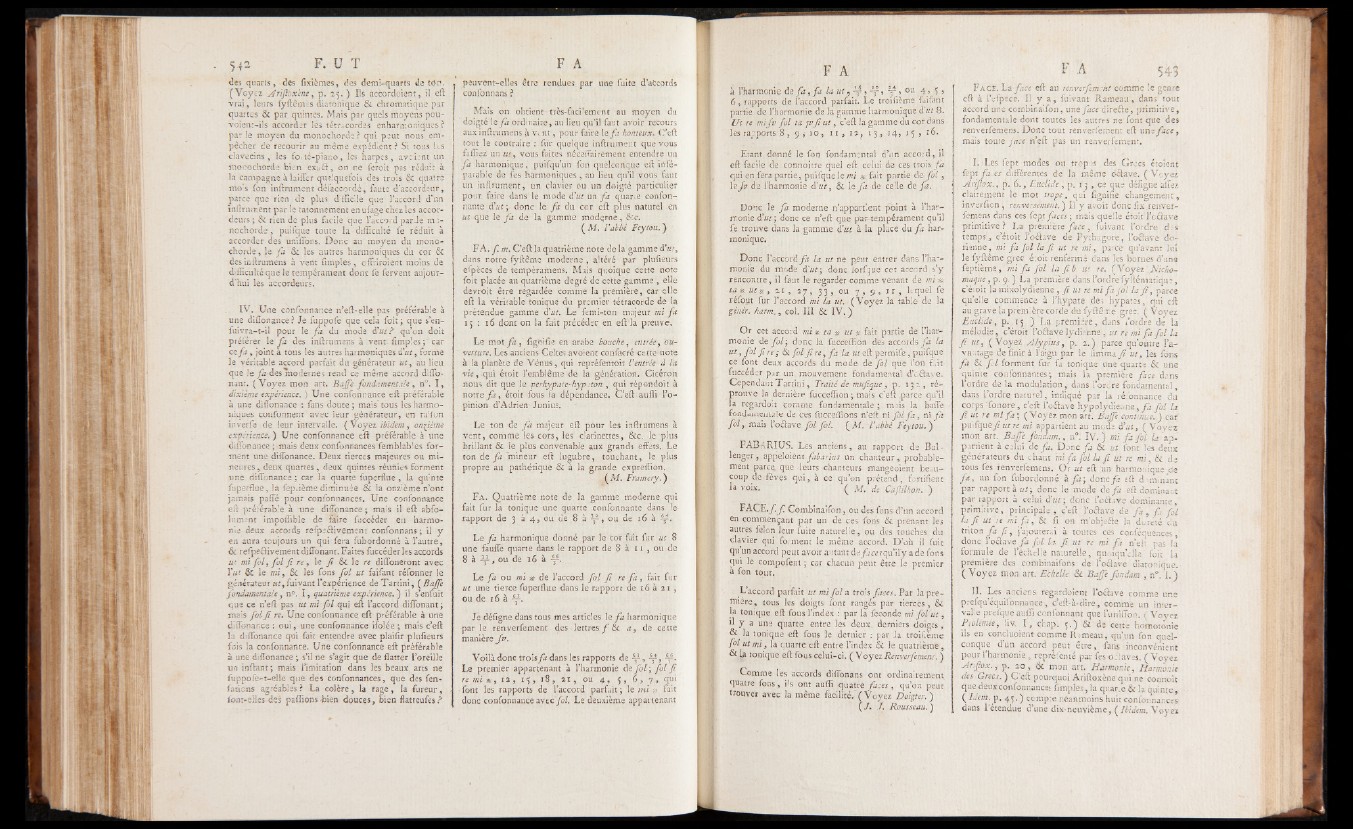
542 F . ü T
des quarts, des fixièmes, des demi-quarts de ton.
(V o y e z Arifiüxbie, p. 25. ) Ils accordoient, il eft
v r a i, leurs fyftêm-is diatonique & chromatique par
quartes & par quintes. Mais par quels moyens pou-
voient-ils accorder les téti\;cordes enharmoniques?
par le moyen dü monochorde ? qui peut nous.em-
pêcher de recourir au même expédient ? Si tous les
clavec ins, les fo>té-piano, les harpes, a v c k n t un
monochorde bien e x a é l, on ne feroit pas réduit à
la campagne à laiiTer quelquefois des trois & quatre
mois fon infiniment défaccordé, faute d’accordeur,
parce que rien de plus dfficile que l’accord d’un
inflriur.ent par le tâtonnement en ufage chez les accordeurs;
& rien de plus facile que l’accord par Je monochorde
, puifque toute la difficulté le réduit à
accorder des unifions. Donc au moyen du mono-
chorde, le fa & les autres harmoniques du cor &
des inflrumens à vent fimples, cffriroient moins de
difficulté que le tempérament dont fe fervent aujourd
’hui les accordeurs.
IV . Une confonnance n’efl-elle pas préférable à
une diflonance ? Je fuppofe que cela foit ; que s’en-
fuivra-t-il pour le fa du mode à'ut ? qu’on doit
préférer le fa des inflrumens à vent fimples car
ce f a , joint à tous les autres harmoniques d’ut, forme
le véritable accord parfait du générateur ut, au lieu
que le fa -deslnodernes rend ce même accord difïb-
nant. (V o y e z mon art. Baffe fondamentale, n°. I ,
dixième expérience.') Une confonnance efl préférable
à une diflonance : fans doute ; mais tous les harmoniques
conforment avec leur générateur, en ra’fon
inverfe de leur intervalle. ( V o y e z ibidem, onzième
expérience. ) Une confonnance efl préférable à une
diflonance ; mais deux confonnances femblabies forment
une diflonance. Deux tierces majeures ou mineures
, deux quartes , deux quintes réunies forment
une diflonance ; car la quarte fuperflue , la qu'nte
fuperflue, la fepJème diminuée & la onzième n’ont
jamais pafle pour confonnances. Une confonnance
efl préférable à une diflonance ; mais il efl abfo-
lumsnt impoffible de faire fuccéder en harmonie
deux accords refpeélivement confonnans ; il y
en aura toujours un qui fera fubordonné à l’autre,
& refpeélivement diflonant. Faites fuccéder les accords
ut mi fo l, fol f i re, le f i 8c le re difloneront avec
Y ut & le mi, 8c les fons fo l ut faifant réfonner le
générateur ut, fuivant l’expérience de T a r tin i, ( Baffe
fondamentale, n°. I , quatrième expérience. ) il s’enfuit
que ce n’efl pas ut mi fol qui eft l’accord diflonant;
mais fo l f i re. Une confonnance efl préférable à une
diflonance : o u i, une confonnance ifolée ; mais c’efl
la diflonance qui fait entendre avec plaifir plufieurs
fois la confonnance. Une confonnance efl préférable
à une diflonance ; s’il ne s’agit que de flatter l’oreille
un inflant ; mais l’imitation dans les beaux arts ne
fuppofe-t-elle que des confonnances, que des fen-
faticns agréables? La colère , la rag e , la fureur,
font-elles des pallions-bien douces, bien flatreufes,p
F A
peuvent-elles être rendues par une fuite d’atçords
confonnans ?
Mais on obtient très-facilement au moyen du
doigté le fa ordinaire, au lieu qu’il faut avoir recours
aux inflrumens .à V en t , pour faire le fa honteux. C ’efl
tout le contraire : fur quelque infiniment que vous
fa fiiez' un ut, vous faites néceflairement entendre un
fa harmonique, pmfqu’un fon quelconque efl irréparable
de les harmoniques , au lieu, qu’il vous faut
un in/irument, un clavier ou un doigté particulier
pour, faire dans le mode d'ut un fa quarte confon-
nante f iu t ’, donc le fa du cor efl plus naturel en
ut que le fa de la gamme moderne, & c .
( M. l ’abbé Feytou. )
F A . f m. C ’efl la quatrième note de la gamme élut,
dans notre fyflême moderne , altéré par plufieurs
ëfpèces de tempéramens. Mais quoique cette note
foit placée au quatrième degré de cette gamme , elle
devroit être regardée comme la première, car elle
efl la véritable tonique du premier tétracorde de la
prétendue gamme d’ut. Le femi-ton majeur mi fa
15 : 16 dont on la fait précéder en efl la preuve.
Le mot fa , fignifie en arabe bouche, entrée, ouverture.
Les anciens Celtes avoient confacré cette1 note
à la planète de Vén u s , qui repréfentoit L’entrée à la
vie, qui étoit l’emblème de la génération. Cicéron
nous dit que le perhypatt-hyp .iton , qui répondoit à
notre f a , étoit fous fa dépendance, C ’efl: aufli l’o pinion
d’Adrien Junius.
L e ton de fa majeur efl pour les inflrumens à
v en t , comme les cors, les clarinettes, & c . le plus
brillant 8c le plus convenable aux grandi effets. Le
ton de fa 'mineur efl lugubre, touchant, le plus
propre au pathétique & à la grande expreffionl
JM . Framery. )
F a . Quatrième note de la gamme moderne qui
fait fur la tonique une quarte confonnante dans de-
rapport de 3 à 4 , ou de 8 à , ou de 16 à
L e fa harmonique donné par le cor fait fur ut 8
une fauffe quarte dans le rapport de 8 à 11 , ou de
8 à I f , ou de 16 à
Le fa on mi » de l’accord fo l f i re f a , fait fur
ut une tierce fuperflue dans le rapport de 16 à 21 ,
ou de 16 à
Je défigne dans tous mes articles le fa harmonique
par le renverfement des lettres ƒ & a , de cette
manière Jv.
V o ilà donc trois fa dans les rapports de 4f -
Le premier appartenant à l’harmonie de f o l ; f o l f i
re mi x , 1 1 , 15 , 1 8 , 2 1 , ou 4 , 5 , 6 , 7 , qui
font les rapports de l’accord parfait ; le mi ï< fait
donc confonnance avec f o l . Le deuxième appartenant
à l’harmonie de fa , fa la ut, 1 ? » ~r> 7^5 ou Æ $ >
6 , rapports de l’accord parfait. Le troifiëme faifant
partie de l’harmonie de la gamme harmonique d'ut 8 .
Ut re mïjv fol ta /vfi u t , c’efl: la gamme du cor dans
les rapports 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 13 , 14 , 1 5 , z6.
Etant donné le fon fondamental d’un ac cord, il
efl facile de connoitre quel efl celui de ces trois fa
qui en fera partie, puifque le mi x fait partie de f o l ,
leJo de l’harmonie élut, 8c le fa de celle de fa.
Donc le fa moderne n’appartient point à l’harmonie
d’ut ; donc ce n’efl que par-tempérament qu’il
fe trouve dans la gamme d’ut à la place du fa harmonique.
Donc l ’accord fa la ut ne peut entrer dans Pha“-
moniè du mode élut-, donc lorfque cet accord s’y
rencontre, il faut le regardèr comme venant de mi x
ta u utx. , 21 , 27 , 33 , ou 7 , 9 , 1 1 , lequel fé
réfout fur l’accord mi la ut. (V o y e z la tablé de la
génér. harm., col. III & IV . )
O r cet accord mi # ta f ut % fait partie de l’harmonie
de fo l’, donc la fucceffion des accords fa la
ut, fol f i re ; & fol f i re, fa la « f eft permife, puifque
ce font deux accords du mode de fo l que l’on fait
fuccéder psr un mouvement fondamental d’célave.
Cependant T a r t in i, Traité de mufique , p. 1 31 , réprouve
la dernière fucceffion; mais c’efl parce qu’il
la regardoit comme fondamentale; mais la baffe
fondamentale de ces fucceffions n’eft ni fol fa , ni fa
fol y mais Poélave fol fol. ( M. T abbé Feytou. )
FA B A R IU S . Les anciens, au rapport de Bul-
lenger, appeloient fabarius un chanteur, probablement
parce, que leurs chanteurs mangeoient beaucoup
de fèves q u i, à ce qu’on prétend, fortifient
la voix. ( M. de Cafiïlhon. )
FA C E , f f Combinai fon , ou des fons d ’un accord
en commençant par un de ces fons 8c prenant les
autres félon leur fuite naturelle , ou dès touches du
clavier qui forment le même accord. D ’où il fuit
qu’un accord peut avoir autant de facesqu’if y a de fons
c[ui le compofenl ; car chacun peut être le premier
à fon tour.
L accord parfait ut mi fol a trois faces. Par la première
, tous les doigts font rangés par tiercés, &
la tonique eft fous l’index : par la fécondé mi fo lu t ,
J y a une quarte entre les deux, derniers do ig ts,
& la tonique eft fous le dernier : par la troifième
fol ut mi, la quarte efl entre l’index 8i le quatrième,
& tonique efl fous celui-ci. ( V o y e z Renverfement. )
Comme les accords diffonans ont ordinairement
quatre fons, ils ont auffi quatre faces, qu’on peut
trouver avec la même fa c ilité .'(V o y e z Doigter. )
( / . T. Rousseau. )
F ace. La face eft au renverfement comme le genre
eft à l’efpece. Il y a , fuivant Rameau, dans tout
accord une combiraifon, une face direéle, primitive,
fondamentale dont toutes les autres ne font que des
renverfemens. Donc tout renverfement efl unz face,
mais toute J ace n’eft pas un renverfement.
I. Les fept modes ou tropes des Grecs étoient
- fept fa.es différentes de la même délave. ( V o y e z
Arifiox., p, 6 ., Euclide, p. 13 , ce que défigne allez
clairement le mot trope, qui fignifie changement,
inverfion, renversement. ) Il y a voit donc fix.renverfemens
dans ces fept faces ; mais quelle étoit l’céiave
primitive? L a première face, fuivant l’ordre des
temps, c étoit Poélave de Pythagore, Poélave do-
m n n e , mi fa Jol la f i ut re mi, parce qu’avant lui
le fyflême grec é:oit renfermé dans les bornes d’une
feptième, mi fa fo l la f i b ut re. (V o y e z Nicho-
maque, p. 9. ) La première dans l’ordre fyftématique,
c’éioit la mixolydienne , f i ut re mi fa fo l la f i , parce
que lle commence à l’hypate des hypates, qui eft
au grave la première corde du fyftêir.e grec. ( V o y ez
Euclide-, p. 15 ) La première, dans /ordre de la
mélodie, ce to it l’oélave lyd k 'rn e , ut re mi fa fo l la
f i ut5 (y o y e z Alypius, p. 2 .) parce qu’outre Pava:.
tage de finir à l’aigu par le limma f i ut, les fons
fa 8c f l forment fur fa tonique une quarte & une
quinte confirmantes; mais la première face dans
l’ordre de la modulation, dans l’ordre fondamental,
dans l’ordre naturel, indiqué par la ré.onnance du
corps-fonore, c’efl l’oélave hypolydierme, fa fo l la
f i ut re mi fa ; ( V o y e z mon art. Baffe continue. ) car
puifque f i ut re mi appartient au mode d’u t, ( V o y e z
mon art. BafJ'e fondam., n°. IV . ) mi fa fol la appartient
a celui de fa. Donc fa 8c ut font les deux
générateurs du chant mi fa fol lu f i ut re mi, & de
tous fes renverfemens. O r ut eft un harmonique de
fa , un fon fubordonné à fa ; donc fa eft d'.minant
par rapport à ut; donc le mode de fa efl dominant
par rapport à celui d'ut; donc Poêlave dominante,
primitive, principale , c’efl l’oélave de fa , fa fol
la f i ut re mi f i , 8c fi on m’objeéle la dureté du
triton fa f î , jajouterai à toutes ces conféquences,
donc Poêlave^ fa fol la f i ut re mi fa n’eit pas la
formule de Péchclie naturelle, quoiqu’elle foit la
première des combinaifons de Poélave diatonique.
( V o y e z mon art. Echelle 8c Bajfe fondam , n°. 1. j
II. Les anciens regardoient Poélave comme une
prefqu’équifônnanee, c’eft-à-dire, comme un intervalle
prefque aufli confonnant que l’uniffon. ( V o y e z
PioUmée, iivc I , chap. 5 .) & de cette homotonie
ils en concluoient comme Rameau, qu’un fon quelconque
d un accord peut ê t r e , fans inconvénient
pour l’harmonie , représenté par fes o i laves, (V o y e z
Arifiox. , p. 2 0 , & mon art. Harmonie, Harmonie
des Grecs. ) C ’eft pourquoi Arifloxène qui ne connoît
que deux confonnances fimples, la quar.e 81 la quinte,
( Idem. p. 4^ . ) ccmp:e néanmoins huit confonnances
dans l ’étendue d’une dix-neuvième, ( Ibidem. V o y e z