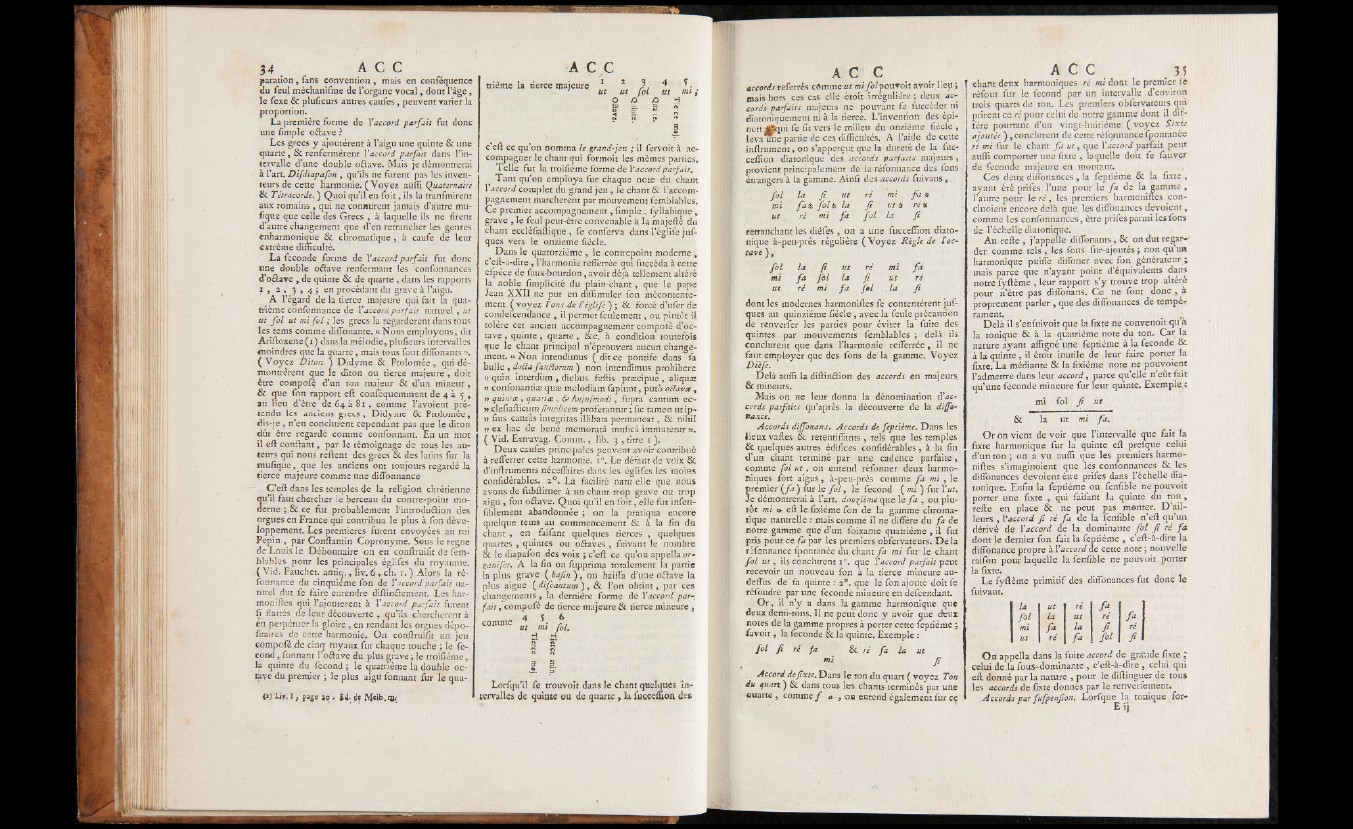
34 A C C
paration, fans convention , mais en conféquence
du feul méchanifme de l’organe v o ca l, dont l’â g e ,
le fexe & plufieurs autres caufes, peuvent varier la
proportion.
La première forme de Vaccord parfait fut donc
une rimple oélave ?
Les grecs y ajoutèrent à l’aigu une quinte & une
quarte, & renfermèrent Y accord parfait dans l’intervalle
d’une double o&ave. Mais je démontrerai
à l’art. Difdiapafon , qu’ils ne furent pas les inventeurs
de cette harmonie. (V o y e z aufli Quaternaire
& Tétracorde. ) Quoi qu’il en lo it , ils la tranfmirent
aux romains ., qui ne connurent jamais d’autre mu-
fjque que celle des Grecs , à laquelle ils ne firent
d’autre changement que d’en retrancher les genres
enharmonique & chromatique, à caufe de leur
extrême difficulté.
La fécondé forme de Y accord parfait fut donc
une double oftave renfermant les confonnances
d’oftave , de quinte & de quarte , dans les rapports
z , 2 , 3 , 4 ; en procédant du grave a l’aigu.
A l’égard de la tierce majeure qui fait la quatrième
confonnance de Y accord parfait naturel 9 ut
ut fo l ut mi fol ; les grecs la regardèrent dans tou«:
les tems comme difionante. « Nous employons, dit
Ariftoxene (1) dans la mélodie, plufieurs intervalles
moindres que la quarte, mais tous font difionants
(V o y e z Diton. ) Didyme & Ptolomée, qui démontrèrent
que le diton ou tierce majeure , doit
être compofé d’un ton majeur & d’un mineur,
& que fon rapport eft conféquemment de 4 à 3 ,
au lieu d’être de 64 à 8 1 , comme ï’avoient prétendu
les anciens grecs, Didyme & Ptolomée,
dis-je, n’en conclurent cependant pas que le diton
dût être regardé comme confonnant. En un mot
il eft confiant, par le témoignage de tous les auteurs
qui nous relient des grecs & des latins fur la
mufique, que les anciens ont toujours regardé la
tierce majeure comme une diffonnance
. C ’ell dans les temples de la religion chrétienne
qu’il faut chercher le berceau du contre-point moderne
; & ce fut probablement l’introduélion dés
orgues en France qui contribua le plus à fon développement.
Les premières furent envoyées au roi
Pépin , par Conftantin Copronyme. Sous le régné
de Louis le Débonnaire on en conftruifit de fem-
blables pour les principales églifes du royaume.
( Vid. Fauchet. antiq., liv. 6 , en. 1. ) Alors la ré-
fonnance du cinquième fon de Y accord parfait na- j
turel dut fe faire entendre diftinélement. Les har- I
moniftes qui rajoutèrent à Y accord parfait furent
fi flattés de leur découverte , qu’ils cherchèrent à
én perpétuer la gloire, en rendant les orgues dépo-
fitaires de cettè harmonie. On conftruifit un jeu
eompofé de cinq tuyaux fur chaque touche ; le fécond
, fonnant i’o&ave du plus grave ; le troifième,
la quinte du fécond ; le quatrième la double octave
du premier ; le plus aigu fonnant fur le qua-
0) üt. I f page 20 . £4- tfc Mrib.qm
à c c
trième la tierce ma'j eure 1u t 1u t f}o, l u* t ?m *i-j
O P P H
g» a. g.
51 5- . jj 2
3
c’eft ce qu’on nomma le grand-Jeu / il fervoit à accompagner
le chant qui formoit les mêmes parties.
Telle fut la troifième forme de Y accord parfait.
Tant qu’on employa fur chaque note du chant
Yaccord complet du grand je u , le chant & l’accompagnement
marchèrent par mouvement femblables.
Ce premier accompagnement, fimple, fyllabique,
grave , le feul peut-être convenable à la majefté du
chant eccléfiaftique , fe conferva dans l’églife juf-
ques vers le onzième fiècle.
Dans le quatorzième , le contrepoint moderne „
c’eft-à-dire , l ’harmonie refferrée qui fuccéda à cette
efpèce de faux-bourdon, avoir déjà tellement altéré
la noble fimplicité du plain-chant, que le pape
Jean XXII ne put en diffimuler fon mécontentement
(v o y e z Tons de V èglife ) ; & forcé d’ufer de
condefcendance , il permet feulement, ou plutôt il
tolère cet ancien accompagnement compofé d’octave
, quinte, quarte, &c. à condition toutefois
que le chant principal n’éprouvera aucun changement.
« Non intendimus ( dit ce pontife dans la
bulle , dotfa fanttorum ) non intendimus prohibere
» quin interdùm , diebus feftis præcipue, aliquas
» confonantiæ quæ melodiam lâpiunt, putô o&avcc ,
» quintce , quartee , 6» hujufmodi-, fupra cantum ec-
» clefiafticum fimplicem proferantur ; fie tamen ut ip-
» fius cantûs integritas illibata permaneat, & nihil
» ex hac de bené memorata muficâ immutetur ».
( Vid. Extravag. Comm., lib. 3 , titre 1 ).
Deux caufes principales peuvent avoir-contribué
à relferrer cette harmonie. 1 °. Le déniut de voix &
d’inftruments néceflâires dans les églifes les moins
confidérables. La facilité natu elle que. nous
avons de fubftituer à un chant trop grave ou trop
aigu , fon oélave. Quoi qu’il en lo it, elle fut infen-
. fiblement abandonnée ; on la pratiqua encore
quelque tems au commencement & à la fin du
chant , en faifant quelques tierces , quelques
quartes , quintes ou oftaves , fuivant le nombre
& le diapafon des voix ; c’eft ce qu’on appella or-
ganifer. A la fin on fupprima totalement la partie
la plus grave ( bafin ) , on baifla d’une oélave la
plus aigue ( difeantum ) , & l’on obtint, par ces
changements , la dernière forme de Yaccord parp
fait, compofé de tierce majeure & tierce mineure,
« 4 ï 6
comme u, mi fol.
H H
' g ë.
*r* ?
Lorfqu’il fe trouvoit dans le chant quelques intervalles
de quinte ou de quarte, lia fuceeffioa des
a c c
accords referrés cômme ut mi fo l pouroit avoir lieu > T
mais hors ces cas elle étoit irrégulière ; deux accords
parfaits majeurs ne pouvant fe fuccéder ni
diatoniquement ni à la tierce. L’invention des épi-
netttjftqui fe fit vers le milieu du onzième fiècle ,
leva ime partie de ces difficultés. A l’aide de cette
inftrument, on s’apperçut que la dureté de la fuct
ceflion diatonique des accords parfaits majeurs ,
provient principalement de la réfonnance des fous
étrangers à la gamme. Ainfi des accords fuivans,
fo l la f i - ut ré mi fa n
mi fait, fo lk la fi ut a ré ft
ut ré mi f a fo l la fi
retranchant ies dièfes , on a une fucceflion diatonique
à-peu-près; régulière (V o y e z Regie de Toctavt
) ,
fo l U fi ut ré mi f *
mi fa fo l la fi ut ré
ut ré mi fa fai . la fi
dont les modernes harmoniftes fe contentèrent juf-
ques au quinzième fiècle, avec la feule précaution
de renverfer les parties pour éviter la fuite des
quintes par mouvements femblables ; delà ils
conclurent que dans l’harmonie reflerrée, il ne
faut employer que des fons de la gamme. Voyez
Diefe.
Delà aufli la diftinâion des accords en majeuris.
& mineurs.
Mais on ne leur donna la dénomination d'accords
parfaits qu’après la découverte de la diffa-
Kance.
Accords diffonans. Accords de feptième. Dans les
lieux vaftes & retentifîants , tels que les temples
& quelques autres édifices confidérables , à la fin
-d’un chant terminé par une cadence parfaite,
comme fol u t , on entend réfonner deux harmoniques
fort aigus, à-peu-près comme fa mi , le
remier'( fa ) ftir le f o l , le fécond ( mi ) fur Y ut.
e démontrerai à l’art, douzième que le fa , ou plutôt
mi * eft le lixième fon de la gamme chromatique
naturelle : mais comme il ne diffère du fa de
notre gamme que d’un foixante quatrième , il fut
pris pour ce fa par les premiers obfervateurs. De la
réfonnance fpontanée du chant fa mi fur le chant
fo l u t , il§ conclurent i°. que Y accord parfait peut
recevoir un nouveau fon à la tierce mineure au-
deffus de fa quinte : a°. que le fon ajouté doitfe
réfoudre par une fécondé mineure en defeendant.
O r , il n’y a dans la gamme harmonique que
deux demi-tons. Il ne peut donc y avoir que deux
notes de la gamme propres à porter cette leptième ;
lavoir , la (econde & la 'quinte. Exemple :
fo l f i ré fa & ré fa la ut
mi f i
Accord defixte. Dans le ton du quart ( voyez Ton
du quart ) & dans tous les chants terminés par une
cuarte, comme f a 3 on entend également fur cç
A C c 35
chant deux harmoniques ré mi dont le premiet fe
réfout fur le fécond par un intervalle d’environ
trots quarts de ton. Les premiers obfervateurs qui
prirent ce ré pour celui de notre gamme dont il diffère
pourtant d’un vingt-huitième ( voyez Sixte
ajoutée ) , conclurent de cette réfonnance fpontanée
ré mi fur le chant fa ut, que Y accord parfait peut
aufli comporter une fixte , laquelle doit fe fauver
de. fécondé majeure en montant.
Ces deux diflbnances, la feptième & la fixte,
ayant été prifes l’une pour le fa de la gamme,
l’autre oour le ré, les premiers harmoniftes con-
cluoient encore delà que les diflbnances dévoient,
comme les confonnances, être prifes parmi les fons
de l’échelle diatonique.
Au refte , j’appelle diffonants, & on dut regard
der comme tels , les fons fur-ajoutés ; non qu’un
harmonique puiffe diffoner avec fon générateur ;
mais parce que . n’ayant point d’équivalents dans
notre fyftême , leur rapport s’y trouve trop altéré
pour n’être pas diffonans. Ce ne font donc , a
proprement parler , que des diflbnances de tempe?
rament. ri
Delà il s’enfuivoit que la fixte ne convenoit qu a
la tonique & à la quatrième note du ton. Car la
nature ayant afligné une feptième à la fécondé &
à la quinte , il étoit inutile de leur faire porter la
fixte. La médiante & la fixième note ne pouvoient
l’admettre dans leur accord, parce qu’elle n’eût fait
qu’une féconde mineure fur leur quinte. Exemple,:
mi fol f i ut
& la ut mi fa .
Or on vient de voir que l’intervalle que fait la
fixte harmonique fur la quinte eft prelque celui
d’un ton ; on a vu aufli que les premiers harmo-
niftes s’imaginoient que les confonnances & les
diflbnances dévoient être prifes dans l’échelle diatonique.
Enfin la feptième ou fenfible ne pouvoit
porter une fixte , qui faifant la quinte du ton ,
refte en place & ne peut pas monter. D ’ailleurs
, Y accord f i ré fa de la fenfible n’eft qu’un
dérivé de Y accord de la dominante fo l f i ré fa
dont le dernier fon fait la feptième , c’eft-à-dire la
diffonance propre à Y accord de cette note ; nouvelle
raifon pour laquelle la fenfible ne pouvoit porter
la fixte.
Le fyftême primitif des diflbnances fut donc le
fuivant.
1 ^ ut ré f a
1 fo l la ut ré fa
1 mi fola
fi ré
1 ut ré fa fo l fi
On appella dans la fuite accord de grande fixte ;
celui de la fous-dominante, c’eft-à-dire , celui qui
eft donné par la nature , pour le diftinguer de tous
les accords de fixte donnés par le renverfement.
Accords par fufpenfion, Lorfque la tonique for-
E i j