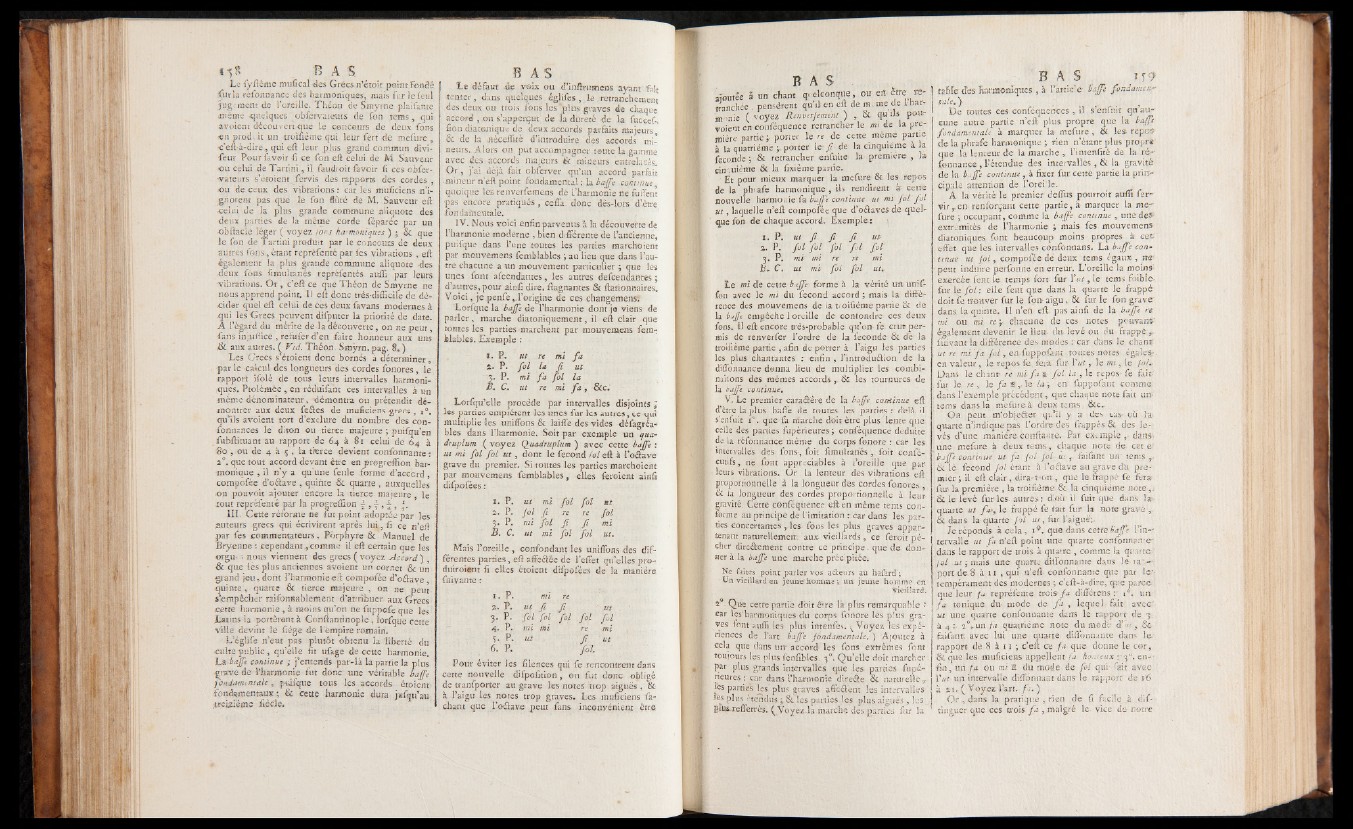
* .$ 8 as A s
Le fyftêtne rmifical des Grées n’étoit peint fende
•fur la réfonnance des harmoniques, mais fur lefeul
juge ment de l’oreille. Théon de Smyrne plaifante
même -quelques obfervateurs de fon tems, qui
a voient décou vert que le concours de deux fons
•en prodi it un -troifième qui leur fert de mefure ,
ceft-à-dire., qui eft leur plus grand commun diviseur
Pour (avoir fi ce fon eft celui de M Sauveur
o u celui de Tartini., il faudroit fa voir fi ces obfer-
-vateurs s’étoient fervis des rapports des -cordes ,
ou de ceux des vibrations : car les müficiens -n’ignorent
pas que le fon flûté de M. Sauveur eft
■ celui de la plus grande commune aiiquote des
deux parties de la même Corde féparée par un
obftacle léger ( voyez /ons ha-moniques ) ; & que
le fon de Tartini produit par le concours de deux
autres fons,, étant repréfenté par fes vibrations , eft
également la plus grande commune aliquote -des
deux fons fimultanés repréfentés auffi par leurs
vibrations. O r , c’eft ce que Théon de Smyrne ne
nous apprend point. Il eft donc très-difficile de décider
quel eft celui de ces deux favans modernes à
-qui les Grecs peuvent difputer la priorité de .date.
A l’égard du mérite de la découverte, on ne peut,
fans injuftiçe , refufer d’en -faire honneur aux uns
&L aux autres. ( Vid. Théon. Smÿrn. pag. 8. )
Les Grecs s’étoient donc bornés à déterminer,
par le calcul des longueurs des cordes fonores, le ■
rapport ifolé de tous leurs intervalles harmoni- :
ques. Ptolémée , en réduifant ces intervalles à un
même dénominateur, démontra ou prétendit démontrer
aux deux feâes de müficiens grecs, i° .
qu’ils avoient tort d’exclure du nombre des con-
fonnances le diton ou tierce majeure ; puifqu’en
fubftituant au rapport de 64 à 81 celui de 64 à
80 , ou de 4 à , la tierce devient confonnante :
20. que tout accord devant être en progreffion harmonique
, il n’y a qu’une feule forme d’acccrd ,
compofée d’o&ave , quinte & quarte , auxquelles
.011 pouvoit ajouter encore la tierce majeure le
tout repréfenté par la progreffion 4 ,. f , - , '
III, Cette réforme ne fut point adoptée par les '<
auteurs grecs qui écrivirent -après lu i , fi ce n’eft
par fes commentateurs, Porphyre & iManuel de ?
Bryenne : cependant , comme il .eft certain que les
orgu- nous viennent des grecs ( voyez Accord ) ,
& que les plus anciennes avoient un cornet & un
grand jeu, dont l’harmonie eft compofée d’o&ave
quinte , quarte & tierce majeure , on ne peut
s’empêcher raifoniaablement d’attribuer aux Grecs
.cette harmonie, à moins qu’on ne fuppofe que les
Latins la portèrent à Conftantinople, lorfque cette
ville devint le fiége de 1 empire romain.
L’églife n’eut pas plutôt obtenu la liberté du
culte pub lic, qu’elle ht ufage de cette harmonie.
La baffe continue ; j’entends par-là la partie la plus
grave de l’harmonie fut donc une véritable baffe
fondamentale , ptüfque tous lés accords étoiem-
fondamentaux ; & cette harmonie dura jwfqu’au
.treizième fijèçle»
B AS
L e défaut dp voix ou d ’inftrumens ayant fait
tenter , dans quelques églifes, le retranchement
des deux ou trois fons les "plus graves de chaque
accord , on s’apperçut de la dureté de la fuccef-,
fion diatonique de deux accords parfaits majeurs,
& de la néceflké d’introduire des accords mineurs.
Alors on put accompagner toute la .gamme
avec des accords majeurs & mineurs entrelacés.
O r , j’ai déjà fait obfcrver qu’un accord parfait
mineur n eft point fondamental : la baffe continue
quoique les renverfemens de l’harmonie ne fulient
pas encore pratiqués , cefla. donc dès-lors d’être
fondamentale.
IV. Nous voici enfin parvenus a la découverte de
l’barmonie moderne , bien différente de l’ancienne,
puifque dans l’une toutes les parties marchoient
par mouvemens femblables ; au lieu que dans l’autre
chacune a un mouvement particulier ; que les
unes font amendantes, les autres descendantes ;
d’autres, pour ainft dire, ftagnantes & ftationnaires.
V o ic i, je penfe,:l’origine de ces changemensï
Lorfque la baffe de l’harmonie dont je viens de
parler, marche diatoniquement, il eft clair que
tontes les parties marchent par mouvemens femr
blabies. Exemple :
ï . P- utï re mî fa
2. P. fo ï la f i ut
3.. P. mi fa fol la
B, C, ut re mi f a , &c.
Lorfqü’elle procède par intervalles disjoints ,
les parties empiètent les unes fur les autres, ce qui
multiplie les unifions & lai fié des vides défagréa-
bles dans Tharmonie. Soit par exemple un qua-
druplum ( voyez Quadruplant ) avec cette baffe :
ut mi fo l fo l u t , dont le fécond fol eft à Poéfave
grave du premier. Si toutes les parties marchoient
par mouvemens femblables, «lies feroieiat ainft
difpofées :
1. P. ut mi fo l f o l ut
2. P. Jol f i re re fol
3. P. mi fo l f i f i mi
B . C. ut mi fol fo l ut.
Mais Poreille , confondant les unifions des différentes
parties, eft affeâée de l ’effet qu’elles pro-
duiroient fi elles étoient difpofées de la manière
fnivante 1
1 . P. mi re
2. P. ut f i f i ' ut
3. P. fo l fol fo l Jol foi
4. P. mi mi re mi
5. P, ut f i • ut
6. P. •• fol.
Pour éviter les filences qui fe rencontrent dans
cette nouvelle difpofition, on fut donc obligé,
de tranfporter au grave les notes trop aigues , &
à l ’aigu les notes trop graves. Les muficiens fa-
chant que l ’o&ave peut fans inconvénient être
B A S
ajoutée â un chant quelconque, ou en être retranchée
. pensèrent qu’il en eft de m-rae de i harmonie
( voyez Renverfement ) r & qu ils pourvoient
en conféquence retrancher le mi de la première
partie;- porter le re de cette même parue
à la quatrième my porter le- Jî de la cinquième à la
fécondé ; & retrancher eimii'te la première , là
cinquième & la fixième partie.
Et pour mieux marquer là mefure & les repos
de la pfoafe harmonique , ils rendirent à- cette
I . P. ut f i f i f i ut-
%. P. fo l fo l fo l fo l fo l
3. P. mi mi re re mi
B*. C. ut mi fo l fol ut,-
Le mi de cette baffe forme à la vérité ununi£
fon avec le mi du fécond accord ; mais la différence
des mouvemens de la- troifième partie & de
la baße empêche 1 oreille de confondre ces deux
fons. 11 eft encore très-probable qu’on- fe crut permis
de renverfer l’ordre de la fécondé & dé la
troifième partie , afin de porter à l’aigu les parties
les plus chantantes : enfin , Pintrodu&ion de la
diffonnance donna lieu de multiplier les combinations
des mêmes accords , & les tournures de
la i>uffe continue.
V. Le premier caraétere de la baffe continue eft
d’être la plus baffe de toutes les partiesdelà- il.
s’enfuit T . que fa marche doit être plus lente que
celle des parties fupérieures ; conféquence déduite
de la réfonnance même du corps fonore : car les
intervalles dés fons-, foit fimuhanés foit confé-
eutifs, ne font appréciables à i’oreille que par
leurs vibrations. Or la lenteur des vibrations eft
proportionnelle à la longueur des cordes fonores ,
& la longueur des cordes proportionnelle à leur
gravité. Cette conféquence eft. en même tems conforme
au principe de l imitation : car dans les parties
concertantes ,. les fons les plus graves appartenant
naturellement aux vieillards , ce feroit pécher
directement contre ce principe - que de- donner
à. la baffe une marche précipitée.
Ne faites point parler vos aCteurs au KaiartT;
Un vieillard en jeune homme -, un jeune homme en
vieillard.
2 Que cette partie doit être là plus remarquable *■
car les'harmoniques du corps fonore les plus graves
font auffi les plus intenfes, Voyez les expériences
de l’art baffe fondamentale. ) Ajoutez à
cela que dans un* accord les fons extrêmes font
toujours lès plus fenfibies. 30. Q u ’elle doit marcher
par plus grands intervalles que les parties fupé-
neures : car dans l’harmonie direCte & naturelle
les parties les plus graves affectent les intervalles
les plus étendus ; & les parties les plus aiguës , les
BÎUs-refTerrés. ( Voyez la marche des parties fur la.
B A S
taBîe des harmoniques , à l’article- baffe fondamentale,'}
; ^
De routes ces conféquences , il s’enfuit qn au^
cune autre partie n’eft plus propre que la baffe
fondamentale à marquer la mefure , & les repos
de la phrafe harmonique ; rien n’étant plus propre
que la lenteur de la marche , rintenfité de la réfonnance
, l’étendue des intervalles , & la gravité
de la baffe continue , à fixer fur cette partie la principale
attention de l’orei'le.
A la vérité le premier defius pourroif auffi fer-
v iry.en- renforçant cette partie, à marquer la mefure
; occupant, comme la baffe continue , une des
, extrémités de l’harmonie ; mais fes mouvemens
diatoniques font beaucoup moins propres à cet
. effet que les intervalles confonnans. La baffe con-
tinae ut f o l , compofée de deux tems égaux , ne-
peut induire porfonne en erreur. L’oreille la moins-
exercée fent le temps fort- fur Y u t , le tems (bible-
fur le fo l : elle fent que dans la quarte le frappé
doit fe trouver fur le fon aigu, & fur le fon grave
dans la quinte. 11 n’en eft pas ainfi de la baffe re
mi ou mi re ÿ chacune de ces notes pouvant'
également devenir le lieu- du. levé ou du frappé ,,
fuivant la différence des modes rcar dans le chant-
ut re mi fa f o l emfuppofàm toutes notes égales-,
en valeur, le repos fe, fera fur Y u t , le mi, le foU
Dans le chant re mi fa $ fol la , le repos- fe fait;
fur le re , le fa m,; le la ; en: fuppofant comme-
dans l’exemple précédent, que chaque note fait un*
tems dans la mefure à deux tems . &c^.
On peut m’objeâer- qu’il y a des cas où la
quarte n’indique pas l’ordre des frappés & des le vés
d’une manière confiante. Par exemple,- dans-
une mefure à deux tems, chaque note de cet e
baffe continue ut fa fo l Jol ui , faifant un' tems ,-
|& lè. fécond Jol étant à l ’câave au grave du premier;
il eft clair, dira-t-on , que le frappé fe fera;
fur. la première , la troifième & la cinquième note
& le levé fur les-autres : dloir il fuit que dans la>
quarte ut fa*, le frappé fe fait fur la note grave ,.
ôc dans la quarte/o/ ut, fur l ’aiguë:.
Je réponds à cela, \9. que dans cette baffe Pin--
tervalle ut fa n’eft point une quarte confonnàrue-
dans le rapport de trois à quatre , comme la quarte'
fo l ut ; mais: une quarte dilfonnanre dans le iapport
de. 8 à 11 , qui n’eft conformante que par le*
tempérament des modernes ; c’eft-à-dire, que parce- '
que leur fu repréfente trois- J a différens:; i°. un
fa tonique div mode de- fa , lequel-fait avec’
ut une quarte confonnante dans le rapport* de 3.
à 4 :• 2°.-un fa quatrième note du mode d’.v ,
&ifantr. avec lui une quarte diftonnaiite dans le
rapport de 8 à 11 ; c’en: ce fa que. donne le cor,
& que lès muficiens appellent ƒ./ honteux r en--
fin, u à-fa. ou mi s dû mode de fol qui fait avec
Y ut un intervalle diftonnant dans* le rapport de 16
à 21. ( Voyez Part. f i . )
Or , dans la pratique , rien de fi facile à distinguer
que ces mois fa , malgré le- vice de notre