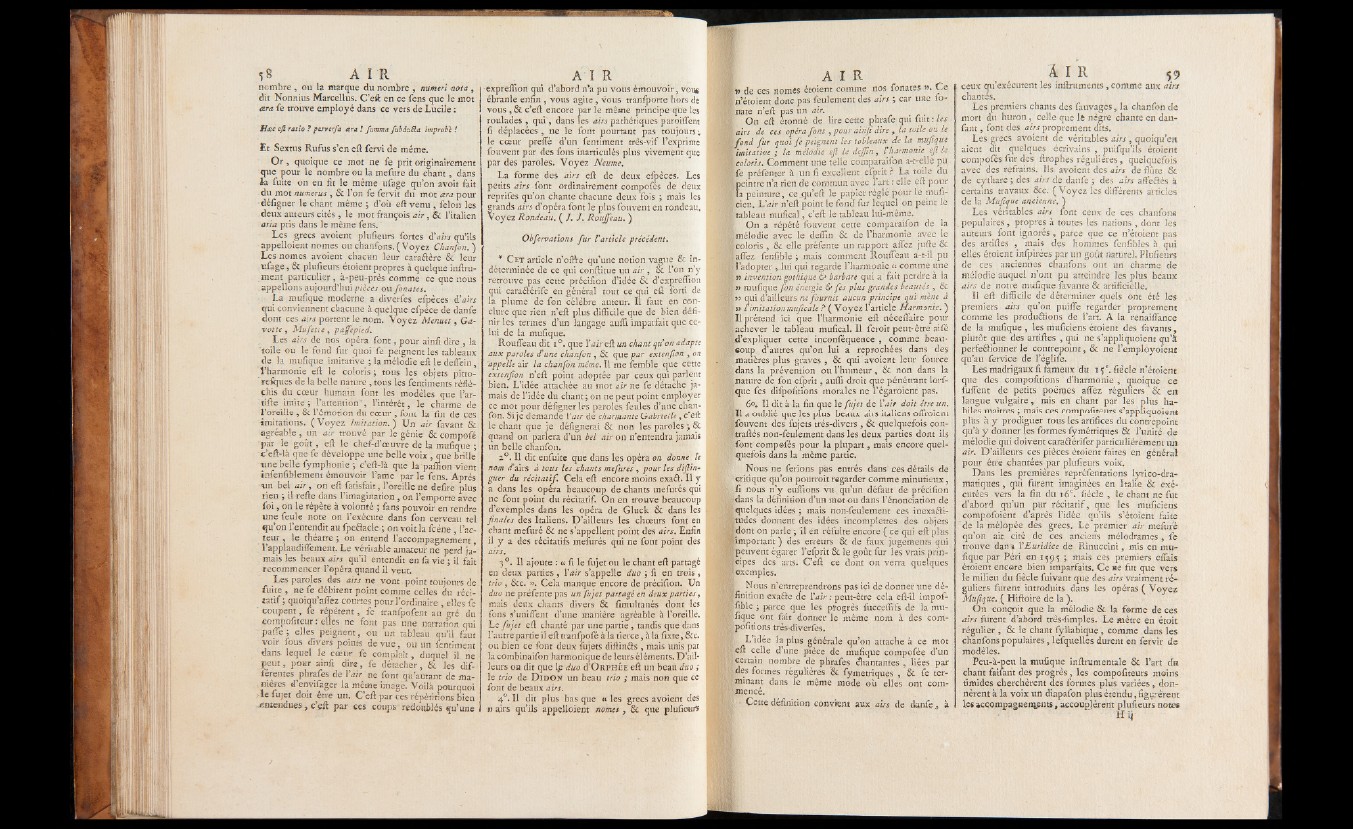
ï§ A I R
nombre , ou la marque du nombre , numcri nota ,
dit Nonnius Marcellus. C ’eft en ce fens que le mot
ara fe trouve employé dans ce vers de Lucile :
K/zc cfi ratio ? perverfa ara ! fumma fubduHa improie !
Et Sextus Rufus s’en eft fervi de même.
O r , quoique ce mot ne fe prit originairement
que pour le nombre ou la mefure du chant, dans
hi fuite on en fit le même ufage qu’on avoit fait
du mot numerus , & l’on fe fervit du mot ara pour
-défigner le chant même ; d’où eft venu , félon les
deux auteurs cités , le mot françois air, & l’italien
aria pris dans le même fens. '
Les grecs avoient plufieurs fortes d'airs qu’ils
appelaient nomes ou chanfons. ( Voyez Chanfbn. )
Les nomes avoient chacun leur cara&ère & leur
u fa g e , & plufieurs étoient propres à quelque inftru-
ment particulier , à-peu-près comme ce que nous
.appelions aujourd’hui pièces ou fonates.
La mufique moderne a diverfes efpèces d'airs
qui conviennent chacune à quelque efpèce de danfe
dont ces airs portent le nom. Voyez Menuet, Gavotte
, Mufette , pajfepied.
Les airs de nos opéra fon t, pour ainfi dire , la
toile ou le fond fur quoi fe peignent les tableaux
de la mufique imitative ; la mélodie eft le deffein
l ’harmonie eft le coloris; tous les objets pittoresques
de la belle nature, tous les fentiments réfléchis
du coeur humain font les modèles que l’ar-
tifte imite ; l’attention V l’intérêt, le charme de
l ’oreille , & l’émotion du coeur , font la fin de ces
imitations. (V o y e z Imitation.) Un air favant &
agréable, un air trouvé par le génie & compofé
par le g o û t, efl le chef-d’oeuvre de la mufique
c ’eft-là que fe développe une belle voix , que brille
-une belle fymphonie ; c’eft-là que la paffion vient
infenfiblement émouvoir l’ame par le fens. Après
*m bel air, on efl fatisfait, l’oreille ne defire plus
tien ; il refie dans l’imagination, on l’emporte avec
fo i , on le répète à volonté ; fans pouvoir en rendre
une feule note on l’exécute dans fon cerveau tel
qu’on l’entendit au fpe&acle ; on. voit la fcène , l’acteur
, le théâtre ; on entend l ’accompagnement,
l ’applaudiflement. Le véritable amateur ne perd jamais
les beaux airs qu’il entendit en fa vie ; il fait
recommencer l’opéra quand il veut.
Les paroles des airs ne vont point toujours de
fuite , ne fe débitent point comme celles du récitatif
; quoiqu’aflez courtes pour l’ordinaire elles fe
coupent, le répètent, fe tranfpofent au gré du
compofiteur : elles ne font pas une narration qui
p a ffë ; elles peignent, on un tableau qu’il faut
voir fous divers points de vu e , ou un lentiment
dans, lequel le coeur fe complaît, duquel il ne
peut, pour ainfi dire, fe détacher, & les differentes
^phrafes de Vair ne font qu’autant de manières
d’envifager la même image. Voilà pourquoi
,1e fujet doit être un. C ’eft par ces répétitions bien
entendues, c’eft par ces coups redoublés qu’une
AI R
expreflion qui d’abord n’a pu vous émouvoir, vous
ébranle enfin , vous agite, vous tranfporte hors de
vous , & c’eft encore par le même principe que les
roulades , qui', dans les airs pathétiques paroiflent
fi déplacées , ne le font pourtant pas toujours ;
le coeur preflfé d’un fentiment trés-vif l’exprime
fouvent par des fons inarticulés plus vivement que
par des paroles. Vo yez Neume.
La forme des airs efl de deux efpèces. Les
petits airs font ordinairement compofés de deux
reprifes qu’on chante chacune deux fois ; mais les
grands airs d’opéra font le plus fouvent en rondeau,
Voyez Rondeau. ( J. J. Rouffeau. )
Obfervations fur l'article précèdent.
* C et article n’offte qu’une notion vague & indéterminée
de ce qui confiitue un air , & l’on n’y
retrouve pas cette précifion d’idée & d’expreflion
qui caraélérife en général tout ce qui efl forti de
la plume de fon célèbre auteur. Il faut en conclure
que rien n’eft plus difficile que de bien- définir
les termes d’un langage aufli imparfait que celui
de la mufique.
Roufleau dit i °, que l'air efl un chant qu'on adapte
aux paroles d'une chanfon , .& que par extetifian , on
'appelle air la chanfon même. Il me femble que cette
extenfion n’eft point adoptée par ceux qui parlent
bien. L’idée attachée au mot air ne fe détache jamais
de l’idée du chant; on ne peut point employer
ce mot pour défigner les paroles, feules d’une chan-
fon. Si je demande l'air de charmante Gabrielle, c ’efl
léchant que je défignerai & non les paroles ; 8c
quand on parlera d’un bel air on n’entendra jamais
un belle chanfon.
2°. Il dit enfuite que dans les opéra on donne le
nom d'airs à tous les chants mefurés , pour les diflin-
guer du récitatif. Cela efl encore moins exaél. Il y
a dans les opéra beaucoup de chants mefurés qui
ne font point du récitatif. On en trouve beaucoup
d’exemples dans les opéra de Gluck & dans les
finales des Italiens. D ’ailleurs les choeurs font en
chant mefuré & ne s’appellent point des airs. Enfin
il y a des récitatifs mefurés qui ne font point des
airs.
3°. Il ajoute : « fi le fujet ou le chant efl partagé
en deux parties , l’<*ir s’appelle duo ; fi en trois ,
trio , &c. ». Cela manque encore de précifion. Un
duo ne préfente pas un fujet partagé en deux parties,
mais deux chants divers & fimultanés dont les
fons s’unifient d’une manière agréable à l’oreille.
Le fujet efl chanté par une partie, tandis que dans
l’autre partie il efl tranfpofé à la tierce, à la fixte, &c.
ou bien ce font deux lujets diftinâs , mais unis par
la combinaifon harmonique de leurs éléments. D ’ailleurs
on dit que lp duo d’ORPHÉE efl un beaü duo ;
le trio de D idon un beau trio ; mais non que ce
font de beaux airs.
4°. Il dit plus bas que « les grecs avoient des
v airs qu’ils appelaient nomes, & que plufieurs
A I R
w de ces nomes étoient comme nos fonates n. C e
[n’étoient donc pas feulement des airs ; car une fo-
[ nate n’eft pas un air.
\ On efl étonné de lire cette phrafe qui fuit : les
| airs de ces opéra fo n t, pour ainfi dire , la toile ou le
ifond fur quoi fe peignent les tableaux de la mufique
\ imitative ; la mélodie efl le dejfin, l'harmonie efl le
|coloris. Comment une telle comparaifon a-t-elle pu
! fe préfenter à un fi excellent efprit ? La toile du
ipeintre n’a rien de commun avec l ’art : elle efl pour
lia peinture, cejju’eft le papier réglé pour le mufi-
cien. L'air n’eft point le fond fur lequel on peint le
f tableau mufical, c’eft le tableau lui-même.
| On a répété fouvent cette comparaifon de la
S mélodie avec le deflin & de l’harmonie avec le
Icoloris , & elle préfente un rapport a fiez jufte Si
laflez fenfible ; mais comment Roufleau a-t-il pu
î l’adopter ,Jui qui regarde l’harmonie « comme une
.. sj invention gothiquefie barbare qui a fait perdre à la
I j> mufique fon énergie & fes plus grandes beautés , &
|>3 qui d’ailleurs ne fournit aucun principe qui mène à
• » l'imitation mufîc ale ? (V o y e z l’article Harmonie. )
{Il prétend ici que l’harmonie efl néceflaire pour
[achever le tableau mufical. Il feroit peut-être aifé
„d’expliquer cette inconféquence , comme beau-
|coup d autres qu’on lui a reprochées dans des
matières plus graves , & qui ’ avoient leur fource
dans la prévention ou l’humeur, & non dans la
< nature de fon efprit, aufli droit que pénétrant lorf-
|que fes difpofitions morales ne l’ égarôient pas.
I 6°. Il dit à la fin que le fujet de l'air doit être un.
Il a oublié que les plus beaux airs italiens offraient
Mouvent des fujets très-divers , & quelquefois con-
ftraftés non-feulement dans les deux parties dont ils
[ifont' compofés pour la plupart, mais encore quel-
s quefois dans la même partie.
Nous ne ferions pas entrés dans ces détails de
critique qu’on pourroit regarder comme minutieux,
fi nous n’y euflions vu . qu’un défaut de précifion
, dans la définition d’un mot ou dans l’énonciation de
^quelques idées ; mais non-feulement ces inexactitudes
donnent des idées incomplettes des objets
|dont on parle ; il en réfulte encore ( ce qui efl plus
{important) des erreurs & de faux jugements qui
Ipeuvent égarer F efprit & le goût fur les vrais prin-
fcipes des arts. C ’eft ce dont on verra quelques
‘ exemples.
| Nous n’entreprendrons pas ici de donner une dé-
[finîtion exaCe de l’<zir ; peut-être cela eft-il impof-
Sfible ; parce que les progrès fucceflifs de la mu-
|fique ont fait donner le même nom à des com-
jpofitions très-diverfès.
; L’idée la plus générale qu’on attache à ce mot
ïeft celle d’une pièce de mufique compofée d’un
[certain nombre de phrafes «Plantantes , liées par
vdes formes régulières ’& fymetriques , & fe terminant
dans le même mode où elles ont commencé.
I: • Çette définition convient aux airs de danf eà
A r R 59
c e u x q u ’e x é c u te n t le s in f t r um e n t s , c om m e a u x airs
ch an tes .
L e s p rem ie r s ch ants de s f a u v a g e s , la ch an fo n de
m o r t d u h u r o n , c e lle q u e l e n è g r e ch an te en dan-
f a n t , fo n t d e s airs p ro p r em en t dits.
L e s g r e c s a v o ie n t d e v é r ita b le s airs , q u o iq u ’en
a ien t d it q u e lq u e s é c r iv a in s , p u ifq u ’i ls é to ie n t
c om p o fé s fu r de s ftro p h e s r é g u liè r e s , q u e lq u e fo is
a v e c de s re fra in s . I ls a v o ie n t de s airs d e flû te &
d e c y th a r e ; de s airf d e d a n fe ; d e s airs a f l e â é s à
ce rta ins t ra v a u x & c . ( V o y e z le s d ifféren ts a r t ic le s
d e la Mufique ancienne. )
L e s v é r ita b le s airs fo n t c e u x d e c e s ch an fo n s
p o p u la i r e s , p ro p r e s à tou te s le s nation s , d o n t le s
au teu r s fo n t i g n o r é s , p a rc e q u e c e n ’é to ien t pa s
d e s artifte s , m a is de s h om m e s fen fib le s à qu i
e lle s é to ien t in fp ir é e s p a r un g o û t n atu re l. P lu fieu r s
d e c e s an c ie n n e s ch an fp n s o n t u n ch a rm e d e
m é lo d ie au q u e l n ’o n t p u atte in d re le s p lu s b e a u x
airs d e n o t re m u fiq u e fa v a n te & a r t ific iè lle .
I l e f l d iffic ile d e d é te rm in e r q u e ls o n t é té le s
p rem ie r s airs q u ’o n p u if le re g a rd e r p ro p r em en t
c om m e le s p ro d u c tio n s d e l ’art, A la r e n a if la n c e
d e la m u fiq u e , le s m u fic ien s é to ie n t d e s f a v a n t s ,
p lu tô t q u e de s artifte s , q u i n e s’a p p liq u o ie n t q u ’à
p e r fe c tio n n e r l e c o n t r e p o in t , & n e l ’em p lo y o ie n t
q u ’au fe r v ic e d e l ’é g life .
L e s m ad r ig au x fi fam e u x d u 1 5 e. f iè c le n ’é to ie n t
q u e de s c om p o f it io n s d’h a rm o n ie , q u o iq u e c e
fu f le n t d e p e tits p o èm e s a f le z ré g u lie r s & e n
la n g u e v u lg a i r e , m is e n ch an t pa r le s p lu s h a b
ile s m aître s ; mais c e s c om p o f iteu r s s’ a p p liq u o ie n t
p lu s à y p ro d ig u e r tou s le s artifice s du co n t r ep o in t
qu ’à y d o n n e r le s fo rm e s fym é t r iq u e s & l ’u n ité d e
m é lo d ie q u i d o iv e n t caraCtérifer p a rt icu liè r em en t un
air. D ’a illeu r s c e s p iè c e s é to ie n t fa ite s e n g é n é r a l
p o u r ê tre ch an té e s p a r p lu fieu r s v o ix .
D a n s le s p r em iè r e s r ep ré fen ta tio n s ly r ic o -d r a -
m a t iq ü e s , q u i fu r en t im a g in é e s e n I ta lie & e x é cu
té e s v e r s la fin d u 1 6 e. f iè c le , l e ch an t n e fu t
d ’a b o rd q u ’u n p u r r é c i t a t i f , q u e le s m u fic ien s
c om p o fo ie n t d ’ap rè s l ’ id é e q u ’ils s ’é to îe n t fa ite
d e la m é lo p é e d e s g r e c s . L e p r em ie r air m e fu r e
q u ’o n a it c i té d e c e s an c ien s m é lo d ram e s , f e
t ro u v e dan 3 VEuridîce d e R in u c c in i , m is e n m u -
f iq u e p a r P é r i e n 1 5 9 5 ; mais c e s p rem iers e f la is
é to ie n t en c o r e b ie n im p a r fa its . C e n e fu t q u e v e r s
l e m ilie u d u f iè c le fu iv a n t «que des airs v ra im e n t r é g
u lie r s fu r e n t in tro d u its dans le s o p é ra s ( V o y e z
Mufique. ,( H i fto ir e d e la ) .
O n c o n ç o it q u e la m é lo d ie & la fo rm e d e c e s
airs fu r e n t d ’a b o rd t rè s -fim p le s . L e m è t re e n é to it
r é g u lie r , & le ch an t f y l l a b iq u e , c om m e dans le s
ch a n fo n s p o p u la ir e s , le fq u e l le s du ren t en f e r v i r d e
m o d è le s .
P e u -à -p e u la m u fiq u e in ftrum en ta le & l ’a r t d u
ch an t fa ila n t d e s p r o g r è s , le s com p o fiteu r s m o in s
t im id e s ch e r ch è r e n t d e s fo rm e s p lu s v a r ié e s , d o n n
è r e n t à la v o ix u n d iap a fo n p lu s é t e n d u , fig u rè ren t
le s a c c om p a g u e r a p u t s , a c c o u p lè r e n t p lu f ie u r s n o te s
. 1 1 ::