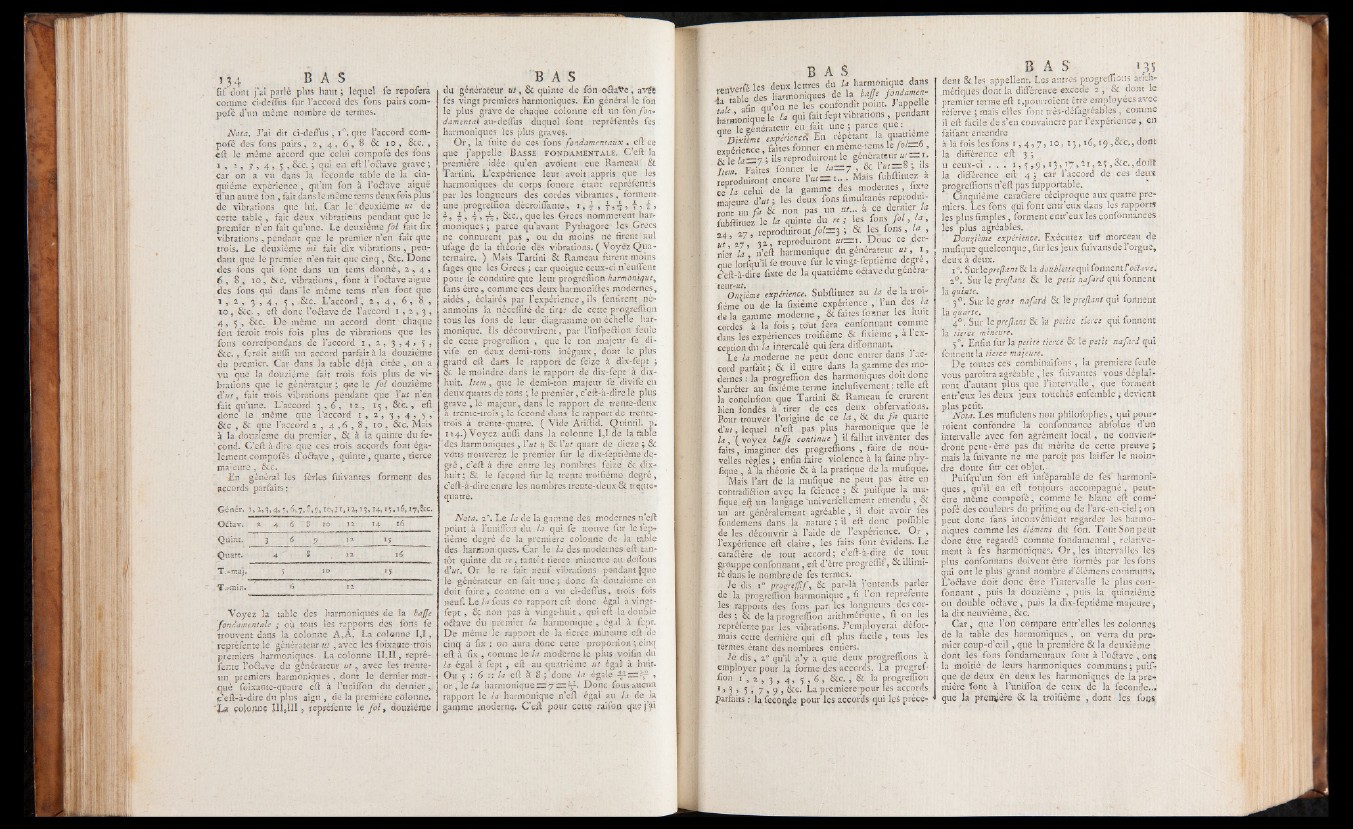
1 3 4 B A S
fif dont j'ai parlé plus haut ; lequel Te repofera
comme ci-deffus fur l’accord des Tons pairs composé
d’un même nombre de termes.
Nota. J’ai dit ci-deffns , i °. qiie l’accord compofé
des' fons pairs , 2 , 4 , 6 , 8 St 10, &c. -,
èft le même accord que celui compofé des Tons
1 , ’ , 7 , 4 , 5 ,& c .; qui en eft l’ôâ:ave grave;
car on a vu dans la fécondé table de la cinquième
expérience, qu’un fon à l’o&ave aiguë
cfun antre fon, fait dans le même te ms deux fois plus
de vibrations que lui. Car le ! deuxième ut de
cette table , fait deux vibrations pendant que le
premier n’en fait qu’une. Le deuxième foi fait fix
vibrations , pendant que' le premier n’en fait que
trois. Le deuxième mi fait dix vibrations ,' pendant
que le premier n’en fait que cinq , Stç. Donc
des fons qui font dans un tems donné, 2 , 4 ,
<5 , 8 , 10, &c. vibrations, font à l’oâave aiguë
des fons qui dans~le même tems n’en font que
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ,&c. L’accord, 2 , 4 , 6 , 8 ,
xo, &c; , eft donc l’oâave de l’accord 1, 2, 3,
4 , 5 , Stc. De- même un accord dont chaque
fon feroit trois fois plus de vibrations que les
fons correfpondans de l’accord 1, 2, 3,4» 5 ,
Stc. , feroit aufli un accord parfait à la douzième
du premier. Car dans la table déjà citée , on a
yu que la douzième fait trois fois plus de vibrations
que le générateur; que le fo l douzième
Ci u t, fait trois vibrations pendant que Y ut n’en
fait qu’une. L’accord 3, 6, 12., 15, &c., eft
donc le même que l’accord 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,'
Stc , St que l’accord 2 , 4 , 6 , 8 , 10, Stc. Mais
à la douzième du premier, & à la quinte du fécond.
C’eft à-dire que ces trois accords font éga-
Jement compofés d’o â a v e , quin te, qua rte, tierce
m a jeu re, 8cc. .
-En - général les férié? fuivarttes forment des
accords parfaits ;
Génér. 1'»i»?» 4 » >2 ô»7 ,8,9, Io?.IT, 1 2 ) 13 ,1 4 , IJ.IÔ, 17,&C,
O â a v . 2 4 6 10 . 12. ; 14' l6 ,
Quint, 3 6 5> n 1 15
Quart. 4 S ia t 6
T.-maj. ' .5 ' to
T.rmin. 6. 12
V o y e z la t a b l é des harmoniques de la baffe
fondamentale ; oii tous les rapports des fons fe
trouvent dans la. colonne A ,A . L a colonne 1 , 1 ,
repréfente le générateur u t , avec les foixaate-trois
premiers harmoniques. : La colonne I I , I I , repréfente
l’o f l iv e du générateur u t , avec les-trente-
un premiers harmoniques;, dont le dernier marqué
feixante-qnatre eft à l’uniffon du dernier
ç eft-à-dire du plus aigu , de la première colonne.
%$. colonne 111,111 ? repréfente le fo l , douzième
B A S
du générateur u t , St quinte de fon -oétatfe, avët
fes vingt premiers harmoniques. En général le fon
le plus grave de chaque colonne eft un fon fondamental
au-deffus duquel font repréfentés fes
harmoniques les plus graves.
O r , la fuite de ces fons fondamentaux, eft ce
jqné j’appelle Basse fondamentale. C ’eft la
première idée qu’en avaient eue Rameau 8t
Tartini. L’expérience leur avoit appris que les
harmoniques du corps.fonore étant repréfentés
par les longueurs des cordes vibrantes, forment
une progreftion décroiiTante, r , é » f > > S > i>
7 , | , j ' , f s > Stc., que les Grecs nommèrent harmoniques
; parce qu’avant Pythagore les Grecs
ne connurent pas , ou du moins ne firent nul
ufage de la théorie dès vibrations. ( Voyez Quaternaire.
) Mais Tartini St Rameau furent moins
fages que les Grecs ; car quoique ceux-ci n’ëuffent
pour le conduire que leur progreftion harmonique,
fans être, comme ces deux harnioniftes modernes,
aidés , éclairés par l’expérience, ils fentirent néanmoins
la néceftité de tirfr de cette progreftion
tous les fons de leur diagramme ou échelle harmonique.,
Us découvrirent, par l’infpe&ion feule
de cette progreflion-, qtje le ton majeur fe di-
vife en deux,demi-tons inégaux, dont le plus
grand eft dans le rapport de féize à dix-fept ;
St le moindre dans le rapport de dix-fept à dix-
huit. Item, que le demi-ton majeur fe diyife en
deux quarts de tons ; le premier, c’eft-à-dire le plus
grave , le majeur, dans le rapport de trente-deux
à trente-trois; le fécond dans, le rapport de trente-
trois à trente-quatre. ( Vide Ariftid. Quintil. p.
114.) V oyez aufîi dans la colonne 1,1 de la fable
'des harmoniques » Y ut # 8t Y ut quart de dieze ; St
vous trouverez le premier fiir le dix-feptiènie degré,
c’eft à dire entre les. nombres feizë St dix-
huit ; 8c le fécond fur lq trente troifième. degré,
c’eft-à-dire entre les nombres trente-deux St trqn-te-?
quatre.
Nota. 2°. Le la de la gamme des modernes n’eft
point à l’uni (Ton du la qui fë trouve fur le Septième
degré de la première colonne de la table
des harmoniques. Car 1 q la des modernes-eft tantôt
quinte du re , tantôt tierce mineure au cleftous
dyut. Or le re fait neuf vibrations pendant {que
le générateur en fait une ; donc fa douzième en
doit faire, ccmmé on a vu ci-deffus, trois fois
neuf. Le la fous ce rapport eft donc égal à vingt-
fe p t , St non pas à vingt-huit,. qui eft la double
oâave du premier la harmonique , égal à fept.
De même le rapport de la tierce mineure eft de
cinq à fix : on aura donc cette proportion ;.cinq
eft à fix , comme \&la moderne le plus voifin du
la égal à fe p t, eft au quatrième ut égal à huit.
Ou 5 : 6 :* /<* eft àr 8 ; donc la égale' *
or , le -la harmonique ~ 7 : = —. Donc fous aucun
rapport le la harmonique n’eft égal au la de la
gamme modernç, C ’eft pour cette raifon que Jp
B A S
rpnVerfé les deux lettres du f e harmonique dans
f table des Harmoniques de la bajjc fonéamen-
fa l afin qu’on ne les confondit point. Rappelle
harmonique le U qui fait fept v ib ra tion s. pendant
nue le générateur en .fa tt une ; parce q u e .
q Dixième expérience! En répétant la quatrième
wroérience , faites fonner en meme-tems le / o /_ 6 ,
& le la— 7 > ils reproduiront le générateur u: — j.
f o L . Faites fonner le ia= 7 , & » 3 « ‘ ‘f
reproduiront encore r « = i . . . . Mats fubftituez a
J la celui de la gamme des modernes , fixte
maieure d’u t -, les deux fons funultanes reproduiront'un
fa & non pas un ut... a -c e d e rn ie r la
fubftituez le là quinte du re ; les fons f o l , la ,
- , i 7 , r e p ro d u iro n t/ o te j ; & l e s .fo n s , la ,
ut 2 7 , 3 2 , reproduiront ut— i. D o n c ce dernier
^ , n’eft harmonique du générateur ut , K
que lorfqu’il fe trouve fur le vingt-feptieme d e g re ,
c ’eft-à-dire fixte de la quatrième o â a v e d trgenerateur
«/. -, » j i ■
Onzième expérience. Subftituez au U t de la troisième
ou de la fixième expérience , l’un des./*
de la gamme moderne, & faites fonner les huit
cordes à la fois ; tout fera conformant comme
dans les expériences troifième & fixième , à l’exception
du la intercalé qui fera diffonnant.
Le la moderne ne peut donc entrer dans 1 accord
parfait; 8c il eijtre dans la gamme des modernes
: la progreftion des harmoniques doit donc
s’arrêter au fixième terme inclufivement : telle eft
la conclut on que Tartini & Rameau fe crurent
bien fondés à tirer de ces deux obfervations.
Pour trouver l’origine de ce la , & du fa quarte
Cl u t, lequel n’eft -pas plus harmonique que le
la , ( voyez baffe continue ) il fallut inventer des
faits, imaginer des progreflions , faire de nouvelles
règles ; enfin faire violence a la faine physique
, à la théorie & à la pratique de la mufiqiie.
Mais l’art de : la mufique ne peut pas etre en
coiitradiéliôn avec la fcience ; & puifque la mufique
eft un langage "univerfellement entendu , &
un' art généralement agréable , il doit avoir fes
fondemens dans là nature ; il eft donc poflible
de les découvrir à l’aide de l’expérience. Or ,
l’expérience eft claire, les faits font évidens. Le
caràftère de tout accord; c’eft-à-dire de tout
grouppe confonnant, eft d’être progreffif, & illimité
dans le nombre de fes termes.
Je dis i° progreffif, & par-là j’entends parler
de la progreflion harmonique , ft l’on reprefente
les- rapports des' fons j)ar. les longueurs des cordes
; & de la progreflion arithmétique, ft on les
repréfer.-te par les vibrations. J’employerài défor-
. mais cette dernière qui eft plus facile , tous lés
termes étant des nombres entiers.
Je dis,, 2° qu’il n’y a que deux progreflions à
employer pour la forme des aepords. La progref-
fion i , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , & c . , & la progreftion
1 >3 » j , 7 , 9 ; , &c. La première pour les accords
parfaits ; la fecoi^de pour les accords qui lçs pièce-.
B ' A S ' * 3 5
dent & les appellent. Les autres progreflions arithmétiques
dont la différé ace excède 2 , & dont le
premier terme eft i,pourroient être emp loyé es a vec
réferve ; mais elles font très-défagréables , comme
il eft facile de s’en convaincre par l ’expérience , en
faifanr entendre
à la fois les fons t , 4 , 7 , 1 0 , 1 3 , 1 6 , 1 9 ,& c . , dont
la différence eft 3 ;
u ceux-ci . . . 1 , 5 9 9 »13 » T7 » •> M » ^ c* » dont
la différence eft 4 ; car l’accord de ces deux
progreflions n’eft pas fupportable.
'. Cinquième càradere réciproque aux quatre premiers.
Les fons qui font entr’eux dans les rapports
les plus Amples, forment entr’eux les confonnances
lés plus agréables.
Douzième expérience. Exécutez llrf morceau dé
mufique quelconque, fur les jeux fui vans de l’orgue,
deux à deux.
1 °. Sur le p re fiant & la doüblette qui forment/’ o,Slave:
2q. S u r i q preflant 8c lê petit nafard qui Tonnent
la quinte.
- 3 ° . Sur le gros nafard & le preflant qui forment
la quarte.
40. Sur le preflant & la petite tierce qui fonnent
la tierce mineure.
5°; Enfin fur la petite tierce & le petit nafard qui
fonnent la tiercé majeure.
D e toutes cés combinai f o n s , la première feule
vous paroîtra agréable , les Suivantes vous déplairont
d’autant plus que l’in te rv a lle , que forment
entr’eux les deux jeux touchés enfemble ; devient
plus petit.
Nota. Les mufleiens non p hîlofophes, qui pour-
roient confondre la confonnance abfolue d’un
intervalle avec fon agrément lo c a l , ne conviendront
peut - être pas du mérite de cette preuve ;
mais la fuivante ne me paroît pas laiffer le moindre
doute fur cet objet.
Puifqu’un fon eft inféparable de fes’ harmoniq
u e s , qu’il, en eft toujours accompagné , peut-
être même com p o fé , comme le blanc eft com-'
pofé des couleurs du prifme,ou de l ’arc-en-ciel ; on
peut donc fans inconvénient regarder les harmoniques
comme les élèmens du fon. T o u t Son peut
donc être regardé comme fondamental, relativement
à fes harmoniques. O r , les intervalles les
plus confonnans doivent être formés par les fons
qui ont le plus" grand nombre d’élémens communs*
L ’oélave doit donc être l ’intervalle le plus confonnant
, puis la douzième , puis, la quinzième
ou doublé o â a v e , puis la dix-feptième majeu re,
la dix neuvième, & c .
C a r , que l’on compare entr’elles les colonnes
de la table des harmoniques , on verra du pre».
mier coup-d’oe i l , que la première & la deuxième
dont les fons fondamentaux font à l’o â a v e , ont
la moitié-de leurs harmoniques communs; puiC-
que de deux èn deux les harmoniques de la pre-,
mière fon t à l’iiniffon de ceux de la fécondé...'
que la p r e n d r e & la troifième , dont les foos