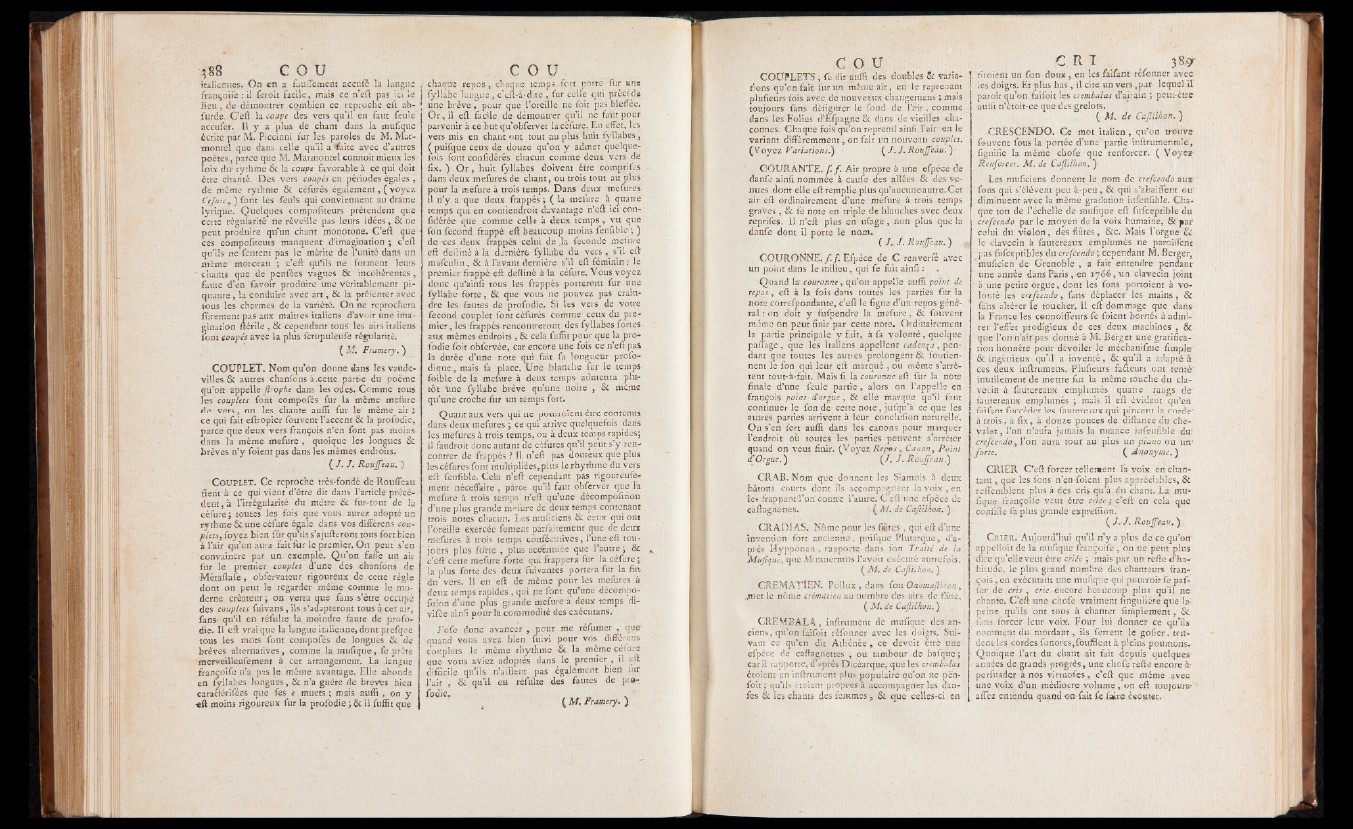
. f p t c o u
italiennes. On en a fauffement accufé la langue
françoife : il feroit facile, mais ce n’eft pas ici le
lieu , de démontrer combien ce reproche eft ab-
furde. C ’eft la coupe des vers qu’il en faut feule
accufer. 11 y a plus de chant dans la mufique
écrite par M. Piccinni fur les paroles de M. Mar-
montel que dans celle qu’il a îfeite avec d’autres
poètes, parce que M. Marmoiitelconnoît mieux Les
loix du- rythme & la coupe favorable à ce qui doit
être chanté. Des vers coupés en périodes égales ,
de même rythme & céfurés également, ( voyez
Cefure,') font les feuls qui conviennent au drame
lyrique. Quelques compofiteurs prétendent que
cette régularité ne réveille pas leurs idées, & ne
peut produire qu’un chant monotone. C ’eft que
ces compofiteuis manquent d’imagination ; c’eft
qu’ils ne Tentent pas le mérite de l’unité dans un
même morceau ; c’eft qu’ils ne forment leurs
' chants que de penfées vagues & incohérentes,
faute d’en favoir produire une véritablement piquante
, la conduire avec a r t, & la préfenter avec
tous les charmes de la variété. On ne reprochera
fïïrement pas aux maîtres italiens d’avoir une imagination
ftérile , & cependant tous~i.es airs italiens
iont coupés avec la plus fcrupuleufe régularité.
( M. Framery. )
COUPLET. Nom qu’on donne dans les vaudevilles
& autres chanfons à.cette partie du poème
qu’on appelle /?rophe dans les odes. Comme tous
les couplets font eompofés fur la même mefure
de vers , on les chante auffi fur le même air ;
ce qui fait eftropier fouvent l’accent & la profodie,
parce que deux vers françois n’en font pas moins"
dans la même mefure , - quoique les longues 8c
brèves n’y foient pas dans les mêmes endroits.
(V . J. Roujfeau.')
C o u p l e t . Ce reproche très-fondé de Rcuffeau
dent à ce qui vient d’être dit dans l’article précédent,
à l’irrégularité du mètre 8c fur-tout de la
céfure; toutes les fois que vous aurez adopté un
rythme & une céfurè égale dans vos différens couplets,
foyez bien fur qu’ils s’ajufteront tous fort bien
à l’air qu’cn aura fait fur le premier. On peut s’en
convaincre par un. exemple. Q u ’on faffe un air
fur le premier couplet d’une des chanfons de
Métaftale, obfervateur rigoureux de cette règle
dont on peut le regarder même comme le moderne
créateur; on verra que fans s’être occupé
des couplets fuivans , ils s’adapteront tous à cet air,
fans' qu’il en réfulte la moindre faute de profodie.
Il eft vrai que la-langue italienne, dont prefqne
tous les mots font eompofés de longues 8c. de
brèves alternatives, comme la mufique, fe prête
merveUieufement à cet arrangement. La langue
françoife n’a pas le même avantage. Elle abonde
en fyllabes longues, 8c n’a guère de brèves bien
caractérifées que fes e muets ; mais aufîi , on y
-e ft moins rigoureux fur la profodie ; & il fuffit que \
c o u
i chaque repos , chaque temps-fort porte fur une
| fyllabe longue, c’eft-à-dire , fur celle qui précède
| une brève, pour que l’oreille ne foit pas bleffée.
O r , il eft facile de démontrer qu’il ne faut pour
parvenir à ce but qu’obferver la céfure. En effet, les
vers mis en chant ont tout au plus huit fyllabes,
( puifque ceux de douze qu’on y admet quelquefois
font confidérés chacun comme deux vers de
fix. ) O r , huit fyllabes doivent être comprifes
dans deux mefures de chant, ou trois tout au plus
pouf la mèfure à trois temps. Dans deux mefures
il n’y a que deux frappés ; ( la melure à quatre
temps qui en contiendroit davantage n’eft ici confédérée
que comme cell* à deux temps, vu que
fon fécond frappé eft beaucoup moins fenfible ; )
de -ces deux frappés celui de .la fécondé mefure
eft deilinè à la dernière fyllabe du vers s’il eft
mafculin , & à l’avant dernière s’il eft féminin : le
premier frappé eft deftiné à la céfure. Vous voyez
donc qu’àinfi tous les frappés porteront fur une
fyllabe- forte, 8c que vous ne pouvez pas craindre
les fautes de profodie. Si les vers de votre
fécond couplet font céfurés comme ceux du premier
, les frappés rencontreront des fyllabes fortes
aux mêmes endroits , & cela fuffit pour que la profodie
foit obfervée, car encore une fois ce n’eft pas
la durée d’une note qui fait fa longueur profo-
dique, mais fa place. Une blanche fur le temps
foible de la mefure à deux temps admettra plutôt
\ine fyllabe brève qu’une noire , 8c même
qu’une croche fur un temps fort.
Quant aux vers qui ne pourroient être contenus
dans deux mefures ; ce qui arrive quelquefois dans
les mefures à trois temps, ou à deux temps rapides;
il faudroit donc autant de céfurés qu’il peut s’y ren--
contrer de frappés ? Il n’eft pas douteux que plus
les céfurés font multipliées, plus lerhythmé du vers
eft fenfible. Cela n’eft cependant pas rigoureufe-
ment néceffaire , parce qu’il faut obferver que la
mefure à trois temps n’eft qu’une décompofmon
d’une plus grande mefure de deux temps contenant
trois notes chacun. Les muficiens 8c ceux qui ont
l’oreille exercée fentent parfaitement que de deux
mefures à trois temps confécutives, l’une eft toujours
plus forte , plus aceéntuée que l’autre ; &
c’eft cette mefure forte qui frappera fur la céfure ;
la plus forte des deux fui vantes portera fur la fin-
du vers. Il en eft de même pour les mefures à
deux temps rapides, qui ne font qu’une décompo-
fttion d’une plus grande mefure à deux temps di-
vifée ainfi pour la commodité des exécutans.
J’ofe donc avancer , pour me réfumer , que-
quand vous avez bien fuivi pour vos différens
couplets le même rhythme 8c la même céfure'
que vous aviez adoptés dans le premier , il eft
difficile qu’ils n’aiilent pas également bien fur
l ’air , 8c qu’il en réfulte des fautes de pr»-
fodie^ '
( M . Framery> )
c o u
COU P LE T S , fe dir auffi des doubles 8c variations
qu’on fait fur un même air, en le reprenant
plufieurs fois avec de nouveaux changement ; mais
toujours fans défigurer le fond de l’a ir , comme
dans les Folies d’Efpagne 8c dans de vieilles cha-
connes. Chaque fois qu’on reprend ainfi l’air en le
variant différemment, on fait un nouveau couplet.
(V oyez Variations.) ( J. J. Roujfeau, )
COURANTE , f. f . Air propre à une efpèce de
danfe ainfi nommée à caufe des allées 8c des venues
dont elle eft remplie plus qu’aucune autre. Cet
air eft ordinairement d’une mefure à trois temps
graves, 8c fe note en triple de blanches avec deux
feprifes. 11 n’eft plus en ufage-, non plus que la
danfe dont il porte le nom.
( ƒ.. J. Roujfeau. )
COURONNE, f . f . Efpèce de C renverfé avec
un point dans le milieu, qui fe fait ainfi :
Quand la- couronne, qû’on appelle auffi point de
repos, eft à la fois dans toutes les parties fur la
note correfpondante, c’eft le figne d’un repos général
: on doit y fufpendre la mefure, 8c fouvent
même on peut finir par cette note. Ordinairement
la partie principale y fait, à fa volonté, quelque
paffage, que les Italiens appellent caden^a, pendant
que toutes les autres prolongent 8c foutien-
nent le fon qui leur eft marqué , ou même s’arrêtent
tout-à-fait. Mais ft la couronneeft für la note
finale d’une feule partie, alors on l’appelle en
françois point d'orgue , 8c elle marque qu’il faut
continuer le fon de cette note, jufqu’à ce que les
autres parties arrivent à leur conciufion naturelle.
On s’en fert auffi dans les canons pour marquer
l’endroit où toutes les parties peuvent s’arrêter
quand on- veut finir. (Voyez Repvs, Canon, Point
d'Orgue.') (/. J. Roujfeau,')
CRAB. Nom que donnent les Siamois à deux
bâtons courts dont ils accompagnent la voix , en
les frappant'l’un contre l’autre. C ’eft une efpèce de
caftagriettes. ’ ( M. de Cajtilhon. )
CRADIAS. Nome pour les fiâtes , qui eft d’une
invention fort ancienne, puifque Plutarque, d’après
Hypponan , rapporte dans fon Traité de la
Mufi^uc, que Mimnermusl’avoit exécuté autrefois.
(uVf; de Cajlilhon. )
CREMATIEN. Pollux , dans fon Onomajlïeon,
jmet le nome crématien au nombre des airs de flûte.
( M. de Cajlilhon. ) ,
CREME AI., 4 , infiniment de mufique des anciens,
qu’on faifoit réfonner avec les doigts. Suivant
ce qu’en dit Athénée , ce devoit être une
efpèce de caftagnettes , ou tambour de bafqtie ;
car il rapporte, d’après Dicéarque, que les crembnlas
étoient un infiniment plus populaire qu’on ne pén-
foit ; qu’ils étoient propres à accompagner les dan-
fies 8c les chants des femmes * 8c que celles-ci en
C R T 3 8 7
‘ tiioicnt un fon doux, en les faifant réfonner avec
les doigts. Et plus b as, il cite un vers ,par lequel il
paroît qu’on faifoit les ciembalas d’airain ; peut-être
aufii n’étoit-ce que des grelots.
( M. de Cajlilhon. )
CRESCENDO. Ce mot italien, qu’on trouve
fouvent fous la portée d’une partie inftrumentale,
fignifie la même chôfe que renforcer, ( Voyez-
Renforcer. M. de Cajlilhon. )
Les muficiens donnent le nom de crefcendo aux-
fons qui s’élèvent peu à-peu, 8c qui s’abaiffent ou’
diminuent avec la même gradation infenfible. Chaque
ton de l’échelle de mufique eft füfceptible du
crefcendo par le moyen de la voix humaine, 8c par
celui du violon, des flûtes, 8cc. Mais l’orgue te
le clavecin à fautereaux emplumés ne paroiffent
pas fufceptibles ducrefcendo',cependant M.Berger,
muficien de Grenoble , a fait entendre pendant
une année dans Paris , en 1766, un clavecin joint
: à une petite orgue, dont lés fons portoient à vo lonté
les crefcendo, fans déplacer les mains , 8c
fans altérer le toucher. Il eft dommage que dans
la France les connoiffeurs fe foient bornés à admirer
l’effet prodigieux de ces deux machines , 8c
que l’on n’aif pas donné à M. Berger une gratification
honnête pour dévoiler le méchanifme fimple
8c ingénieux qu’il a inventé, 8c qu’il a adapté à
ces deux inftrumens. Plufieurs faâeurs ont tenté"
inutilement de mettre fur la même touche du cla-
vëcin à fautereaux emplumés quatre rangs de'
fautereaux- emplumés ; mais il eft évident qu’ en
faifant fuccéder lès fautereaux qui pincent la corde'
à trois, à fix , à douze pouces de diftance dù chev
a le t, l’on n’aura jamais la nuance infenfible du'
crefcendo, l’on aura tout au plus un piano ou un'
f forte. ( Anonyme. )
CRIER C ’eft forcer tellement là voix en chan-
; tant, que les fons n’en foient plus appréciables, 8c
I reffemblent plus à des cris qu’à du chant. La'mu-
i fique i'rançoife veut être criée ; c’eft en cela que
confifte fà plus grande expreffion.
( J. J. Roujfeau. )
C rier. Aujourd’hui qu’il n’y 3 plus de ce qu’on
appelloit de la mufique françoife , on ne peut plus
dire qu’elle veut être criée ; mais par un refte d’h a»
blinde, le plus grand nombre des chanteurs françois
, en exécutant une mufique qui pourroit fe paf-
1èr de cris , crie encore beaucoup plus qu’il no
chante. C ’eft une chcfe vraiment fingulière que la-
peine qu’ils ont tous à chanter fimple ment, 8c
fan$ forcer leur voix* Four lui donner ce qu’ils
nomment du mordant, ils ferrent le gofier, tendent
les cordes fonores,fouffient à pleins poumons»-
Quoique l’art du chaut ait fait depuis quelques
années de grands progrès, une choférefte encore à-
perfiiader à nos virtuofes, c’ eft que même avec
une voix d’un médiocre volume, on eft toujours
, a fiez entendu quand on fait fe. foire éçouter,