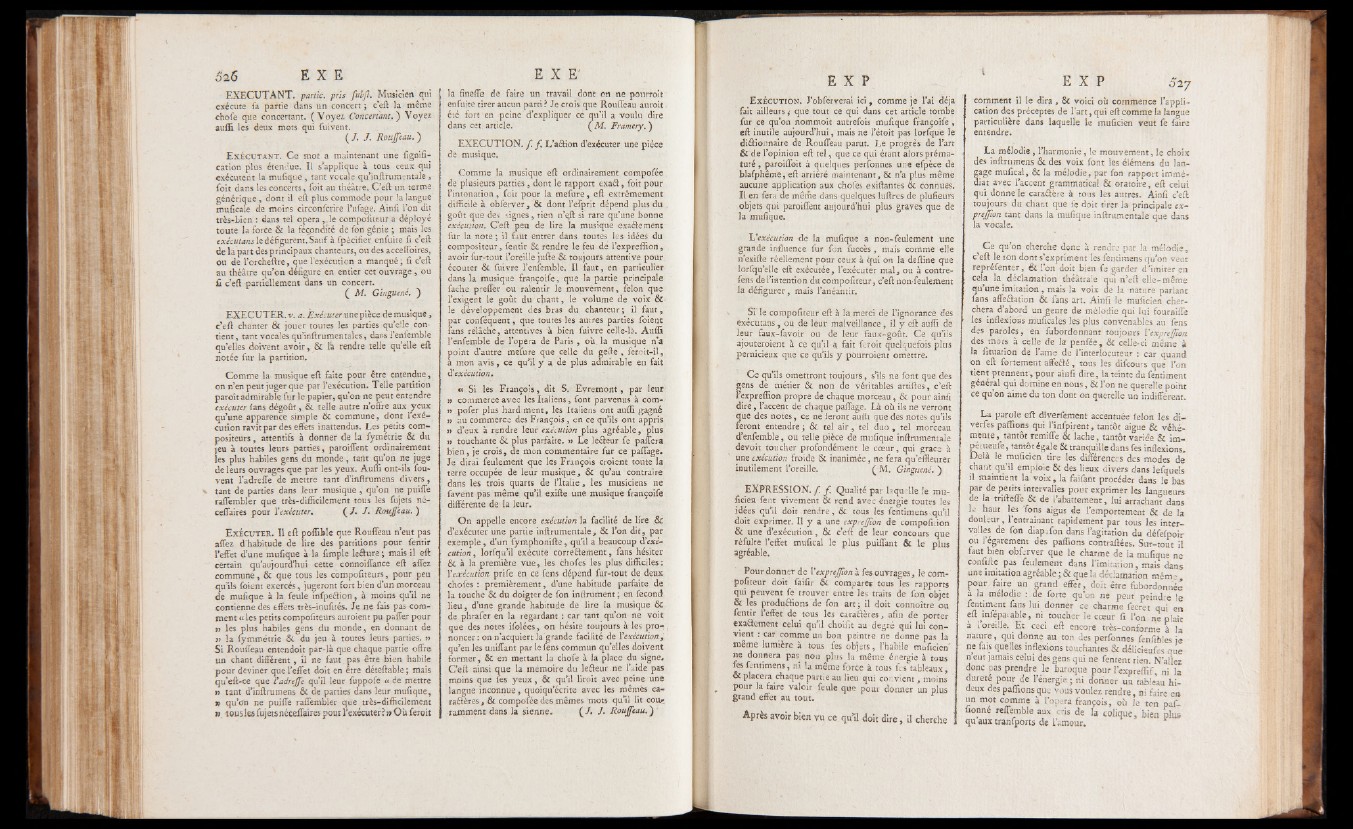
E X E C U T A N T , partie, pris fu b ft. Mus icien qui
e x é cu te fa pa rtie dans un con c er t ; c’eft la même
c h o fe qu e conc ertant. ( V o y e z Concertant.') V o y e z
su ff i le s deu x m o ts qu i fu iv en t.
( ƒ . J . R o u ffe a u .)
E xécutant. C e m o t a maintenant u n e f ign ifi-
c a tio n plus étendue. I l s'ap p liqu e à tous ceu x qui
e x é cu ten t la mu fiqu e , tant v o c a le qu’infîrumentale ,
f o i t dan s les c o n c e r ts , fo it au théâtre. C ’eft u n terme
g é n é r iq u e , dont il eft plus com m o d e p ou r la langue
m u fica le de moins circon fcr ire l’uTage. A in f i l’on dit
trè s -b ien : dans te l op é ra , J e com p oftteu r a d é p lo y é
to u te la fo rc e & la fécon d ité de fon g én ie ; mais les
exécutans le d é figurent. S a u f à fp è c ifie r en fu ite fi c’eft
d e la pa rt des prin c ipaux ch an teurs , o u des accefi'oires,
o u de l’o r ch e ft r e , q ue l'e x é cu tio n a man qué ; fi c’eft
a u th éâ tre q u ’o n d é figure en entier ce t o u v r a g e , ou
£ c’eft p a rtie llem en t dans un co n c e r t.
( M . Ginguené. )
E X E C U T E R , v . a. E x é cu te r une piè ce d e musique ,
c’ e ft chanter & jo u e r tou te s les parties qu’ efie co n tient
, tant v o ca le s qu ’in ftrum en ta le s , dans i’enfembîe
q u ’elles d o iv e n t a v o i r , & là rendre te lle qu ’e lle eft
n o té e fu r la p a rtition.
C om m e la musique eft fa ite p ou r ê tre en ten d u e ,
o n n’en peut ju g e r q u e pa r l’ex écution . T e l le pa rtition
p a ro ît admirab le fu r le pap ier, qu ’o n ne peu t entendre
exécuter fans d é g o û t , & t e lle au tre n’o ffre au x y e u x
q u ’une apparence s im p le & com m u n e , d o n t l’e x é cu
tio n ra v it p ar des effets inattendus. L e s petits com positeu
rs , a ttentifs à don n e r d e la fym é t r ie & du
je u à tou te s leurs p a rtie s , pa roiffent o rdinairement
les plus habiles gens d u m o n d e , tant qu’on ne ju g e
d e leurs ou v ra g e s q u e par le s y e u x . A u f f i o n t-ils fou -
v e n t l ’ad reffe de me ttre ta n t d’inftrumens d i v e r s ,
tant d e parties dans le u r mu siqu e , qu’o n ne p u iffe
raffemb le r q u e trè s-d iffic ilement tous les fujets n é -
ceflaires p o u r Vexécuter. ( / . / . Roujfeau. )
E x é cu t e r . I l e f t p o f fib le q u e R o u ffe au n’eu t pas
a ffe z d'hab itu de d e lire des partitions p ou r fentir
l ’effet d’u n e mu fiq u e à la f im p le le ftu re ; mais i l eft
ce rta in q u ’aujourdTiui ce tte connoiffance eft affez
c om m u n e , & q u e tou s les c om p o ftteu r s , p o u r peu
q u ’ils foien t e x e r c é s , ju g eron t fort b ien d’un morceau
d e m u fiq u e à la feu le in fp e â io n , à mo in s qu ’il ne
c o n tie n n e des effets très-inufités. Je n e fais pas com m
en t « les petits compoftteurs auroient p u pa ffer p ou r
» les plus habiles gens d u m o n d e , en donnant de
v la fym m é t r ie & du jeu à toutes leurs parties. »
S i R ou ffe au entendoit p a r - là q ue ch aque pa rtie o ff r e
u n chant d i f fé r e n t , i l n e faut p a s ê tre b ie n habile
p o u r d e vin er que l’effe t do it en ê tre déteftable ; mais
q u ’e f t- c e q u e l’adreffe qu’ il leur fu p p o fe « de mettre
» tant d’inftrumens & de parties dans leu r m u fiq u e ,
jp q u ’on n e p u iffe raffembler q u e trè s-d iffic ilement
» to u s les fujets néceffaires p ou r l’ex écuter ? » O ù fero it
la fineffe de faire un travail dont on ne pourroit
enfuite tirer aucun parti ? Je crois que Rouffeau auroit
été fort en peine d’expliquer ce qu’il a voulu dire
dans cet article. ( M. Framery. )
E X E C U T IO N , f . f . L ’a&ion d’exécuter une pièce
de musique.
Comme la musique eft ordinairement compofée
de plusieurs parties , dont le rapport exaé l, foit pour
l’intonation, foit pour la mefure, eft extrêmement
difficile à ob fe rve r, & dont l’efprit dépend plus du
goût que dei signes, rien n’eft si rare qu’une bonne
exécution. C ’eft peu de lire la musique exactement
fur la note ; il faut entrer dans toutes les idées du
compositeur, fentir & rendre le feu de l’expreffion,
avoir fur-tout l’oreille jufte & toujours attentive pour
écouter & fuivre l’enfemble. Il fau t, en particulier
dans la musique françoife, que la partie principale
fâche preffer ou ralentir le mouvëment, félon que
l’exigent le goût du ch ant, le volume de voix &
le développement des bras du chanteur; il fa u t ,
par conféquent, que toutes les autres parties foient
lans rélâche, attentives à bien fuivre celle-là. A u ffi
l ’enfemble de l’opéra de Paris , où, la musique n’a
point d’autre mefure que celle du g e f te , feroit-il,
à mon a v is , ce qu’il y a de plus admirable en fait
d* exécution.
« Si les François, dit S. E v rem o n t , par leur
» commerce avec les Italiens, font parvenus à com-
11 pofer plus hard ment, les Italiens ont auffi gagné
n au commerce des François, en ce qu’ils ont appris
» d’eux à rendre leur exécution plus agréable, plus
m touchante & plus parfaite, n Le leéleur fe paffera
b ien , je crois, de mon commentaire fur ce paffage.
Je dirai feulement que les François croient toute la
terre occupée de leur musique, & qu’au contraire
dans les trois quarts de l’Ita lie , les musiciens ne
favent pas même qu’il exifte une musique françoife
différente de la leur.
O n appelle encore exécution la facilité de lire .&
d’exécuter une partie inftrumentale, & l’on dit, par
exemple, d’un fymphonifte, qu’il a beaucoup d'exécution
, lorfqu’il exécute corre&ement, fans hésiter
& à la première v u e , les chofes les plus difficiles:
Y exécution prife en ce fens dépend fur-tout de deux
chofes : premièrement, d’une habitude parfaite de
la touche & du doigter de fon infiniment ; en fécond
lieu , d’une grande habitude de lire la musique &
de phrafer en la regardant : car tant qu’on ne voit
que des notes ifolées, on hésite toujours à les prononcer
: on n ’acquiert la grande facilité de Y exécution,
qu’en les unifiant par le fens commun qu’elles doivent
forme r, & en mettant la chofe à la place du signe#
C ’eft ainsi que la mémoire du le&eur .ne l’aide pas
moins qu,e fes y e u x , & qu’il liroit avec peine une
langue inconnue, quoiqu’écrite avec les mêmes caractères
, & compofée des mêmes Tnots qu’il lit cour,
raniment dans la sienne. ( / . J. Rouffeau. )
Exécution. J’obferyerai i c i , comme je l’ai déjà
fait ailleurs / que tout ce qui dans cet article tombe
fur ce qu’on nommoit autrefois mufique françoife,
eft inutile aujourd’h u i, mais ne l’étoit pas lorfque le
dictionnaire de Rouffeau parut. L e progrès de l’art
& de l’opinion eft t e l, que ce qui étant alors prématu
ré, paroiffoit à quelques perfonnes une efpèce de
blafphême, eft arriéré maintenant, & n’a plus même
aucune application aux chofes exiftantës & connues.
I l en fera de même dans quelques luftres de plufieurs
objets qui paroiffent aujourd’hui plus graves que de
la mufique.
Inexécution -de la mufique a non-feulement une
grande influence fur fon fuccès, mais comme elle
n’exifte réellement pour ceux à qui on la deftine que .
îorfqu’elle eft exécutée, l’exécuter mal, ou à contre-
fens de l’intention du compoftteur, c’eft non-feulement
la défigurer, mais l’anéantir.
S I le compoftteur eft à la merci de l’ignorance des
exécutans i ou de leur malveillance, il y eft auffi de
leur faux-favoir ou de leur faux-goût. C e qu’ils
ajouteroient à ce qu’il à fait feroit quelquefois plus
pernicieux que ce qu’ils y pourraient omettre.
C e qu’ils omettront toujours, s’ils ne font que des
gens de métier & non de véritables artiftes, c ’eft
l’expreffion propre de chaque morceau, & pour ainfi
d ire , l’accent de chaque paffage. Là où ils ne verront
que des notes , ce ne feront auffi que des notes qu’ils
feront entendre ; & tel a i r , tel d u o , tel morceau
d’enfemble, ou telle pièce de mufique inftrumentale
devoit toucher profondément le coe u r, qui grâce à
une exécution froide & inanimée, ne fera qu’effleurer
inutilement l’oreille. ( M. Ginguené. )
EX PR ESSION , f. f . Qualité par laquelle le mu-
fieien fent vivement & rend avec énergie toutes les
idées qü’il doit rendre, & tous les fentimens < qu’il
doit exprimer. Il y a une exprcjjion de compofidon
& une d’exécution, & c’eft de leur concours que
réfulte l’effet mufical le plus puiffant & le plus
agréable.
Pour donner de YexpreJJion à fes ouvrages, le compositeur
doit faifir & compares tous les rapports
qui peuvent fe trouver entre les traits de fon objet
& les produ&ions de fon a r t; il doit connoître ou :
fentir l’effet de tous les caraélères, afin de porter
exactement celui qu’il choifit au degré qui lui convient
: car comme un bon peintre ne donne pas la
même lumière à tous fes objets, l’habile muficien'
ne donnera pas non plus la même énergie à tous
fes fentimens, ni la même force à tous fes tableaux,
& placera chaque partie au lieu qui con v ien t, moins
pour la faire valoir feule que pour donner un plus
grand effet au tout.
Après avoir bien vu ce qu'il doit dire, il cherche
comment il le d ira , & voici où commence l’ application
des préceptes de l ’art, qui eft comme la langue
particulière dans laquelle le muûcien veut fe faire
entendre.
La mélodie, l’harmonié, le mouvement, le choix
des inftrumens & des voix font les élémens du langage
mufical, & la mélodie, par fon rapport immédiat
avec l’accent grammatical & oratoire, eft celui
qui donne le caraCtère à tous les autres. Ainfi c’eft
toujours du chant que fe doit tirer la principale ex-
prejjion tant dans la mufique inftrumentale que dans
la vocale.
C e qu’on cherche donc à rendre par la mélodie,
c’eft le ion dont s’expriment les fentimens qu’on veut
repréfenter, & l’on doit bien fe garder d ’imiter en
cela la déclamation théâtrale qui n’eft elle-même
qu’une imitation, mais la voix de la nature parlant
fans affeCtation & fans art. Ainfi le muficien cherchera
d’abord un genre de mélodie qui lui fourniffe
1 les inflexions muficales les plus convenables au fens
des pa roles, en fubordonnant toujours YexpreJJion
des mots à celle de la p en fée , & celle-ci même à
la fituation de l’ame de l’interlocuteur : car quand
on eft fortement affeCté, tous les difeours que l’on
tient prennent', pour ainfi dire, la teinte du fentiment
général qui domine en nous, & l ’on ne querelle point
ce qu’on aime du ton dont on querelle un indifférent.
La parole eft diverfement accentuée lelon les d i-
verfes pallions qui l’infpirent, tantôt aigue & véhémente
, tantôt remiffe & lâche, tantôt variée & im-
pétueufe, tantôt égale & tranquille dans fes inflexions#
D elà le muficien tire les différences des modes de
chant qu’il emploie & des lieux divers dans lefqueîs
il maintient la v o ix , la faifant procéder dans le bas
par de petits intervalles pour exprimer les langueurs
de la - trifteffe & de i abattement, lui arrachant dans
!• lîaut aigus de l'emportement & de la
douleur, 1 entraînant rapidement par tous les intervalles
de fon diapafon dans l’agitation du défefpoir
ou l’égarement des paffions contraftées. Sur-tout il
faut bien obferver que le charme de la mufique ne
confifte pas feulement dans l’imitation, mais dans
une imitation agréable; & que la déclamation même ,
pour faire un grand effe t, doit être fubordonnée
à la mélodie : de forte qu’on ne peut peindre le
fentiment fans lui donner ce charme fecret qui en
eft infépaiable, ni toucher le coeur fi l’on ne plaît
à 1 oreille. Et ceci eft encore très-conforme à la
nature, qui donne au ton des perfonnes fenfibies je
ne fais quelles inflexions touchantes & délicieufes que
n’eut jamais celui des gens qui ne fentent rien. N ’allez
donc pas prendre le baroque pour l’expreflïf, ni la
dureté pour de l’énergie ; ni donner un tableau hideux
des paffions que vous voulez rendre, ni faire en
un mot comme à l’opéra françois, où le ton p a f-
fionné reffemble aux cris de la colique, bien plus
qu aux tranfports de l’amour.