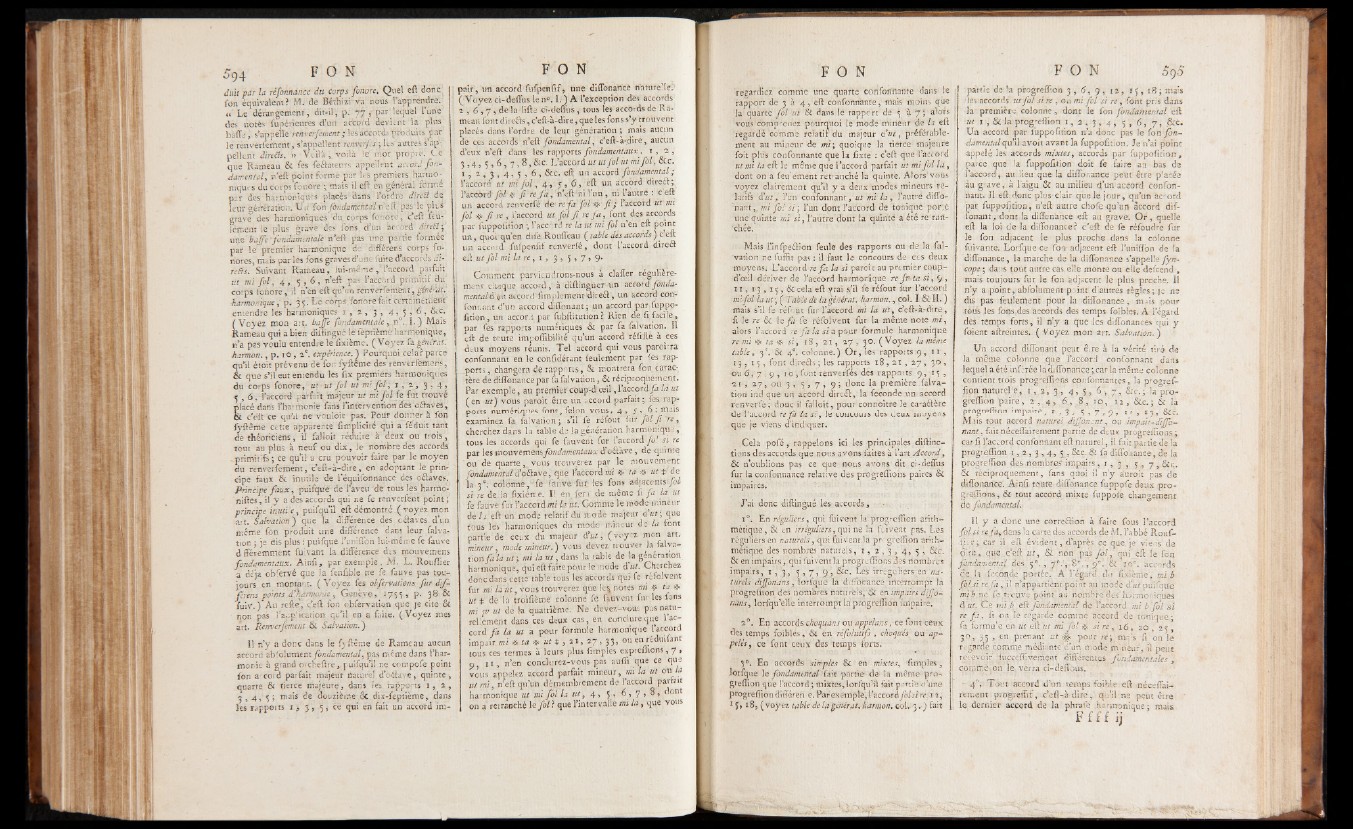
diiit par la rtfonnan.ee du corps fonore. Quel eftdonc
fon équivalent? M. de Béthiziva nous l’apprendre.
«' Le dérangement, dit-il, p: 77 , par lequel lune
des notés fupèrieures d’un accord devient la plus
baffe, s’appelle renverfement ;\cs accord.sptbduits par
le renverfement, s’appellent renverfes ; les autres s’appellent
directs. » Voilà ,, voilà le mot propre. Ce
que Rameau & fes fe&ateurs appellent accord fondamental
, neft point formé par les premiers harmoniques
du corps ibnore ; mais il eft en générai formé
par des harmoniques placés 'dans l’ordre direct de
leur génération. Un îonfondamental n'elt;pas'le plus
grave des harmoniques du corps fonore, c’eft feulement
le plus grave des fons d’un accord dtfe& f
une baffe • fondamentale n’eft pas une partie formée
par le premier harmonique de différens corps fo-
nores, mais par les fons graves d’une fuite d’accords dire
fis» Suivant Rameau, lui-même l’accord parfait
ut mi fo l, 4 , 5 , 6 , n’eft .pas l’accord primhjf dii'
corps fonore , il n’en eft qu’un renverfemeiït , ffnèfàu
■ harmonique, p. 35 . Le corps fonore fait certainement
entendre les harmoniques 1 , 2 , 3 , 4 , j f é , &c.
(V o y e z mon art. bajfe fondamentale > n°..I..) Mais
Rameau qui a bien diftingué le leprième harmonique,
n’a pas voulu entendre le fixième. (V oyez h générât,
harmon. , p. 1 0 , 2e. expérience. ) Pourquoi cela? parce
qu’il étoit prévenu de fon fyftême des renverfemeré,
& que .s’il eut entendu les fix premiers harmoniques
du corps fonore, ut ut fol ut ml fo l, 1 , 2 , 3 , 4 ,
3 , 6 , l’accord parfait majeur u t mi fol fe fut trouvé
placé dans l’harmonie fans l’intervention des o&avès,
6c c’èft ce qtdil ne vculôit pas. Pour donner à fon
fyftême cette apparenté fimpliciié qui a féduit tant
de théoriciens, il failoit réduire à deux ou trois,
tout au plus à neuf ou dix, le nombre des accords
-primitifs ; ce qu’il a cru pouvoir faire par le moyen
du renverfement, c’eft-à-dire, en adoptant le principe
faux & inutile de l’équifonnance des o&ayes.
Principe faux , puifqué de l’aveu cfë tous les harriio-
niftes, il y a des accords qui ne fe renverfent point ;
principe inutile , puifqu’il eft démontré ( voyez mon
art. S a lv a tio n ) que la différence des odaves d’un
même fon produit une différence dans leur falva-
tion ; je dis plus : puifque i’uniffon lui-même fe fauve
d fféremment fuivant la différence de s mouvenrens
fondamentaux. Ainfi, par exemple . M. L. Rouffier
a déjà obfervé que la fenfible ne fe fauve pas toujours
en montant. (V o y e z fes obfervations.fur d if-
férens points ddliamonie , Genève., 175 5 , p. 38 &
fuiv. ) Au refte', c’eft fon cbfervation que je cite- &
non pas î’app'ication qu’il en a faite. (Voyez mes
art. Renverfement & Salvation. )
11 n’y a donc dans le fyftême de Rameau aucun
accord abfolument fondamental, pas même dans l’harmonie
à grand meheftre, puifqu’il.ne compofe point
fon arcord parfait majeur naturel d’oéiave, quinte ,
quarte & tierce majeure, dans les rapports 1 , 2 ,
3 , 4 , 5 ; mais de douzième Ôc dix-feptième, dans
les rappoits 1 9 3 , 5 $ ce qui en fait un accord impair,
un accord fufpenfif, tane diffonànce naturelle/
( Voyez ci-deffus le n°. I. ) A l’exception dés accords
2 ,■ 6 , 7 , de là lifte ci-deffus, tous les accords de Rameau
font direéls, c’eft-à-dire, que les fons s’y trouvent
placés dans l’ordre de leur génération ; mais aucun
de ces accords n’eft fondamental, c’eft-à-.dire, aucun
d’eux n’eft dans les rapports fo n d am en ta u x, 1 , 2 ,
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8, &c. L’accord u t u t f o l u t mi f o l , &c.
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , &c. eft un accord fondamental ;
l’accord u t m i f o l , 4 , y , 6 , éft un accord dir eft ;
l’accôr*}■ fo l & f i r e f à ,n’effohi l’un , ni l’autre : c eft
; un accord renverfé d e 'r e f d fol'^r' f ir, l’accofd ut mi
i fol # f i re , l’accord ut fol f i re fa , font désaccords
. par fuppofition ; l'accord re la ui mï fol nen e& point
un, quoi' qu’en dife Rouffeau ( table des accords ) c eft
un accord fufpenfif renverfé, dont l’accord direél
ëft.ut fol mi lare, 1 , 3 , 5 , 7 , 9 .
Comment parviendrons-nous à clafler régulière?-
; ment chaque accord,‘ à diftfngüer ùnî accord fonda-
[ mental d\ÿ{\ accord fi m pl è m e n tdir è& un accord côn-
| Tonnant d’un accord diffonant; un accord par fuppo-
; fition, un accord par fubftitution? Rien de fi facile,
• par fes rapports numériques & par fa falvation. Il
; eft de tcute impoflibilité qu’un accord réliilè a ces
' deux moyens réunis. Tel accord qui vous parobra
confonnant en le considérant feulement par fes rapports,
changera de rapports, & montrera fon caractère
de diffonànce par fa falvation, & réciproquement.
Par exemple, au premier coup-d oeil, l’accord fa là ut
(en ut) vous paroît être un accord parfait; fes rapports
numériques font, félon vous, 4 , 5 , 6 ; mais
examinez fa falvation; s’il fe réfout (ûv fol f i re,
cherchez dans la table de la génération harmonique,
tous les accords qui fe fauvent fur l’accord fol si re
par les mouvemëns fondamentaux d’oéiàve, de quinte
ou de quarte, vous trouverez par le mouvement
i fondamental d’oéiave, que l’accord rrii ❖ tà f ut g de
la.3e: cdlbnné, ; fe fâtive fur les fons adjacentsf o l
; si re de,.la fixième. Il en fera de meme fi fa la ut
i fe fauve fur l’accord mi la ut. Gomme lé mode mineur
de l.i eft un mode relatif du mode majeur d ut; que
tous lés harmoniques du mode mineur de la font
partie de ceux du majeur S u t, (voyez mon art.
mineur, mode mineur.') vous devez trouver la falva-
tioii fa la ut', mi la ut, dans la table de la génération
harmonique, qui eft faite poiir le mode d'ut. Cherchez
donc dans celte table tous les accords qui fe réfolvent
fur mi là iit, vous trouverez que le| notes mi # ta &
ut 4 dê là troifième’ colonne fe fauvent fur les fons
mi jv ut de la quatrième. Ne devez-vous pas naturellement
dans ces deux cas, en conclure que l’accord
f a la u t a pour formule harmonique l’accord
impair mi * ta * HZ * , z i , «7 > 3 3> ou en réduifant
tous ces termes à leurs plus fimples expreflions, 7 »
9 1 1 , n’en conclurez-vous pas auffi que ce que
vous appelez accord parfait mineur, mi la m ou ‘a
u t mi, n’eft qu’un démembremènt de l’accord parfait
harmonique u t mi fol la u t , 4 , 5, 6 , 7 . ^ ’ dont
on a retranché le fo ll que l’intervalle mi la , que vous
regardiez" comme une quarte conformante dans, le
rapport de 3" a 4 , eft confonnânte, mais moins que
la quarte fol ut St dans le rapport de 5 à 7 ; alors
vous comprenez pourquoi le mode mineur de la éft
regardé comme relatif du majeur d'ut, préférablement
au mineur de mi; quoique la tierce majeure
foit plus confonnânte que la fixte : c’eft que l’accord
ut rni la eft le même que l’accord parfait ut mi fo l la ,
dont on a feu ement retranché la quinte. Alors' vous
voyez clairement qu’il y a deux modes mineurs relatifs
déut, l’un confonnant, ut mi la; l’autre difTo-
nant,. mi fol si ; l’un dont l’accord de tonique por;.e
une^quinte rni si, l’autre dont la quinte â été re'ran-
'chëe.
Mais L’infpeélion feule des rapports ou de la fal-
vation ne fuffit pas : il faut le concours de ces deux
moyens; L’accord re fa la si paroît au premier co.up-
d’oeil dériver de l’accord harmorique re Jv ta si, 9 ,
1 1 , 1 3 , 1 5 , & cela eft y rai s’il fe réfout fur l’accord
mï fol la ut ; ( Table de la générât, harmon., col . I & II. )
mais s’il fe réfoût fur l’accord rrii la lit, c’eft-àrdire,
fi le re & i e f i fe réfolvent fur la même note mi,
alors l’accord re fa la si a pour formule harmonique
re nd # ta # .si, 18 , 2 1 , 27 , 30. ( Voyez la même
table, 3 V & 4% colonne.) O r , les rapports.9, 11 ,
13 , 15 , font dire&s ; les rapports 1 8 , 2 1 , 27, 30 ,
ou 6 i j i 9,10», font renverfes des rapports 9., 15 ,
21 , 2 7 , ou 3 , 5 , 7 , 9 ; donc la première , falvation
indque un accord direél, la fécondé un accord
renverfé; donc il falloir, pour connoître le ca'aétère
de l’accord re fa la s i , le concours des ceux moyens
que je viens d’indiquer.
Gela pofé, rappelons ici les principales diftinc-
tio.ns des accords que nous avons faites à l’art Accord,
& n’oublions pas ce que nous avons dit ci-deffus
fur la confonnance relative des progrefliohs paires & 1
impaires.
J’ai donc diftingué les accords,
i° . En réguliers, qui fuirent la progreflîon arithmétique,
& en irréguliers, qui ne la foi vent pas. Lés
réguliers en naturels, qui fuivent.la prrgreflipn arithmétique
des nombres naturels , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , Sic.
& en impairs, qui f’uivent la prpgfe'fliQns des nombres
impairs, 1 , 3 , 5 , 7 , 9, &c. Les irréguliers ;^ennaturels
dijfonans, lorfque la diffotrance interrompt là
progreflîon deé nombres nattirèls^ Si en impairs diffù-
nans, lorfqu’êlle interrompt la progreffîon impaire.
20. En accords choquans ou appela?;s, ce font ceux
des temps foibles, & en rèfolutifs, choqués ou appelés,
ce font ceux des temps forts;
3 °. En accords simples & en mixtes, (Impies,
Jorfque le fondamental fait partie1 de la même pro-
grefiion que l’accord; mixtes, lorfqu’il fait p-ni’e-d’une
progreflîon différen e. Par exemple, l’accord folsire. 1 î ,
1 5j 18, ( voyez table de la générât* harmon. coh 3 .) fait
partie de là progreflîon 3 , 6 , 9 , 12, 1 5 , 18 ; mais
les accords ut fo l si re , 0« mi fo l si re, font pris dans
la première colonne, dont le fon fondamental eft
tu 1 , & la progreflîon 1 , 2 , 3 , 4 > $» 6, 7 , &c.
Un accord par fuppofition n’a donc pas Je fon fon-
damentalqu’il avoir avant la fuppofition. Je n’ai point
appelé les accords mixtes, accords par fuppofition,
parce que la fuppofition doit fe faire au bas de
l’accord, au lieu que la diffonànce peut être placée
âu g;ave, à l’aigu & au milieu d’un accord confon-
riant. îl eft. donc plus clair que le jour, qu’un accord
par fuppofition, n’eft autre chofe qu’un accord dif-
fonant, -dont la diffonànce eft au grave. O r , quelle
eft la loi de la diffonànce? c’eft de fe réfoudre fur
le fon adjacent le plus proche dans la colonne
fuivante. Lorfque ce fon adjacent eft l’uniffon de la
diffonànce, la marche de la diffonànce s’appelle fyn-
copsi; dans tout autre cas, elle monte ou elle defeend ,
mais toujours fur le fon adjacent le plus proche. Il
n’y a point, abfolument p. int d'autres règles; je ne
dis pas feulement.pour la diffonànce, mris pour
tous les fons,des accords des temps foibles. A l’égard
des temps forts, il n’y a que les diffonances qui y
foient aftreintes. ( Voyez mon arr. Salvation. )
Un accord diffonant peut êire à la vérité tiré de
la même colonne que l’accord confonnant dans
lequel a été inférée la di ffonànce ; car la même colonne
contient trois progreflions conformantes, la pro^ref-
fion naturel'e, 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 ;, 7 , Sic.; la pro-
grefllôn 'paire 2 , ; 4 , 6 , 8, 10, 12 , &c. ; & là
progreflîon impaire , r , 3 , 5 , 7 , 9 , 1 r , i * 9 Sic.
Mais tout accord naturel diffonant, ou impdir-dijfo-
nant, fait néceffairement partie de deux progreffions ;
car fl l’accord confonnant eft nature!, il fait partie de la
progreflîon 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , &ç. & fa diffoàance, de la
progreflîon des .nombres'impairs, 1 , 3 , 5, y , Sic.
ÔC réciproquement, fans quoi il n’y a'uroit cas de
diffonànce. Ainfl toute diffonànce fuppofe deux pro-
greflîons, Ôc tout accord mixte fuppofe changement
de fondamental.
Tl y a donc une correélioh à faire fous l’accord
fol si re fa, dans la carte des accords de M. l’abbé Rouf-
fh-r; car il eft évident, d’après ce que, je viens de
dirè., que .c’eft ut, & non pas fo l, qni ëft le fon
fondamental des 5e. , 7 C.:;: 8®,', 9e. & 10e. accords
që M -foconde portée/ A l’égard, du fixième mi b
folsire fa , j l n’appartient point au mode d«r puifaüe
mi b ne fe trouve point au nombre des harmoniques
d ut. Ce rnï b eft fondamental de l’accord mi b fo l si
re fa , ft on le regarde comme accord de tonique;
fa formu’e en ut eft ut mi fol sir e , 16 , 20 , 25 ,
30, 35 , en prenant ut ^ pour re; mos fi on le
regarde çomrqe médiantéhi’un mode mineur, il peut
fecëyôif ' fùccefl:vement différentes fondamentales
çonimé 011' le, verra ci-deffous.
40. Tout accord d’un temps foible eft néceffairement
progreflif, c*eft-à-dire, quai ne peut être
le dernier accord de la phrafe harmonique; mais
F f f f ij