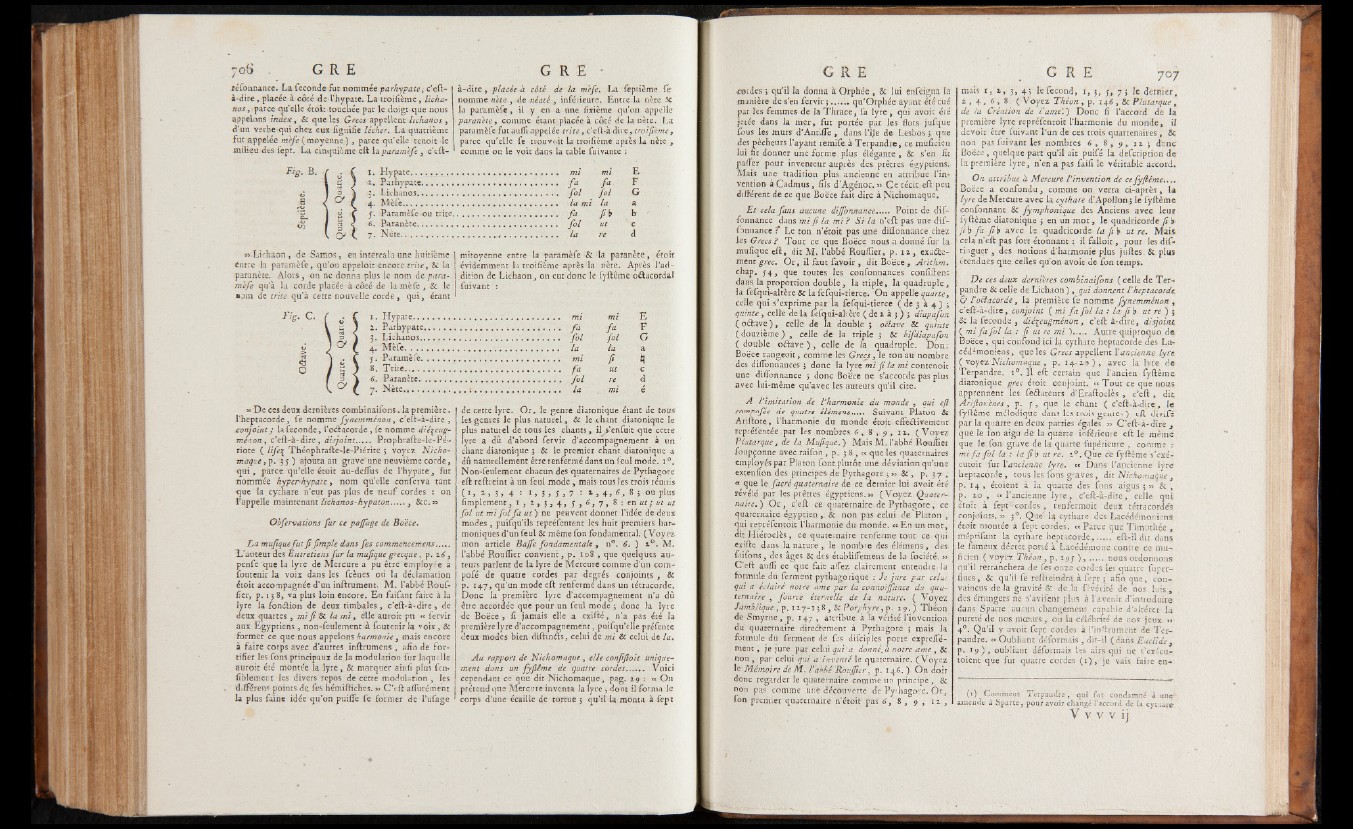
féfonnance. La fécondé fut nommée parhypate, c’eft-
à-dire, placée à côté d e l’hypate. La troisième, lichanos,
parce quelle étoit touchée par le doigt que nous
appelons index, & que les Grecs appellent lichanos ,
d’un verbe-qui chez eux lignifie lécher. La quatrième
fut appelée méfe (moyenne) , parce qu’ elle tenoit le
milieu des fept. La cinquième eft la paraméfe , c’cftà
dire, placée h. côté de la méfe, La feptièrne 1er
nomme néte 3 de néaté 3 inférieure. Entre la nète 5c
la paraméfe, il y en a une fixième qu’on appelle
paranéte, comme étant placée à côté de la nète. La
paraméfe fut auffi appelée trite , c’eft-à dire f troifième,
parce qu’elle fe trouvait la troifième après la nète ,
comme on le voit dans la table fuivante :
B.
ex
ex
Hypate.. .,
Parhypate.
Lichanos..
Méfe... . .
Paraméfe c
Paranéte..
Nète.........
f a
fo l
La mi
fa
fo l
la
la
fi\>
»Lichaon, de Samos , en intercala une huitième
entre la paraméfe , qu’on appeloit encore trite, & la
paranéte. Alors 3 on ne donna plus le nom de paraméfe
qu’à la corde placée à côté de la mèfe , & le
B-pm de trite qu’à cette nouvelle corde , qui, étant
mi E
f * F
fo l G
a
b '
cd
mitoyenne entre la paraméfe & la paranéte, étott
évidemment la troifième après la nète. Après l'addition
de Lichaon, on eut donc le fyftême oétacorda!
fuivant :
1. Hypate............................... ..
2. Parhypate..........................
3. Lichanos.............................
4. Mèfe.......................................
m m m m fai
mi
IB
fo l
E
FG
fi
ut
n
8. Trite..................................... c
6. Paranéte. ........................... . ....................... .. fo l re d
7. Nète..........................: . . . . . mi é
» De ces deux dernières combinaifons, la première,
lheptacorde, fe nomme fynemménon-, c’eft-à-dire,
conjoint j la fécondé, l’oélacorde, fe nomme diéçcugménon,
c’eft-à-dire, disjoint...... Prophrafte-le-Pé“
riote ( life% Théophrafte-le-Piérite 5 voyez Nichomaque
, p. 35) ajouta an grave* une neuvième corde,
qui, parce qu’elle étoit au-deflus de l’hypate, fut
nommée hyper-hypate, nom qu’elle conferva tant
que la cythare n’eut pas plus de neuf cordes : on
l’appelle maintenant lichanos-hypaton..... , &c. »
Obfervations fur ce pajfage de Boëce.
La mufique fut f i fimple dans fes commehcemens......
E ’auteur des Entretiens fur la mufique grecque, p. 1 6 3
penfe que la lyre de Mercure a pu être employée à
foutenir la voix dans les fcènes où la déclamation
étoit accompagnée d’un infiniment. M. l’abbé Rouf-
fîer, p. 13 8, va plus loin encore. En faifant faire à la
lyre la fondion de deux timbales, c’eft-à-dire, de
deux quartes , mi f i & la mi, dlle aurort pu « fervir
aux Egyptiens , non-feulement à foutenir la voix, &
former ce que nous appelons harmonie 3 mais encore
à faire corps avec d’autres inftrumens , afin de fortifier
les fons principaux de la modulation fur laquelle
auroit été montée la lyre, & marquer a in fi plus fen-
lïblement les divers repos de cette modulation , les
d.fterens points de. fes hémiftiches. » C ’eft aflurétrient
la plus faine idée qu’on puiffe fc former de l’ufage '
de cette lyre. O r , le genre diaronique étant de tous
les genres le plus naturel, & le chant diatonique le
plus naturel de tous les chants, il^’enfuit que cette
lyre a dû d’abord fervir d’accompagnement à un
chant diatonique ; & le premier chant diatonique a
dû naturellement être renfermé dans un feul mode. i° .
Non-feulement chacun des quaternaires de Pythagore
eft reftreint à un feul mode , mais tous les trois réunis
( 1 , 1 , 3 , 4 : 1, 3 , 5 , 7 : t , 4 , 8 j ou plus
fimplement, 1 , i , 3, 4, 5 , 6 , 7 , 8: en ut ; ut ut
fo l ut mi fo lfa ut) ne peuvent donner l’idée de deux
modes, puifqu’ils repréfentent les huit premiers harmoniques
d’un feul & mêmefon fondamental. (Voyez
mon article Baffe fondamentale, n°. 6. ) i ° . M.
l’abbé Rouffier convient, p. 108 , que quelques auteurs
parlent de la lyre de Mercure comme d’un com-
pofé de quatre cordes par degrés conjoints , &
p. 147, qu’un mode eft renferme dans un tétracorde.
Donc la première lyre d’accompagnement n’a dû
être accordée que pour un feul mode ; donc la lyre
de Boëce, fi jamais elle a exifté, n’a pas été la
première lyre d’accompagnement, puifqu’elle préfentc
deux modes bien diftinéts, celui de mi & celui de la.
Au rapport de Nichomaque, elle confiftoit uniquement
dans un fyflême de quatre cordes....... Voici
cependant ce que dit Nichomaque, pag. 19 : « O11
prétend que Mercure inventa la lyre, dont il forma le
r corps d’une écaille de tortue 5 qu’il la monta à fept
,cordes > qu’il la donna à Orphée , & lui enfeigna la
manière de s’en fervir j q u ’Orphée ayant été tué
par les femmes de la Thrace, fa lyre , qui avoit été
jetée dans la mpr, fut portée par les flots jufque
fous les murs d’Antifle , dans l’îje de Lesbos j qtse
des pêcheurs l’ayant remife à Terpandre, ce muficicn
lui fît donner une forme plus élégante, & .s'en fit
pafîer pour inventeur auprès des prêtres égyptiens.
Mais une tradition plus ancienne en attribue l’invention
à Cadmus, fils d’Agénor. » C e récit, eft peu
différent de ce que Boëce fait dire à Nichomaque.
Et cela fans aucune dijjbnnance..... Point de diffonnahee
dans mi f i la mi ? S i la n’cft pas une dif-
fonnance t Le ton n’étoit pas une difïonnance chez
les Grecs? Tout ce que Boëce nous a donné fur la
mufique eft, dit M. l’abbé Rouffier, p. 1 2 , exactement
grec. O r , il faut favoir , dit Boëce , Arithm.
chap. 5-4, que toutes les confonnançes confident
dans la proportion double, la triple, la quadruple,
la fefqui-altère & la fefqui-tierce. On appelle quarte,
celle qui s’exprime par la fefqui-tierce ( de 3 à 4 ) 5
quinte, celle delà fefqui-altère (de x à 3 ) j diapafon
i. oétave ) , celle de la double ; ottave & quinte
(doroième), celle de la triple j & bifdiapafon
(double oéfave ) , celle de la quadruple. Don:
Boëce rangeoit, comme les Grecs3 le ton au nombre
des difTonnances ; donc la lyre mi f i la mi contenoit
une diffonnance j donc Boëce ne s’accorde pas plus
avec lui -même qu’avec les auteurs qu’il cite.
A l'imitation de l'harmonie du monde , Qui efi
compofèe de quatre élémens..... Suivant Platon &
Ariftotç, l’harmonie du monde étoit effeftivemenr
r.cpiéfentée par les nombres 6 , 8 , 9 , n . (V oyez
Plutarque, de la, Mufique. ) Mais M. l’abbé Rouffier
foupçonne avec raifon , p. 3 8 , « que les quaternaires
employés par Platon font plutôt une déviation qu’une
extenfîon des principes de Pythagore j » &', p. 37 ,
« que 1 e,facré quaternaire de ce dernier lui avoir éré
révélé par les prêtres égyptiens.» (V oyez Quaternaire.)
O r , c’eft ce quaternaire de Pythagore, ce
quaternaire égyptien, & non pas celui de Platon ,
qui repréfentoit l’harmonie du monde, ce En un mot,
dit Hiéroclès, ce quaternaire renferme tout ce qui
exifte dans.la nature , le nombre des élémens , des
faifons, des âges & des établiffemens de la fociété. »
C ’eft auffi ce que fait a (fez clairement entendre- la
formule du ferment pythagorique : Je jure par celui \
qui a éclairé notre ame par la connoijfance du qua- \
ternaire , fource éternelle de la nature. ( Voyez j
Jamèlique , p. 1X7-13 8 , & Porphyre, p. 29.) Théoq
de Smyrne, p. 147 , attribue à la vérité l’invention
du quaternaire directement à Pythagore ; mais la
formule du ferment de fes difciples porte exprelfé-
menc, je jure par celui qui a donné, à noire ame, &
non, par celui qui a inventé le quaternaire. (Voyez
le Mémoire de M. l'abbé Roujfier, p. 146. ) On doir
donc regarder le quaternaire comme un principe, &
non pas comme Une découverte de Pyfhagore. Or.,
fon premier quaternaire n’étoit pas 6, 8 , 9 , 1 x ,
mais t , 1 , 4 ; le fécond, 1, j , 7 ; le dernier,
x , 4 , 6 , 8. ( Voyez Théon , p. 146, & Plutarque,
de la Création de L'ame'. ) Donc fi l’accord de la
première lyre repréfentoit l’harmonie du monde, il
dévoie être fuivant l'un de ces trois quartenaires , &
non pas fuivant les nombres 6 , 8 , 9 , n 5 donc
Boëce, quelque parc qu’il ait puifé la defeription de
la première lyre, n’en a pas faifi le véritable accord.
On attribue a Mercure l'invention de ce fyftême....
Boëce a confondu, comme on verra ci-après, la
lyre de Mercure avec la cythare d’Apollon 5 le fyftême
confonnant & fiymphonique des Anciens avec leur
fyftême diatonique j en un mot, le quadricorde fi |
p i fa fi]} avec le quadricorde la f i ut re. Mais
cela n’eft pas fort étonnant : il falloir, pour les dif*
tinguer , des notions d’harmonie plus juftesp & plus
étendues que celles qu’on avoit de fon temps.
De ces deux dernières combinaifons ( celle de Ter-*
pandre & celle de Lichaon ) , qui donnent Vheptacorde
& L'oëlacorde, la première fe nomme fynemménon ,
c’eft-à-dire, conjoint ( mi fa fo l la : la fi]} ut r e ) ;
& la fécondé , diéçeugménon, c’eft à-dire, disjoint
( mi fa fo l la : fi ut re mi )..... Autre quiproquo de
Boëce, qui confond ici la cythare heptacorde des La-r
cédémoniens, que les Grecs appellent Xancienne lyre
(voyez Nichomaque , p. 14-2.0), avec la lyre de
Terpandre. i° . 11 eft certain que l’ancien fyftême
diatonique grec étoit conjoint. « Tout ce que nous
apprennent les feélateurs d’Eraftoclès , c'eft , dit.
Ariftoxènes, p. 5, que le chant ( c’eft-à-dire, le
fyftême mélodique dans les trois genres ) eft divifé
par la quarte en deux parties égales. » C ’eft-à-dire 3
que le fon aigu de la quarte inférieure eft le même
que le fon grave de la quarte fupérieure , comme :
I mi fa fo l la : la fi]} ut re. x°. Que ce fyftême s’exé-
cutoit fur ['ancienne lyre. « Dans l’ancienne lyre
heptacorde , tous les fons graves, dit Nichomaque 3
p. 14 , étoient à la quarte des fons aigus ; » & ,
p. 20 , « l ’ancienne lyre, c’eft-à-dire, celle qui;
etoit à fept cordes , renfermoit deux tétracordes
conjoints. » 3°. QueHa cythare des Lacédémoniens
étoit montée à fept cordes. « Parce que Timothée ,
méprifant la cythare heptacorde........ eft-il dit dans
; le fameux décret porté à Lacédémone contre ce mu-
.ficicn ( voyez Théon , p. 195 ) , ..... nous ordonnons
qu’il retranchera de fes onze cordes les quatre fuper-
flucs, & qu’il fe reftreindra. à fept 5 afin que, convaincus
de Ja gravité & déjà févérité de nos lois,
des étrangers ne s’avifent plus à l’avenir d’introduire
dans Sparte aucun changement capable d’altérer la
pureté de nos moeurs , ou la célébrité de nos jeux. »
4°. Qu’il y avoit fept cordes à i’infîrument de Terpandre.
«Oubliant déformais, dit-il (dans Euclide ,
p. 19), oubliant déformais les airs qui ne s’exécu-
toient que fur quatre cordes ( 1 ) , je vais faite en-
(1) Comment Terpandre, qui fut condamné à une;
amende à Sparte, pour avoir changé l’accord de la cytuarç-
Y v v v ij