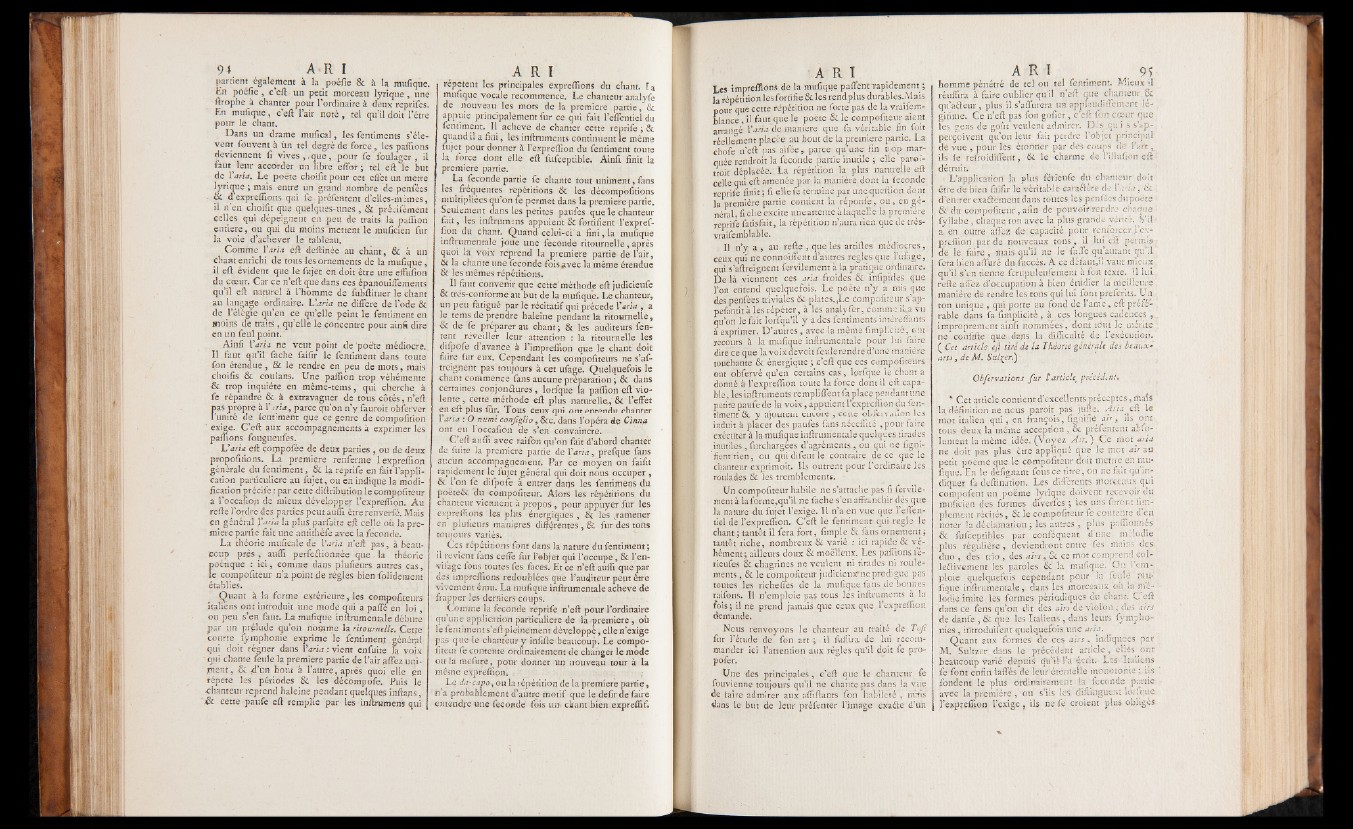
94 A.R I
partient également à la poéfie & à la mufique.
£n poéfie, c ’eft un petit morceau lyrique, une
ftrophe à chanter pour l’ordinaire à deux reprifes.
En mufique, c’eft l’air n oté, tel qu’il doit l’être
pour le chant.
Dans un drame mufical, les fentiments s’élèvent
fouvent à un tel degré de force, les paffions
deviennent fi vives , , que, pour fe foulager , il
faut leur accorder un libre eflor ; tel eft le but
de Varia. Le poëte choifit pour cet effet un métré
lyrique ; mais entre un grand nombre de penfées
- &c d’expreflions qui fe préfentent d’elles-mèmes,
il n’en choifit que quelques-unes, 8c précifément
celles- qui dépeignent en peu de traits la paflion
entière, ou qui du moins “mettent le muficien fur
la voie d’achever le tableau.
Comme Varia eft deftinée au chant, 8c à un
chant enrichi de tous les ornements de la mufique,
. il eft évident que le fujet en doit être une effufion
du coeur. Car ce n’eft que dans ces épanouiffements
qu’il eft naturel à l’homme de fubftituer le chant
au langage ordinaire. L\aria ne différé de l’ode 8c
de l’élégie qu’en ce qu’elle peint le fentiment en
moins de traits, qu’elle le concentre pour ainfi dire
en un feul point.
Aînfi Varia ne veut point de'poëte médiocre..
Il faut qu’il fâche faifir le fentiment dans toute
fon étendue, 8c le rendre en peu de mots, mais j
choifis 8c coulans. Une pafîion trop véhémente
8c trop inquiète en même-tems, qui cherche à
fe répandre 8c à extravaguer de tous côtés, n’eft
pas propre à Varia, parce qu’on n y fauroit obferver
l’unité de fentiment que ce genre de compofition
exige. Ç ’eft aux accompagnements à exprimer les
pâmons fougueufes.
L'aria eft çoippofée de deux parties , ou de deux
proportions. L a première renferme 1 expreflion
générale du fentiment, 8c la reprife en fait l’application
particulière au fui et, ou ën indique la modification
précife : par cette diftribution le compofiteur
a l’ocçafion de mieux développer Fexpreffion. Au
refte l’ordre des parties peut auffi être renverfé. Mais
en général Y aria la plus parfaite eft celle ou la première
partie fait une antithèfe avec la fécondé,
La théorie muftcale de Varia n’eft pas, à beaucoup
près , auffi perfe&ionnée que - la théorie
poétique : ic i, comme dans plufieurs autres cas J
le compofiteur n’a point de régies bien fplidement
établies.
Quant à la forme extérieure, les compofiteurs
Italiens ont introduit une mode qui a paffé en lo i ,
ou peu s’en faut. La mufique inftnynentale débute
par un prélude qu’on nomme la ritournelle. Cette
courte lymphome exprime le fentiment général
qui doit régner dans Varia ; vient enfuite la voix
'qui chante mule la première partie de l ’air affez uniment,
,8c bout à l’autre, après quoi elle en
répété les périodes 8c les décompofe. Puis le
chanteur reprend haleine pendant quelques inftaps,
& cette paufe eft remplie par les inftrumens qui
A R I
répètent les principales expreffions du chant. la
mufique vocale recommence. Le chanteur analylè
de nouveau les mots de la première partie, 8c
appuie principalement fur ce qui fait l’effentiel du
fentiment. Il achevé de chanter cette reprife ; 8c
quand il a fini, les inftruments continuent le même
fujet pour donner a Fexpreffion du fentiment toute
la force dont elle eft fufceptible. Ainfi finit la
première partie.
La fécondé partie fe chante tout uniment, fans
les frequentes répétitions 8c les décompofitions
multipliées qu’on le permet dans la première partie.
Seulement dans les petites paufes que le chanteur
fait, les inftrumsns appuient 8c fortifient l’expref-
fion du chant, Quattd celui-ci'a fini, la mufique
inftrumentale joue une fécondé ritournelle, après
quoi la voix réprend la première partie de l’air,
8c la chante une fécondé fois^vec la même étendue
8c les mêmes répétitions.
Il faut convenir que cette'méthode eft judicieufe
8c trèsrconforme au but de la mufique. Le chanteur,
un peu fatigué par le récitatif qui précédé Varia , a
le tems de prendre haleine pendant la ritournelle,
8c de fe préparer au chant; 8c les auditeurs fen-
tent réveiller leur attention : la ritournelle les
difpofe d’avance à l’impreflion que le chant doit
faire fur eux. Cependant les compofiteurs ne s’af-
treignent pas toujours à cet ufage. Quelquefois le
chant commence fans aucune préparation ; 8c dans
certaines conjonctures, lorfque la pafîion eft violente
, cette méthode eft plus naturelle,, 8c l’effet
en eft plus fur. Tous ceux qui ont entendu chanter
Varia : O nu mi conjiglio, 8cc. dans l’opéra de Cinna
ont eu 1 occafiôn de s’en convaincre.
C ’eft auffi avec raifôn qu’on fait d’abord chanter
de fuite la première partie de Varia, prefque fans
aucun accompagnement. Par ce moyen on faifit
rapidement le fujet général qui doit nous occuper ,
8c l ’on fe difpofe à entrer dans les fentimens du
poëte8c du compofiteur. Alors les répétitions du
chanteur viennent à propos, pour appuyer .fur les
expreftîons les plus énergiques , 8c les ^ramener
en plufieurs maniérés différentes , 8c fur des tons
toit jours variés.
Ces répétitions font dans la nature du fentiment;
il revient fans ceffe fur l’objet qui l’occupe, 8c l ’en*
vifage fous toutes fes faces. Et ce n’eft auffi que par
des imprëflions redoublées que l’auditeur petit être
vivement ému. La mufique inftrumentale achevé de
frapper les derniers-coups.
Comme la fécondé reprife n’eft pour l’ordinaire
qu’une application particulière de la première, oh
le fentiment s’eft pleinement développe, elle n’exige
pas que le chanteur y infifte beaucoup. Le compo-
fiteiu fe contente ordinairement de changer le mode
ou la mefure, pour donner un nouveau tour à la
même expreflipn-. • "
Le da-capo, ou la répétition de la première partie,
n’a probablement d’autre motif que le defir de faire
| entendre une fécondé fois un. chant bien expreftif.
A R I
Les impreflionS de la mufique paffëïit rapidement ;
la répétition les fortifie 8c les rendplus durables. Mais
pour que cette répétition ne forte pas de la vraifem-
blance, il faut que le poëte 8c le compofiteur aient
arrangé Varia'de maniéré que fa véritable fin (oit
réellement placée au bout de la première partie. La
chofe n’eft pas aifée, parce qu’une fin trop marquée
rendroit la fécondé partie inutile ; elle paroî-
troit déplacée.,La répétition la plus naturelle eft
celle qui eft amenée par la manière dont la fécondé
reprife finit ; fi elle fe termine par une queftion dont
la première partie contient la réponfe, ou, en général,
fi clie excite une attente à laquelle la première
reprife fatisfait, la répétition n’aura rien que dëtrèsvraifemblable.
Il n’y a , au refte , que les artiftes médiocres,
ceux qui ne connoiffent d’autres réglés que l’ufagé,
qui s’aftreignent fervilement à la pratique ordinaire.
De là viennent ces aria froides 8c infipides que
l’on entend quelquefois. Le poëte n’y a mis que
des penfées triviales 8c- plates.Xe compofiteur s’ap-
pefantit à les répéter, à les analyfër, Comme il>a vu
qu’on le fait lorfqu’il y a dès fentiments imérefïants
à exprimer. D ’autres, avec la même fimpilcité.'ont
recours à la mufique inftrumentale pour lui faire
dire ce que la voix devoit feule rendre d’une manière
touchante 8c énergique ; c’eft que ces compofiteurs
ont obfervé qu’en certains cas, lorfque le chant a
donné à Fexpreffion toute la force dont il eft capable,
les inftruments rëmpliffent fa place pendant une
petite paufe de la voix » appuient l’exprefiion du fentiment
8c y ajoutent encore ; cette obfervatîon les
induit à placer des paufes fans néceffité ,pour faire
exéçitter à la mufique inftrumentale quelques tirades
inutiles , Surchargées d’agréments, ou qui ne figni-
fienfrien, eu qui difent le contraire de ce que le
chanteur exprimoit. Ils outrent pour l’ordinaire les
roulades 8c les tremblements. -
Un compofiteur habile ne s’attache pas fi fervilement
à la forme,qu’il ne fâche s’en affranchir dès que
la nature du fujet l ’exige. 11 n’a en vue que l’effen-
tiel de Fexpreffion. C ’eft le fentiment qui réglé le
chant ; tantôt il fera fort, fimple 8c fans ornement ;
tantôt riche, nombreux 8c varié : ici rapide 8c véhément;
ailleurs doux 8c moelleux. Les paffions fé-
rieufes 8c chagrines ne veulent ni tirades ni roulements
, 8c le compofiteur j udicieux*ne prodigue pas
toutes les richeffes de la mufique fans de bonnes
raifons. Il n’emploie pas tous les inftruments à la
fois; il ne prend jamais que ceux que Fexpreffion
demande.
Nous renvoyons le chanteur au traité de Tofi
fur l’étude de fon art ; il fufiira de lui recommander
ici l’attention aux règles qu’il doit fe pro-
pofer.
Une des principales, c’eft que le chanteur fe
fouvienne toujours qu’il ne chante pas dans la vue
de taire admirer aux aftiftants fon habileté , mVis
dans le but de leur préfenter l’image exa&e d’un
A R I 95
homme pénétré de tel ou tel fentiment. Mieux il
réufîira à faire oublier qu’il n’eft que chanteur. &
qu’aéteur , plus il s’affurera ira apphudiffement légitime.
Ce n’eft pas fon gofiër, c’eft fon coeur que
les gens de goût veulent admirer: D :s qu i s s’ap-
perçoiyent qu’on leur fait perdre l’objet principal
de vue , pour lès étonner par des coups de l’art,
ils fe refroidiffent, 8c le charme de Fiiiufion eft
détruit.
L ’application la plus férieiife du chanteur doit
être de bien faifir le véritable caractère de Varia, &
d’enirer exactement dans toutes lés penfées du poëte
8c du compofiteur , afin de pouvoir rendre chaque
fyllabe , chaque, ton avec la plus grande vérité. S’il
a en outre affez de capacité pour renforcer Fexpreffion
par de nouveaux tons , il lui eft permis
de le faire, mais qu’il ne le faffe qu’autant qu’il
fera bien affurè du iuccès. A ce défaut,îî 'vaut mieux
qu’il s’en tienne fcrupuleufenient à fon texte. Il lui
refte affez d’occupation à bien étiklier la meilleure
manière de rendre les torts qui lui font preferits. Un
ton unique, qui porte au fond de Famé, eft préférable
dans fa ftmplicité, à ces longues cadences ,
improprement ainfi nommées , dont tout le mer,ne
ne’ confifte que- dans la difficulté de l’exécution.
( Cet article eft tiré de la Théorie générale des beaux- .
am } de M. S ulcéré)
Obfervations fur tarticle;précédant.
* Cet article contient d’excellents préceptes, mais
la définition ne nous paroît pas jufte. Aria^ eft lé
mot italien q u i, en françois, fignifiè air, ils ont
tous deux la même acception , 8c prefentent abfo-
lument la même idée. (Voyez Air. ) Ce mot aria
ne doit pas plus être appliqué que le mot air au
petit poëme que le compofiteur doit mettre en mu*
fique. En le défignant fous ce titre, on ne fait qu indiquer
fa deftination. Les différents morceaux qui
compofent un poëme lyrique doivent recevoir du
muficien des formes diverfes ; les uns feront lim-
plement récités, 8c le compofiteur fe contente d’en
noter la déclamation ; les autres , plus paftionnes
8c fufceptibl.es par conféquent dune mélodie
plus régulière , deviendront entre fes mains des.
duo , des trio , des airs, 8c ce mot comprend ccl-
leélivement les paroles 8c la mufiquè. On ! emploie
quelquefois cependant pour la feule mufique
inftrumentale, dans les morceaux où la mélodie
imite les formes périodiques du chant. C ’eft
dans ce fens qu’on dit des airs de violon ; des airs
de daiife , 8c que les Italiens , dans leurs fyinphomes
, iîïtroduifent quelquefois,une aria.
Quant aux formes de ces airs, indiquées par
M. Sultzer dans le précédent article , elles ont
beaucoup varié depuis qu'il-l’a écrit. Les Italiens
fe font enfin laffés de leur éternelle monotonie ; ils
fondent le plus ordinairement la fcconde partie
avec la première , ou s’ils les cliftingtient lorfque
Fexpreffion l’exige, ils ne fe croient plus obliges