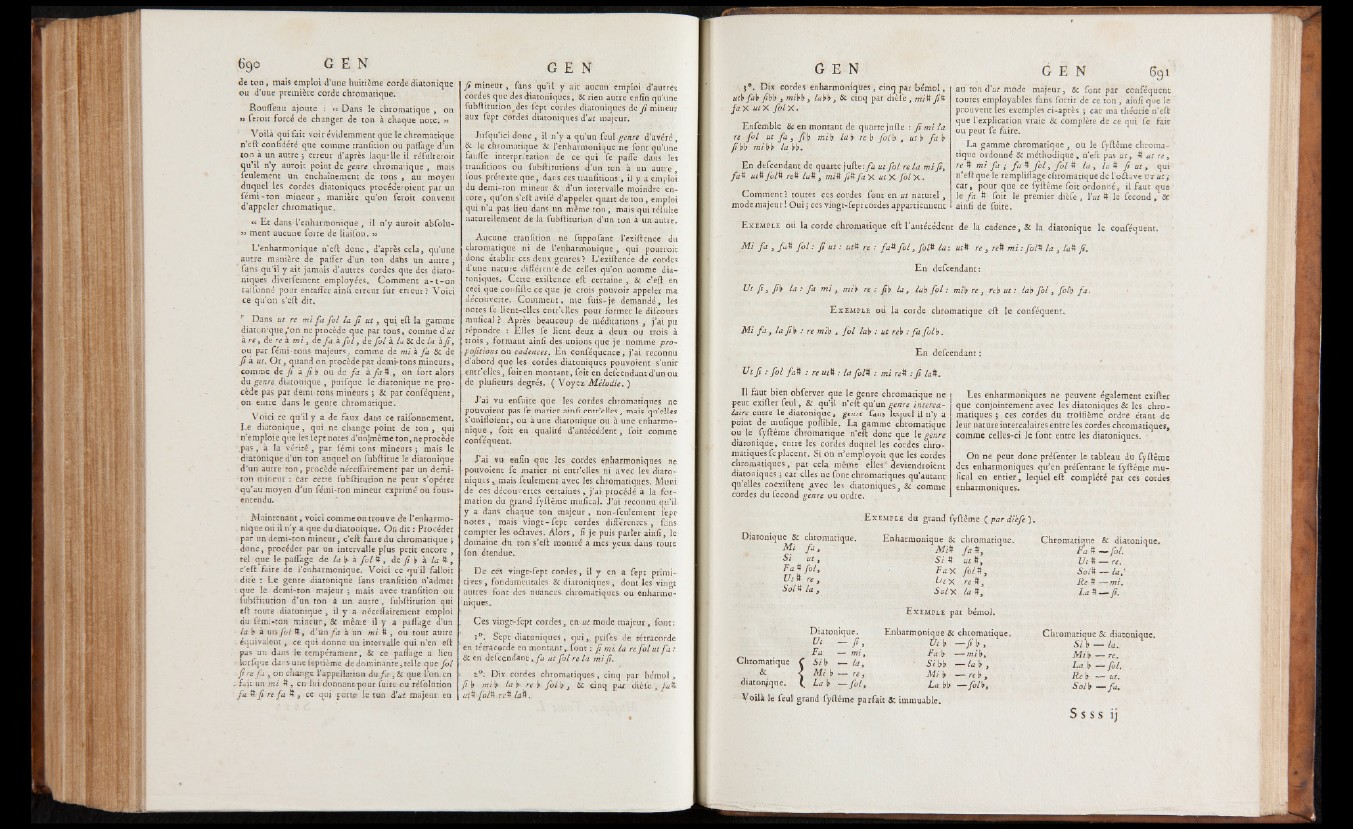
690 G E N
de to n , mais emploi d’une huitième corde diatonique
ou d’une première corde chromatique.
Roufleau ajoute : ce Dans le chromatique , on
» feroit forcé de changer de ton à chaque note. »
V o ilà qui fait voir évidemment que le chromatique
n’eft: confidéré que comme rranficion ou partage d’un
ton à un autre 5 erreur d’après laquelle il réfulteroic
qu’il n’y auroit point de genre chromatique , mais
feulement un enchaînement de tons , au moyen
duquel les cordes diatoniques procéderoient par un
fém i- ton mineur, manière qu’on feroit convenu
d’appeler chromatique.
« E t dans l’enharmonique , il n’y auroit abfolu-
» ment aucune forte de liaifon. »
L’enharmonique n’eft: donc , d’après ce la , qu’une
autre manière de palier d’un ton dahs un au tre,
fans qu’il y ait jamais d’autres cordes que des diatoniques
diverfement employées. Gomment a - t - o n
railonné pour encarter ainfi erreur fur erreur? V o ic i
ce qu’on s’eft dit.
r Dans ut re mi fa fo l la f i u t , qui eft la gamme
diatonique ,*on ne procède que par tons, comme d'ut
kre t de re à mi, de fa à f o l , de fo l à lu & de la kfi,
ou par fémi-tons majeurs , comme de mi à fa & de
f i à ut. O r , quand on procède par demi-tons mineurs,
comme de f i à f i b ou de fa à fa # , on fort alors
du genre diatonique, puifque le diatonique ne procède
pas par demi-tons mineurs 5 & par conféquent,
on entre dans le genre chromatique.
V o ic i ce qu’il y a de faux dans ce raifonnement.
Le diatonique, qui ne change point de ton , qui
n’emploie que les fept notes d’unjmême ton,ne procède
.pas, à la v é r ité , par fémi tons mineurs; mais le
diatonique d’un ton auquel on fubftitue le diatonique
d ’un autre ton , procède néceflairement par un demi-
ton mineur : car cette fubftitution ne peut s’opérer
qu’au moyen d’un fémi-ton mineur exprimé ou fous-
entendu.
Maintenant, voici comme on trouve de l’enharmo-
- nique où il n’y a que du diatonique. On dit : Procéder
par un demi-ton mineur, c’eft faire du chromatique ;
donc, procéder par un intervalle plus petit encore
tel que le partage de la k- à fo l # , de f i k à la fc ,
c’eft: faire de l’enharmonique. V o ici ce qu’il falloit
dire : Le genre diatonique fans transition n’admet
: que le demi-ton majeur ; mais avec tranfition ou
fubftitution d’un ton à un autre , fubftitution qui
eft toute diatonique , il y a néceflairement emploi
du fermâtoa mineur., & même il y a palfage d’un.
■ la V sl un fo l d’un fa à un tni # , ou tout autre
. équivalent, ce qui donne un intervalle qui n’en eft
pas un dans le tempérament , & ce partage a lieu
lorfque dans une fepiième de dominante,telle que fo l
f i re f i t , on change ^appellation Au.fa , & que L’an; en
: fait un mi # , en lui donnant pour fuite ou réfolution
fa # f i re fa # ., ce qui perte le ton Al ut majeur, en
G E N
f i mineur, fans qu’il y air aucun emploi d’autres
cordes que des diatoniques, & rien autre enfin qu’une
fubflitution^des lept cordes diatoniques de f i mineur
aux fept cordes diatoniques A'ut majeur.
Jufqu ici donc , il n’y a qu’un fcul genre d’avéré,
& le chromatique & l’enharmonique ne font qu’une
fauffe interprétation de ce qui fe parte dans les
tranfitions ou fubftitutions d’un ton à un autre
fous prétexte q ue , dans ces tranfitions , il y a emploi
du demi-ton mineur & d’un intervalle moindre encore,
qu’on s’eft avifé d’appeler quart de ton , emploi
qui n’a pas lieu dans un même ton , mais qui rélulte
naturellement de la fubftitution d’un ton à un autre.
Aucune tranfition ne fuppofant l’exiftence du
chromatique ni de ,1’enharmoiiique , qui pourroic
donc établir ces deux genres ? L’exiftence de cordes
d’une nature differente de celles qu’on nomme dia-
roniques. Cette exiftcnce eft: certaine & c’ eft en
ceci que confifte ce que je crois pouvoir appeler ma
découverte. Comment, me fuis -je demandé, les
notes fc lient-elles enir’tlles pour former le difcours
mufical ? Après beaucoup de méditations , j ’ai pu
répondre : Elles fe lient deux à deux ou trois à
trois , formaut ainfi des unions que je nomme pro-
pofitions ou cadences. En conféqucnce, j’ai reconnu
d’abord que les cordes diatoniques pouvoient s’unir
entr’elles, foiten montant, foit en defeendant d’un ou
de plufîeurs degrés. ( V o y e z Mélodie. )
J’ai vu enfuite que les cordes chromatiques ne
pouvoient pas fe marier ainfi entr’elles, mais quelles
s’uniffoient, ou aune diatonique ou à une enharmonique
, foit en qualité d’antécédent, foit comme
conféquent.
J’ai vu enfin que les cordes enharmoniques ne
pouvoient fe marier ni entr’elles ni avec les diatoniques
,.mais feulement avec les chromatiques. Muni
de ces découvertes certaines , j’ai, procédé à la formation
du grand fyftême mufical. J’ai reconnu qu'il
y a d'ans enaque ton majeur, non-feulement fept
notes , mais v in g t- fept cordes différences , fans
compter les o â a ve s . A lors , fi je puis parler ainfi, le
domaine du tou s’eft: montré à mes yeux dans toute
fon étendue..
De ce"5 vingt-fept cordes-, il y en a fept primitives
, fondamentales & diatoniques , dont les vingt
autres font des- nuances chromatiques ou enharmoniques.
Ce s vingt-fept cordes,.en «r mode majeur, font:
r°'. Sept diatoniques, q u i,, prifes de tétracorde
en tétra cordé en montant,,font : fi mu la re fo l ut fa :
&. en defcendânt, f a ut fo l re-la mi fi.
* z°; Dix cordes chromatiques, cinq par bémol ,
f ik miV laV re k. fo lk ,• & cinq par d ièû ,, fa#
ut#fal#.re# la#..
G E N
j* . Dix cordes enharmoniques, cinq par bémol,
utk fakfikk , mfok 3 lakk , & cinq par d ièfe, mi# fi#
fa Y. ut Y. fo l Y..
Enfemble &c en montant de quarte jufte : f i mi la
re fo l ut fa , f i b mik lak rek folk , utk fa k
fikk mikk la M.
En defeendant de quarte jufte: fa ut fo l re la mi fi,
fa# ut# fol# re# la# , mi# fi# fa Y ut Y fo l Y .
Comment? toutes ces cordes font en ut naturel,
mode majeur 1 Oui ; ces vingt-fept cordes appartiennent
E xemple où la corde chromatique eft l’antécéder
Mi fa , fa# fo l : f i ut : ut# re : fa# f o l , fol# la\
G Ë N 691
au ton A'ut mode majeur, & font par conféquent
toutes employables fans fortir de ce ton , ainfi que le
prouvent les exemples ci-après ; car ma théorie n’eft:
que l’explication vraie & complète de ce qui fe fait
ou peut fe faire.
La gammé chromatique , ou le fyftême chromatique
ordonné & méthodique , ri’efl pas Ut , # ut re ,
re # mi fa ; fa # f o l , fo l # la , la# f i u t, qui
n’ eft que le remplirtàge chromatique de l’odave ut ut ;
ca r , pour que ce fyftême foit ordonné, il faut que
le fa # foit le premier dièfe, Vue # le fécon d, Sç
ainfi de fuite.
de la cadence, & la diatonique le conféquent.
ut# re , re# mi : fol# la , la# fi.
E n defeendant:
Ut f i 3 fik la : fa mi , mik re : fik la , lak fo l : mik re , rek ut: lak f o l , folk fa.
E xemple où la corde chromatique eft le conféquent.
Mi fa , la fik : re mik » fo l lak : ut rek : fa folk.
En defeendant ;
Ut f i : fo l fa# : re ut# : la fol# : mi re# : f i la#.
Il faut bien obferver que le genre chromatique ne
peut exifter feu l, & qu’ il n’eft qu’un genre intercalaire
entre le diatonique, genre fans lequel il n’y a
point de mufique poflible. La gamme chromatique
ou le fyftême chromatique n’eft donc que le genre
diatonique, entre les cordes duquel les cordes chromatiques
fe placent. Si on n’ employoit que les cordes
chromatiques, par cela même elles* deviendroient
diatoniques ; car elles ne font chromatiques qu’autanr
qu’elles coexiftent avec lès diatoniques, & comme
cordes du fécond genre ou ordre.
Les enharmoniques ne peuvent également exifter
que conjointement avec les diatoniques & les chromatiques
; ces cordes du troifième ordre étant de
leur nature intercalaires entre les cordes chromatiques,
comme celles-ci le font entre les diatoniques. •
On ne peut donc préfenter le tableau du fyftême
des enharmoniques qu’ en préfentant le fyftême mufical
en entier, lequel eft complété par ces cordes
enharmoniques.
E xemple du grand fyftême (.par diefe").
Diatonique & chromatique.
M i f a ,
Si u t,
Fa # fo l,
Ut# re,
Sol# la ,
Enharmonique & chromatique.
Mi# fa # ,
S i # ut#,
Fa Y fo l# ,
O tY re#,
Sol Y la #,
E xemple par bémol.
Chromatique
&
diatonique.
V o ilà le feul
Diatonique.
Ut — f i y
Fa — mi,
Si k — la,
Mi b — re y
Lak — fo l.
Enharmonique & chromatique.
Ut k — f i k ,
Fa —- mik»
— i a k ,
Mi k — rek ,
La M — folk,
grand fyftême parfait & immuable.
Chromatique & diatonique.
Fa # — fol.
Ut# — re.
Sol# — la.'
Re # — mi.
L a#— fi.
Chromatique & diatonique.
Si b — la.
Mik — re.
La k — fol.
Re k — ut.
Solk — fa.
S s s s ij