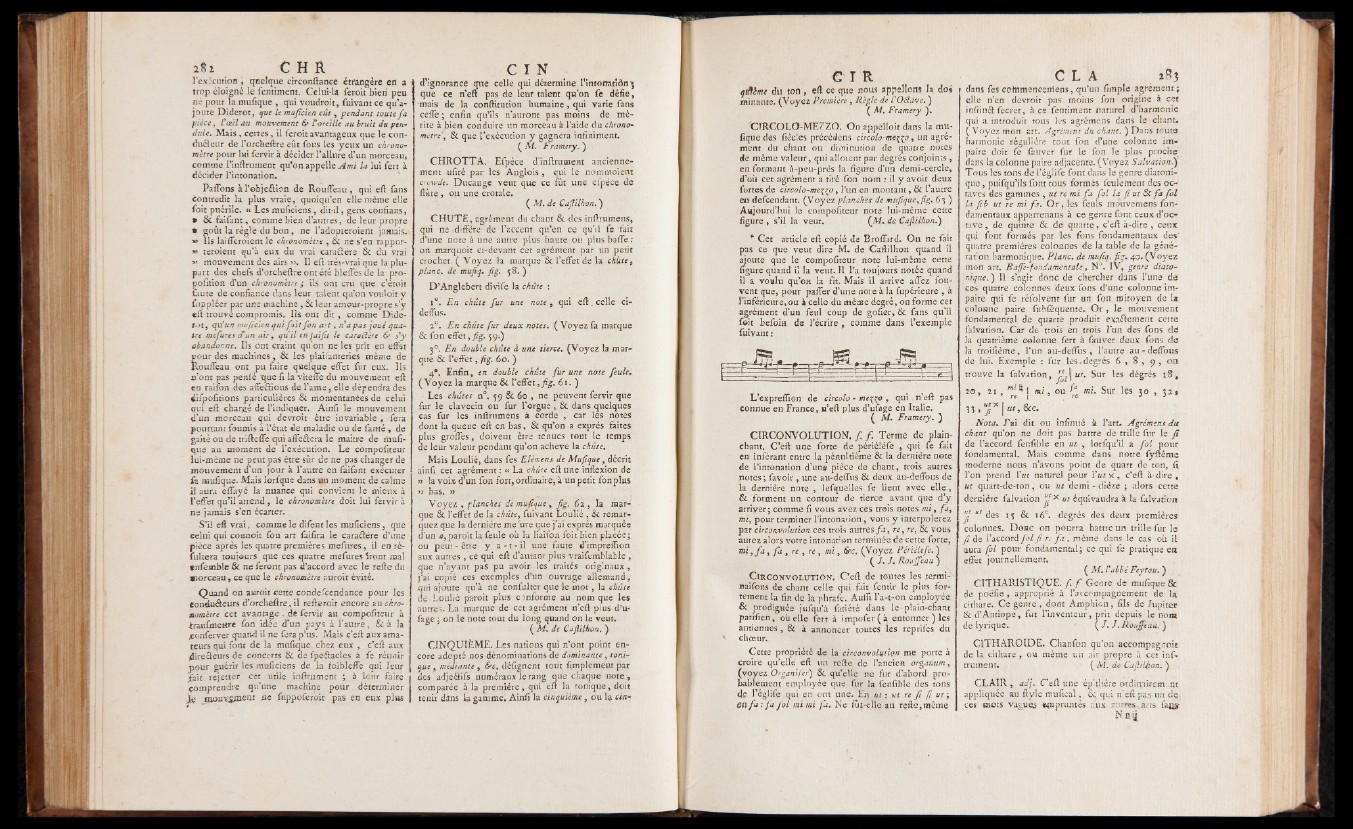
a8i CHR
l'exécution l quelque circonfiance étrangère en a
trop éloigné le fentiment. Celui-la feroit bien peu
né pour la mufique , qui voudroit, fuivant ce qu'ajoute
Diderot, que le muficien eût, pendant toute fa
pièce, l'oeil au mouvement & Tortille au bruit du pendule.
Mais, certes , il feroit avantageux que le conducteur
de l’orcbeflre eût fous les yeux un chronomètre
pour lui fervir à décider l’allure d’un morceau,
comme l’inflrument qu’on appelle A mi la lui fert à
décider l’intonation.
Paffons à l'objeâion de Rouffeau, qui efl fans
contredit la plus vraie, quoiqu’en elle même elle
foit puérile. « Les muficiens, dit-il, gens confians,
* & faifant, comme bien d autres, de leur propre
* goût la règle du bon, ne l’adopteroierit ja«iais.\
» Ils laifferoient le chronomètre , & ne s’en rapports
teroient qu’à eux du vrai caraôère & du vrai
» mouvement des airs ». 11 efl très-vrai que ia plupart
des chefs d’orcheftre ont été bleffés de la pro-
pofition d’un chronomètre ; ils ont cru que c’étoit
faute de confiance dans leur talent qu’on vouloit y
fnppléer par une machine, 8c leur amour-propre s’y
efl trouvé compromis. Ils ont d it , comme Diderot,
qu'un muficien qui fait fon art, n a pas joué quatre
me fur es (Tun air, qu il en jaifit le c ara itère & T y
abandonne. Ils ont craint qu’on ne les prît en effet
pour des machines, & les plaisanteries même de
Rouffeau ont pu faire quelque effet fur eux. Ils
n’ont pas penfé que fi la vîteffe du mouvement efl
en ration des affeftions de Famé, elle dépendra des
difpofitions particulières & niomentanèes de celui
qui efl chargé de l’indîqHer. Ainfi le mouvement
d’un morceau qui devroit être invariable , fera
pourtant fournis à l’état de maladie ou de fanté, de
gaîté ou de trifleffe qui affe&era le maître de mufique
au moment de l’exécution. Le compofiteur
lui-même ne peut pas être sûr de ne pas changer de
mouvement d’un jour à l’autre en faifant exécuter
fa mufique. Mais lorfque dans un moment de calme
il aura effayé la nuance qui convient le mieux à
l ’effet qu’il.artend, le chronomètre doit lui fervir à
ne jamais s’en écarter.
S’il eô vrai, comme le difent les muficiens, que
celui qui coanoît fon art faifira le caraftère d’une
pièce après les quatre premières mefiires, il en ré-
fultera toujours que ces quatre mefures Iront mal
tnfeaible & ne feront pas d’accord avec le refie du
morceau, ce que le chronomètre auroit évité.
Quand on auroit cette condefcendance pour les
«onduleurs d’orcheflre, il refferoit encore au chronomètre
cet avantage -, dé fervir au compofiteur à
-tranfmettre fon idée d'un pays à l ’autre, & à la
jeonferver quand il ne fera p’us. Mais c’efl aux amateurs
qui font de la mufique chez eux , c’efl aux
direâeurs de concerts & de fpe&acles à fe réunir
pour guérir les muficiens de la foibleffe qui leur
fait rejetter cet utile infiniment ; à leur faire i
comprendre qu’une machine pour déterminer I
je mouvement fle fuppoferoit pas en eux plus J
c i N
d’ignorance que celle qui détermine Fintofratîdn $
que ce n’efl pas de leur talent qu’on fe défie,
mais de la conflitution humaine, qui varie fans
ceffe; enfin qu’ils n'auront pas moins de mérite
à bien conduire un morceau à l ’aide du chrono-
métré, & que l’exécution y gagnera infiniment.
( M. Framery. )
CH R O T TA . Efpèce d'infiniment anciennement
ufité par les Anglois, qui le nomtnoient
crowde. Ducange veut que ce fut une efpèce de
flûte, ou une crotale.
f M. de Çaflilhon.')
CHUTE, agrément du chant 8c des inflrumens,
qui ne diffère de l’accent qu’en ce qu’il fe fait
d’une note à une autre plus haute ou plus baffe :
on marquoit ci-devant cet agrément par un petit
crochet. ( Vo yez la marque & l’effet de la chùte 9
plane. de mufiq. fig. 58. )
D ’Anglebert divife la chute :
i°. En chute fur une note, qui efl | celle ci-
deffus.
20. En chute fur deux notes. ( Voyez fa marque
& fon effet, fig. 59.)
30. En double chiite à une tierce. (Voyez la marque
& l’effet, fig. 60. )
4*. Enfin, en double chute fur une note feule,
(V o y e z la marque & l’effet,fig. 61. )
Les chûtes n°, 59 & 60 , ne peuvent fervir que
fur le clavecin ou fur l’o rgue, & dans quelques
cas fur les inflrumens à corde , car les notes
dont la queue efl en bas, & qu’on a exprès faites
plus greffes, doivent être tenues tout le temps
de leur valeur pendant qu’on achevé la chiite.
Mais Loulié, dans fes Elément de Mufique, décrit
ainfi cet agrément : « La chiite efl une inflexion de
n la voix d un fon fort, ordinaire, à un petit fon plus
» bas. n
Voyez , planches de mufique, fig. 6 2 , la marque
& l’effet de la chute, fuivant Louîîé , & remarquez
que la dernière mesure que j’ai exprès marquée
d'un a, paroit la feule où la liaîfon foit bien placée;
ou peut - être y a - 1 - il une faute «Timpreffion
aux autres , ce qui efl d’autant plus vraifemblable ,
que n’ayant pas pu avoir les traités originaux ,
j’ai copié ces exemples d’un ouvrage allemand,
.qui ajoute qu’à ne confulter que le mot, la chute
de Loulié paroît plus c informe au nom que les
autres. La marque de cet agrément n’efl plus d’u-
fage; on le note tout du long quand on le veut.
( M. de Çaflilhon. )
CINQUIÈME. Les nations qui n’ont point encore
adopté nos dénominations de dominante, tonique
, médiante, &c. défignent tout fimplement par
des adjeéiifs numéraux le rang que chaque note,
comparée à la première, qui eft la tonique, doit
tenir dans la gamme. Ainfi la cinquième, ou la ci/te
r ft
qdïème du ton, efl ce que nous appelions la do*
minante. (Voyez Première, Règle de l'OBave. )
( M. Framery ).
d R C O L O -M E 7ZO. On àppelloit dans la mu-
fique des fiècles précédens circolo-me\$o, un agrément
du chant ou diminution de quatre notes
de même valeur, qui alloient par degrés conjoints ,
en formant à-peu-près la figure d’un demi-cercle,
d’où cet agrément a tiré fon nom : il y avoit deux
fortes de circolo-meçro, l’un en montant, 8c l’autre
en defeendant. (Voyez planches de mufiqueyfig. 63 )
Aujourd’hui le compofiteur note lui-môme cette
figure , s’il la veut. (M. de Çaflilhon.)
* Cet article efl copié de Broffard. On ne fait
pas ce que veut dire M. de Çaflilhon quand il
ajoute que le compofiteur note lui-même cette
figure quand il la veut. Il l’a toujours notée quand
il a voulu qu’on la fit. Mais il arrive affez fou-
vent que, pour paffer d’une note à la fupérieure , à
l ’inférieure, ou à celle du même degré, on forme cet
agrément d’un feul coup de gofier, & fans qu’il
foit befoin de l’écrire , comme dans l’exemple
fuivant :
L ’expreflion de circolo - me^o , qui n’efl pas
connue en France, n’efl plus d’ufage en Italie.
( AL Framery. )
CIRCONVOLUTION, f f . Termê de plain-
chant. C ’efl une forte de périélèfe , qui fe fait
en inférant entre la pénultième & la dernière note
de l’intonation d’une pièce de chant, trois autres
notes ; favoir, une au-deffus 8c deux au-deffous de
la dernière note , lefquelles fe lient avec e l le ,
& forment un contour de tierce avant que d’y
arriver ; comme fi vous avez ces trois notes mi, fit,
mi, pour terminer l’intonarion, vous y interpolerez
par circonvolution ces trois autres f a , re, re% 8c vous
aurez alors votre intonation terminée de cette forte,
m i,fa 9 f a » re » r* » mt j &c' (Voyez Périélefe. )
( J. J. Roujfeau )
C ir c o n v o l u t io n . C ’efl de toutes les termi-v
naifons de chant celle qui fait fentir le plus fortement
la fin de la phrafe. Auffi l’a-t-on employée
& prodiguée jufqu’à fatiété dans le • plain-chant
parifien, où elle fert à impofer(à entonner ) les
antiennes, & à annoncer toutes les reprifes du
choeur.
Cette propriété de la circonvolution me porte à
croire qu’elle efl un refie de l’ancien organum,
(voyez Organiser) 8c qu’elle ne fut d'abord probablement
employée que fur la fenfible des tons
dff l’èglife qui en ont une. En ut : ut re f i fi ut ;
e n / a ifa fo l mi mi fa. Ne fûç-eile au rçûe,même
C L A
\ dans fes coinmencenlens, qu’un fimple agrément;
^lle n’en devroit pas moins fon origine à c et
infiinél fecret, à ce fentiment naturel d’harmonie
qui a introduit tous les agrémens dans le chant.
( Voyez mon art. Agrément du chant. ) Dans toute
harmonie régulière tout fon d’une colonne impaire
doit fe fauver fur le fon le plus proche-
dans la colonne paire adjacente. (Voyez Salvation.)
Tous les tons de Fégiife font dans le genre diatonique
, puifqu’ils font tous formés feulement des octaves
des gammes , ut re mi fa fol la fi ut & fa fo l
la f i b ut re mi fa . O r , les feuls mouvemens fondamentaux
appartenans à ce genre font ceux d’octave
, de quinte & de quarte, c’efl à-dire , ceux
qu; font formés par les fons fondamentaux des'
quatre premières colonnes de la table de la génération
harmonique. Plane, de mufiq. fig. 40. (Voyez
mon art. Baffe-fondamentale, N°. IV , genre diatonique.
) 11 s’agit donc de chercher dans l’une de
ces quatre colonnes deux fons d’une colonne impaire
qui fe réfolvent fur un fon mitoyen de la
colonne paire fuhfoquente. Or , le mouvement
fondamental de quarte produit exnèlement cette
falvation. Car de trois en trois l'un des fons de
la quatrième colonne fert à fauver deux fons de
la troifième, l’un au-deffus , l’autrç au-deffous
de lui. Exemple : fur les.degrés 6 , 8 , 9 , on
trouve la falvation, ||É 1 ut. Sur les dégrés 18 ,
20 y 21 , I mi, ou K Jpf Sur les 3e , 32*
33 . ^ X | “ f . & c.
Nota. J’ai dit ou infinué à Fart. Agrément du
chant qu’on ne doit pas battre de trille fur le f i
de l’accord fenfible en ut , lorfqu’il a fo l pour
fondamental. Mais comme dans notre fyflême
moderne nous n’avons point de quart de ton, fi
Fon prend Vut naturel pour Vut x , c’efl à-dire,
ut quart-de-ton, ou ut demi - dièse ; alors cette
dernière falvation équivaudra à la falvation
m ut des iç & t 6e. degrés des deux premières
colonnes. Dose on pourra battre un trille fur le
f i de l’accord fo l f i re fa . même dans le cas où il
aura fol pour fondamental; ce qui fe pratique en
effet journellement,
( M. C abbé Feytou. )
CITHARISTIQUE. f . f Genre de mufique &
de poëfie , approprié à l’accompagnement de la
cithare. Ce genre , dont AmphÎGii, fils de Jupiter
8c d’Antiope, fut l’inventeur, prit depuis le nom
de lyrique. ( /. J .Roujfeau. )
CITHAROIDE. Chanfon qu’on accompagnoit
de la cithare , ou même un air propre à cet inf-
trument. ( M. de Çaflilhon. )
C L A IR , adj. C’ efl une épùhère ordir\skem-4ït
appliquée au flylq mufiçal, 8c qui n efi pas un dç
ce» mots vaguos empruntés "-ux «ruf*es.varts faas-
Nnij;