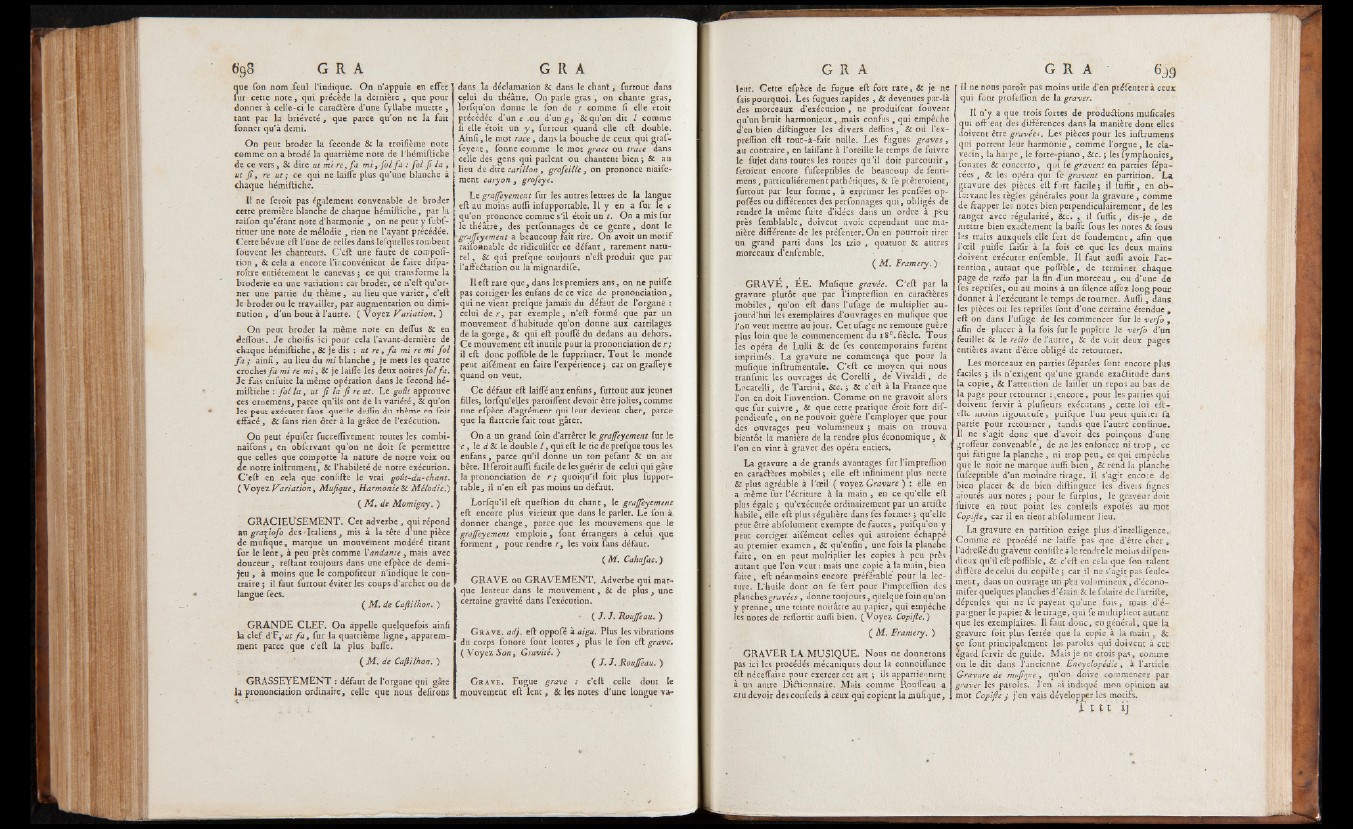
que fon nom feul l’indique. On n’appuie en effet
lur.cette note, qui précède la dernière , que pour
donner à celle-ci le caractère d’une fyllabe muette ,
tant par la brièveté, que parce qu’on ne la fait
fonner qu’à demi.
On peut broder la fécondé & la troifième note
comme on a brodé la quatrième note de l'hémiftiehe
de ce vers, & dire ut mi re,fa mi,-fol fa : fo l fi la ,
ut f i , re ut ; ce qui ne laine plus qu’une blanche à
chaque hémiftiche.
Il ne feroit pas également convenable de broder
cette première blanche de chaque hémiftiche, par la
raifon qu’étant note d’harmonie , on ne peut y fubf-
tituer une note de mélodie , rien ne l ’ayant précédée.
Cette bévue eft l’une de celles dan$ lefquelles tombent
fouvent les chanteurs. C ’eft une faute de compofi-
tion , & cela a encore l’inconvénient de faire difpa-
roître entièrement le canevas 5 ce qui transforme la
broderie en une variation: car broder, ce n’eft qu’orner
une partie du thème, au lieu que varier, c’eft
le broder ou le travailler, par augmentation ou diminution
, d'un bout à l’autre. ( V oyez Variation. )
On peut broder la même note en deffus & en
deffous. Je choifis ici pour cela l’avant-dernière de
chaque hémiftiche, & je dis : ut re, fa mi re mi fo l
f a ; ainfï, au lieu du mi blanche , je mets les quatre
croches yà mi re mi, & je laide les deux noires fo l fa .
Je fais enfuite la même opération dans le fécond hé-
miftiehe : fo l la , ut f i la f i re ut. Le goût approuve
ces ornemens, parce qu’ils ont de la variété, & qu’on
les peut exécuter fans que* le deflin du thème en foit
effacé, & fans rien ôter à la grâce de l’exécution.
On peut épuifer fucceHivernent toutes les combi-
naifons , en obfervant qu’on ne doit fe permettre
que celles que comporte la nature de notre voix ou
de notre infiniment, & l’habileté de notre exécution.
C ’eft en c-ela que confifte le vrai goût-du-chant.
( Voyez Variation, Mufique, Harmonie & Mélodie.')
( M. de Momigny. )
GRACIEUSEMENT. Cet adverbe, qui répond
au grariofo des «Italiens , mis à la tête d’une pièce
de mufique, marque un mouvement modéré tirant
fur le lent, à peu près comme Mandante , mais avec
douceur , reftant toujours dans une efpèce de demi-
jeu , à moins que le compofïteur n’indique le contraire
$ il faut furtout éviter les coups d’archet ou de
langue fecs.
( M. de Cafiilhon. )
GRANDE CLEF. On appelle quelquefois ainfi
la clef d’F,’ ut f a , fur la quatrième ligne, apparemment
parce que c’eft la plus baffe.
( M. de Cafiilhon. )
GRASSEYEMENT : défaut de l’organe qui gâte
la prononciation ordinaire, celle que nous devrons
dans la déclamation & dans le ch an t, furtout dan9
celui du théâtre. On parle gras , on chante gras,
lorfqu’on donne le fon de r comme fi elle étoit
précédée d’un e .ou d’un g , & qu’on dit l comme
fi elle étoit un y , furtout quand elle eft double.
A in fi, le mot race, dans la bouche de ceux qui graf-
feyer.t, fonne comme le mot grâce ou trace dans
celle des gens qui parlent ou chantent bien j & au
lieu de dire carillon , grofeille , on prononce niaife-
ment caryon , grofeye.
Le grajfeyement fur les autres lettres de la langue
eft au moins auffi infupportable. Il y en a fur le c
qu'on prononce comme s’il étoit un t. On a mis fur
le théâtre, des perfonnages de ce genre , dont le
'grajfeyement a beaucoup fait rire. On avoit un motif
raifoanable de ridiculifer ce défaut, rarement naturel
, & qui prefque toujours n’eft produit que par
l’affe&ation ou la mignardife.
Il eft rare que, dans les premiers ans , on ne puiffe
pas corriger* les enfans de ce vice de prononciation ,
qui ne vient prefque jamais du défaut de l’organe :
celui de r , par exemple, n’eft formé que par un
mouvement d’habitude qu’on donne aux cartilages
de la gorg e, & qui eft poufTé du dedans au dehors.
C e mouvement eft inutile pour la prononciation de r;
il eft donc poffible de le fuppriiner. T ou t le monde
peut aifément en faire l’expérience 5 car on graffeyé
quand on veut.
C e défaut eft laifTé aux enfans, furtout aux jeunes
filles, lorfqu’elles paroiffent devoir être jolies, comme
une efpèce d’agrément qui leur devient cher, parce
que la flatterie fait tout gâter.
On a un grand foin d’arrêter le grajfeyement fur le
c , le d & le double l , qui eft le tic de prefque tous les
enfans, parce qu’il donne un ton pefant & un air
bête. Il feroit auffi facile de les guérir de celui qui gâte
la prononciation de r ; quoiqu’ il foit plus fuppor-
table | il n’en eft pas moins un défaut.
Lorfqu’il eft queftion du ch an t, le grajfeyement
eft encore plus vicieux que dans le parler. L e fon à.
donner change, parce que les mouvemens que le
grajfeyement emploie, font étrangers à celui que
forment , pour rendre r , les voix fans défaut.
(M . Cahufac.)
G R A V E ou G R A V EM E N T . Adverbe qui marque
lenteur dans le mouvement, & de plus , une
certaine gravité dans l’exécution.
• ( J. J. Roujfeau. )
G r a v e , adj. eft oppofé à aigu. Plus les vibration»
du corps fonore font lentes, plus le fon eft grave.
( V o y e z Son, Gravité. )
( J. J. Roujfeau. )
G r a y e , Fugue grave : c’eft celle dont le
mouvement eft len t , & les notes d'une longue valeur.
Cette efpèce de fugue ëft fort rare, & je ne
fais pourquoi. Les fugues rapides , & devenues par-là
des morceaux d’exécution, ne produifent fouvent
qu’un bruit harmonieux, jnais confus, qui empêche
d’en bien diftinguer les divers deffins, & où l’ex-
preffion eft tout-à-fait nulle. Ees fugues graves ,
au contraire, en laiffant à l’oreille le temps de fuivre
le fujet dans toutes les routes qu’il doit parcourir,
feroient encore fufceptiblës de beaucoup de fenti-
mens, particuliérement pathétiques, & fe prêteraient,
furtout par leur forme, à exprimer les penféès op-
pofées ou différentes des perfonnages qui, obligés de
rendre la même fuite d’idées dans un ordre à peu
près femblable, doivent avoir cependant une manière
différente de les préfenter. On en pourroic tirer
un grand parti dans les trio , quatuor & autres
morceaux d’enfcmble.
( M. Framery. )
GRA.VÉ , EE. Mufique gravée. C ’eft par la
gravure plutôt que par l’impreffion en caraâères
mobiles, qu’on eft dans l’ufage de multiplier aujourd’hui
les exemplaires d’ouvrages en mufique que
l’on veut mettre au jour. Cet ufage ne remonte guère
plus loin que le commencement du i8 e.fiècle. Tous
les opéra de Luili & de fes contemporains furent
imprimés. La gravure ne commença que pour la
mufique inftrumentale. C ’eft ce moyen qui nous
tranfmit les ouvrages de Corelli, de Vivaldi, de
Locatelli, de Tartini, &c. 5 Sc c’eft à la France que
fon en doit l’invention. Comme on ne gravoit alors
que fur cuivre , & que cette pratique étoit fort dif-
pendieufe, on nepouvoit guère l’employer que pour
des ouvrages peu volumineux j mais on trouva
bientôt la manière de la rendre plus économique , &
l’on en vint à graver des opéra entiers.
La gravure a de grands avantages fur l’impreffion
en caractères mobiles} elle eft infiniment plus nette
& plus agréable à l ’oeil ( voyez Gravure ) : elle en
a même fur l’ écriture à la main , en ce qu’elle eft
plus égale j qu’exécutée ordinairement par un artifte
habile, elle eft plus régulière dans fes formes 5 qu’elle
peut être abfolument exempte de fautes, puifqu’oti y
peut corriger aifément celles qui auroient échappé
au premier examen , & qu’enfîn, une fois la planche
faite, on en peut multiplier les copies à peu près
autant que l’on veut : mais une copie à la main, bien
faite, eft néanmoins encore préférable pour la lecture.
L’huile dont on fe fert pour l'impreffion des
planches gravées, donne toujours, quelque foin qu’on
y prenne, une teinte noirâtre au papier, qui empêche
les notes de reffortir auffi bien. (Voyez Copifie.)
( M. Framery. )
GRAVER LA MUSIQUE. Nous ne donnerons
pas ici les procédés mécaniques dont la connoiffance
eft néceffaire pour exercer cet art ; ils appartiennent
a un autre Dictionnaire. Mais comme Rouffeau a
cru devoir des confeils à ceux qui copient la mufique,
il ne nous paroît pas moins utile d’en préfenter à ceux
qui font profeffion de la graver.
II n’y a que trois fortes de productions muficales
qui off ent des différences dans la manière donc elles
doivent être gravées. Les pièces pour les inftrumens
qui portent leur harmonie, comme l ’orgue, le clavecin
, la harpe, le forte-piano, &c. ; les lymphonies,
fon ates & concerto, qui fe gravent en parties fépa-
rées, & les opéra qui fe gravent en partition. La
gravure des pièces eft fort facile} il fuffit, en ob-
forvanc les règles générales pour la gravure, comme
de. frapper les notes bien perpendiculairement, de les
ranger avec régularité, &c. , il fuffit, dis-je , de
mettre bien exactement la baffe fous les notes & fous
les traits auxquels elle fert de fondement , afin que
l’oeil puiffe faifir à la fois ce que les deux mains
doivent exécuter enfemble. Il faut auffi avoir l’attention,
autant que poffible, de terminer chaque
page de reSto par la fin d’un morceau, ou d’une de
fes reprifes, ou au moins à un filence affez long pour
donner à l’exécutant le temps de tourner. Auffi , dans
les pièces où les reprifes font d’une certaine étendue ,
eft on dans l ’ufage de les commencer fur le verfo ,
afin de placer à la fois fur le pupitre le verfo d’un
feuillet & le reëto de l’autre, & de voir deux pages
entières avant d’être obligé de retourner.
Les morceaux en parties féparées font encore plus
faciles } ils n’exigent qu’une grande exaftitude dans
la copie, & l’attention de laiffer un repos au bas de
la page pour retourner : ^encore, pour les parties qui
doivent fervir à plufieurs exécutans , cette loi eft-
ellc moins rigoureufe, puifque l'un peut quitter fa
partie pour retourner , tandis que l’autre continue.
Il ne s’agit donc que d’avoir des poinçons d’unç
groffeur convenable, de ne les enfoncer ni trop, ce
qui fatigue la planche , ni trop peu, ce qui empêche
que le npir ne marque auffi bien, & rend la planche
fufceptible d’un moindre tirage. Il s’agit encore de
bien placer & de bien diftinguer les diveis lignes
ajoures aux notes} pour le furplus, le graveur doit
fuivre en tout point les confeils expofés au mot
Copifie, car il en tient abfolument lieu.
La gravure en partition exige plus d’intelligence.
Comme ce procédé ne- laiffe pas que d’être cher ,
l’adreffé du graveur confifte à le rendre le moius difpen-
dieux qu’il eft poffible, & c’eft en ceLa que fon talent
diffère de celui du copi lie j car il ne s’agit pas feulement,
dans un ouvrage un p‘eu volumineux, d’écono-
mifer quelques planches d'étain & le falaire de l’artifte,
dépenfes qui ne fe payent qu’une fois, mais d’épargner
le papier & le tirage, qui fe multiplient autant
que les exemplaires. Il faut donc, en général, que la
gravure foit plus ferrée que la copie à la main, &
ce font principalement les paroles qui doivent à cet
égard fervir de guide. Mais je ne crois pas, comme
on le dit dans l’ancienne Encyclopédie, à l’article
Gravure de mufique, qu’on doive commencer par
graver les paroles. J'en ai indiqué mon opinion aiÿ
mot Copifie y j’en vais développer les motifs,
T 1 1 1 ij