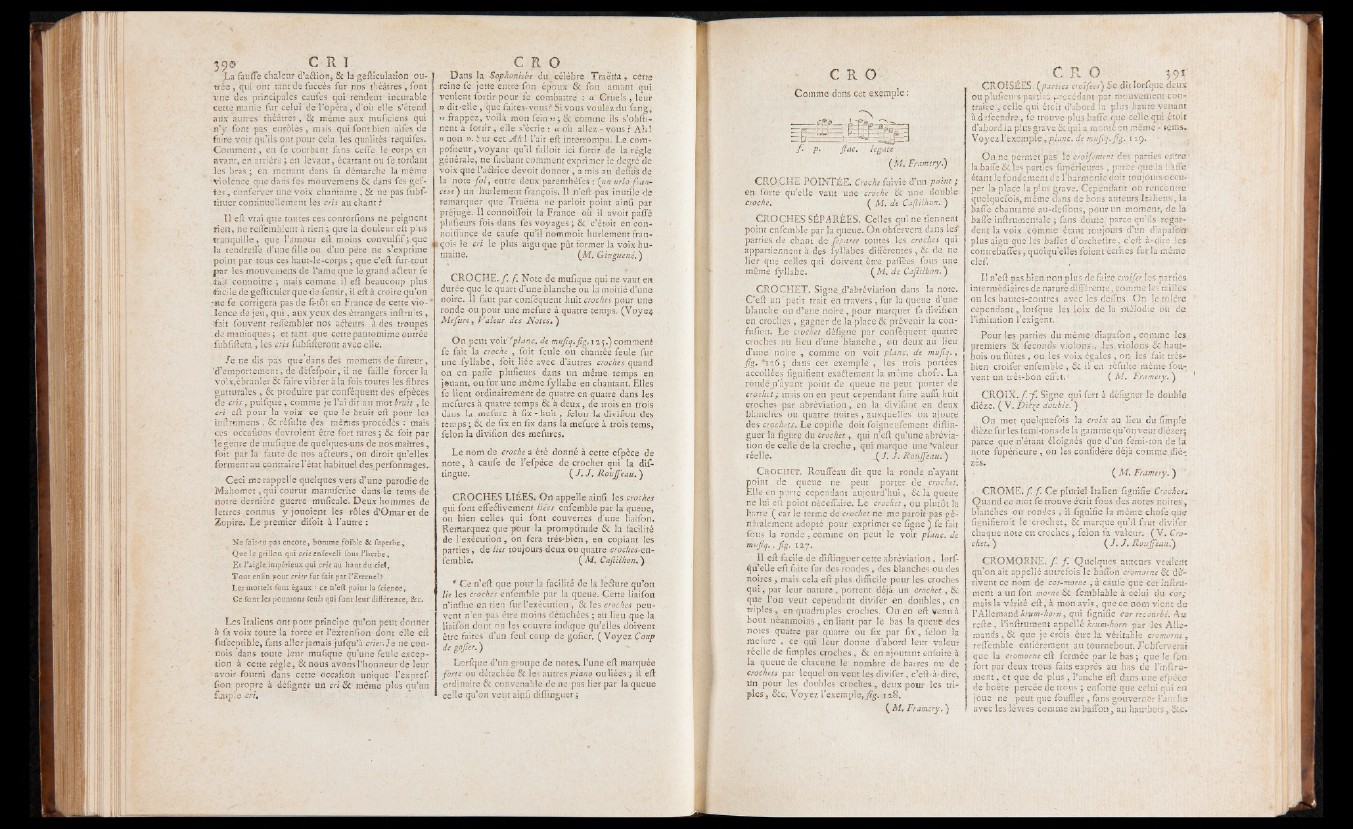
3 9® C R I
La fauffe chaleur d’aftion, & la gefticulatîon outrée
, qui ont tant de fuccès fur nos théâtres , font
une des principales califes qui rendent incurable
cette manie fur celui dé l’opéra, d’où elle s’étend
aux autres théâtres, 8ç même aux muficiens qui
n’y font pas enrôlés , mais qui font bien aifes de
faire voir qu’ils ont pour cela les qualités requifes.
Comment, en fe courbant fans ceffe le corps en
avant, en arrière ; en levant, écartant ou fe tordant
les bras ; en mettant dans fa démarche la même
violence que dans fes mouvemens & dans fes gef-
tes , conferyer une voix chantante , 8c ne pas fubf-
îituer continuellement les cris au chant ?
Il eft vrai que toutes ces conrorfions ne peignent
rien, ne reflcmbient à rien ; que la douleur eft plus
tranquille, que l’amour eft moins convulfif; que
la tendrefle d’une fille ou d’un père ne s’exprime'
point par tous ces haut-le-corps ; que c’eft fur-tout
par les mouvemens de l’ame que le grand a&eur fe
. fait connoître ; mais comme il eft beaucoup plus
'facile de gefticuler que de femir, il eft à croire qu’on
'■ ne fe corrigera pas de fi-tôt en France de cette vio-*
lence de jeu, q u i, aux yeux des étrangers inftrults ,
fait fouvent reftembler nos aéleurs à des troupes
:de maniaques; et tant que cette pantomime outrée
fubfiftera , les cris fubfifteront avec elle.
Je ne dis pas que dans des momens de fureur,
'd’emportement, de défefpoir, il ne faille forcer la
Voix,ébranler & faire vibrer à la fois toutes les fibres
gutturales , 8c produire par conféquent des êfpèces
de cris, puifque , comme je l’ai dit au mot bruit, le
cri eft pour la voix ce que le bruit eft pour les
inftrumens > 8c réfulte des mêmes procédés : mais
ces occafiôns devroient être fort rares ; 8c foit par
le genre de mufique de quelques-uns de nos maîtres,
foit par la faute de nos a fleurs, on diroit qu’elles
. forment au contraire l’état habituel des^perfonnages..
Ceci me rappelle quelques vers d’une parodie de
Mahomet, qui courut manufcrite dans le tems de
notre dernière guerre muficalê. Deux hommes de
lettres connus y jouoient lès rôles d’Omar et de
Zopire. Le premier difoit à l’autre :
Ne fais-tu pas encore, homme foible & fuperbe ÿ
Que le grillon qui crie enfeveli fous l’herbe,
Et l’aigle impérieux qui crie au haut du cieï,
Tout enfin pour crier fut fait par l’Ecèrnel ?
Les mortels font égaux : ce n’eft point la fcienoe,"
Ce font les poumons féuls qui font leur différence, &c.
Les Italiens ont pour principe qu’on peut donner
à fa voix toute la force et l ’extenfion dont elle eft
fufceptible, fans aller jamais jufqu’à crier. Je ne con-
' nois dans toute leur mufique qu’une feule exception
à cette règle, 8c nous avons l ’honneur de leur
avoir fourni dans cette occafion unique- l’expref-
fion propre à défigner un cri 8c même plus qu’un
lùppla cri.
c R o
Dans la Sopkonisbe du célèbre Traëtta, cette
reine fe jette entre fon époux 8c fon amant qui
veulent fortir pour fe combattre : « Cruels , leur
» dit-elle ,-que faites-vous? Si vous voulez du fang,
>3 frappez, voilà mon fein»; 8c comme ils s’obfti-
nent à fortir , elle s’écrie : « où allez - vous ? Ah!
» non ». Sur cet î l’air eft interrompu. Le composteur,
voyant qu’il falloit ici fortir de la règle
générale, ne fachant comment exprimer le degré de
voix que l’aârice devoit donner , a mis au defitîs de
la note fo l, entre deux parenthèfes : (un urlo fmrv
cese ) un hurlement françois. Il n’eft pas inutile de
remarquer que Traëtta ne parloit point ainfi par
préjugé. Il connoifloit là France bu il avoit pafle
plufieurs fois dans fes voyages ; 8c c’étoit en con-
noiiTance de caufe qu’il nommoit hurlement fran-
»çois le cri le plus aigu que pût former la voix humaine.
(JA. Ginguené.)
C RO CH E ./ , f. Note de mufique qui ne vaut en
durée que le quart d’une blanche ou la moitié d’une
noire. Il faut par conséquent huit croches pour un©
roqde ou pour une mefure à quatre temps, (Yoye?
Me fure, Valeur des Notes. )
On peut voir’(plane, de mufiq. fig. 125.) comment
fe fait la croche , foit feule ou chantée feule fur
une .fyllabe, foit liée avec d’autres croches quand
on en pafle plufieurs dans un même- temps en
jouant, ou fur une même fyllabe en chantant. Elles
fe lient ordinairement de quatre en quatre dans les
mefures à quatre temps 8c à deux, de trois en trois
dans la mefure à fix - huit, félon la divifion des
temps ; 8c de fix en fix dans la mefure à trois tems,
félon la divifion des mefures.
Le nom de croche a été donné à cette efpèce de
note, à caufe de l’efpèce de crochet qui la distingue.
( / . J. Roujfeau.)
CROCHES LIÉES. O11 appelle ainfi les croches
qui font effeéHvemenr liées enfemble par la queue,
ou bien celles qui font couvertes d’une liaifon.
Remarquez que pour la promptitude 8c la facilité
de l ’exécution, on fera très-bien, en copiant les
parties, de lier toujours deux ou quatre croches-en-
femble. ( M. Cafiilhon., )
* C e n’eft que pour la facilité de la leéîure qu’on
’ lie les croches enfemble par la queue.-Cétte liaifon
n’influe en rien fur l’exécution , 8c les croches peuvent
n’en pas être moins détachées ; au lieu que la
liaifon dont on les couvre indique qu’elles doivent
être faites' d’un feul coup’ de gofier. (V o y e z Coup
de gofier. )
Lorfque d’un groupe de notes, l’une eft marquée
forte ou détachée 6c les autres piano ou liées7 il eft
ordinaire 8c convenable de ne pas lier par la queue
celle qu’on veut ainfi diftinguer j
c R o
Comme dans cet exemple :
d g g j g i
§g— pr®-
ƒ p* fine, le gâte
(M. Framcry.)
CRO CHE POINTÉE. Croche fuivié d’un point ;
en forte qu’elle vaut une croche 8c une double
croche. ( M. de Cafiilhon. )
CROCHES SÉPARÉES. Celles qui ne tiennent
point enfemble par la queue. On obfervera dans les'
parties de chant de fépdrer toutes les croches qui
appartiennent à des fyllabes différentes , 8c de ne
lier que celles qui doivent être, paffées fous une
même fyllabe. (M . de Cafiilhon. )
CROCHET. SignejTabréviation dans la note.
C ’eft un''pet-t trait en travers , fur la queue d’une
blanche ou d’une noire , pour marquer’ fa divifion
en croches , gagner de la place 8c prévenir la coii-
fufion. Le crochet défigne par conféquent quatre,
croches au lieu d’une blanche, ou deux au lieu
d’une, noire , comme on voit plane, de mufiq. ,
fig. *12.6 ; dans c-et exemple , les trois portées
accollées fignifient exàélement la même chofe. La
rondêji’âyànt point de queue ne peut porter de
crochet ; mais on en peut cependant faire aufîi huit
croches par abréviation, en la divifant en deux
blanches ou quatre noires, auxquelles on ajoute
des crochets. Le copifte doit foigneufement diftin-
guer la figure.du crochet, qui n’eft qu’une abréviation
de celle de la croche, qui marque une ’valeur
réellè. ^ _(7. 7. Roitjfeau
C r o c h e t . Roufféau dit que la ronde n’ayant
point de queue ne peut porter de crochet.
Elle en porte cependant aujourd’hui, 8c la queue
ne lui eft point né ce flaire. Le crochet, ou plutôt la
barre ( car le terme de crochet ne me paroîr pas généralement
adopté pour exprimer ce ligne ) fe fait
fous la ronde, comme on peut le voir plane, de
mufiq. , fig. 127.
Il eft facile de diftinguer cette abréviation , lorf-
qù’efte eft faite fur des rondes, des blanches ou des
noires , mais cela eft plus difficile pour les croches
qui,-par leur nature, portent déjà un crochet, ,8c
que l’on veut cependant divifer en doubles, en
triples , en quadruples croches. On en eft venu à
bout néanmoins , en liant par le bas la queue des
notes quatre par quatre ou fix par fix , félon la
mefure , ce qui leur donne d’abord leur valeur
réelle de Amples croches , -8c en ajoutant enfuite à
la queue de chacune le nombre de barres ou de
crochets par lequel on veut les divifer , c’eft-à-dire,
ttn pour les doubles croches, deux pour les triples,
8cc, Voyez l’exemple, fig. 128.
( M, Framsry, )
C R O 391
CROISÉES, {parties croifêes) Se dit lorfque deux
ou plufieurs parties procédant par mouvement con- '
traire , celle qui étoit d’abord la pi us haute venant
à d îfcendre, fe trouve plus balle.que celle qui étoit
d’abord la plus grave 8c qui a monté en même - tems.
Voyez l’exemple, plane, de mufiq. fig. 129. ■
On ne permet pas le croifiement des parties entre
la baffe & les parties fupérieures , parce que la baffe
étant le fondement de l’harmcniedoit toujours occuper
la place la plus grave. Cependant oh rencontre
quelquefois, même dans de bons auteurs Italiens, la
baffe chantante aii-deftotis, pour un moment, de la
baffe inftrumentale ; fans doute parce qu’ils regardent
la voix comme étant toujours d’un diapafon
plus $igu que lés baffes d’orcheftre, c’eft à-dire.les
contrebaffes, quoiqu’elles foient écrites fur la même
clef. . .
Il n’eft pas bien non plus de faire croifer le^ parties
intermédiaires de nature différence, comme lès taillés
ou les hautes-contres avec les deffus. On le tolère
cependant, lorfque lés loix dç, la mélodie où de
l’imitation l’exigent.
Pour les parties du même diapafon , comme les
premiers 8c féconds violons,, Iss. violons & hautbois
ou flûtes , OU: les voix égales , oii les fait très-
bien croifer enfemble 8c il en réfulte même fou-
vent un très-bon effet.1 ( M. Framety. )
C R O IX ./ -/. Signe qui fert à défigner le double
dièze. ( V. Diè^e double. ) .
On met quelquefois la croix au lieu du fimpîè
dièze fur les {emi-tonsde la gamme qu’on veut diézerj
parce que n’étant éloignés que d’un femi-ton de la
note fupérieure , on les confidère déjà comme dié-
zés.
t ( M. Frdtnery. )
C R OM E ./ f. Ce pluriel Italien lignifie Croches»
Quand ce mot fe trouve écrit fous des notes noires ,
blanches ou rondes , il fignifie la même chofe que
fignifieroit lé crochet, 8c marque qu’il faut divifer
chaque note en croches, félon fa valeur. ( V . Crochet.')
( J. J. Roujfeau.)
CROMORNE. / / Quelques auteurs veulent
qu’on ait appellé autrefois le bâflbiicromorne 8c décrivent
ce nom de cor-morne , à caufe que cet infiniment
a un fon morne 8c femblable à celui du cor;
mais la vérité eft, à mon avis, que ce nom vient de
l’Allemand krum-horn , qui fignifie cor recourbé. Au
r.efte , l’inftrument appellé knim-horn par les Allemands
, 8c que je crois être la véritable cromorne ,
reffemble entièrement au tournefiouf. J’cbferverat
que la cromorne eft fermée par le bas ; que le fon
fort par deux trous faits exprès au bas de Finfirurinent
, et que de plus , l’anche eft dans une efpèce
de boëte percée de trous ; enforte que celui qui en
joue ne peut que fouffler, fans 'gouverner l’anche
avec les lèvres comme aubaflon, au haurbois, 8ce>