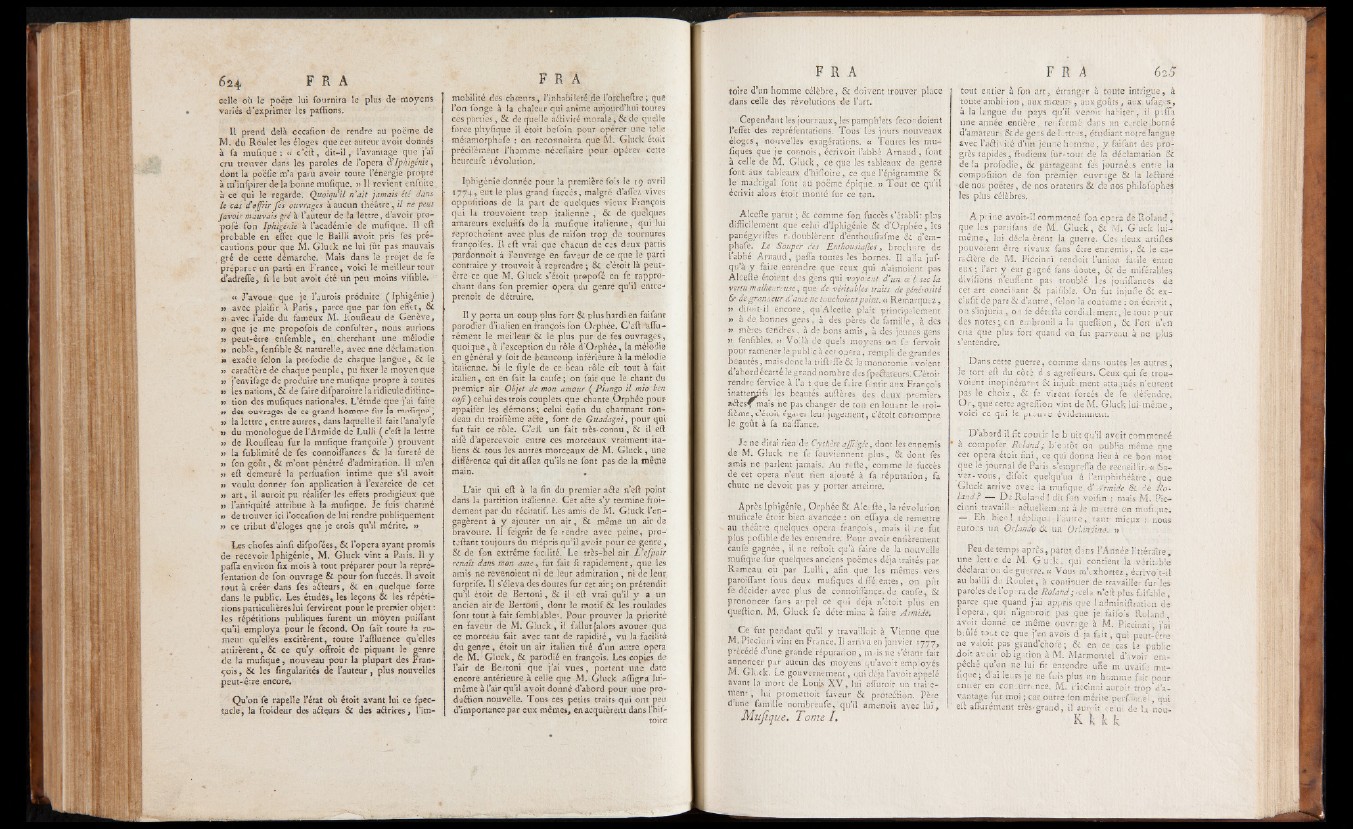
624 F R A
celle oîi le poëte lui fournira le plus de moyens
variés d’exprimer les pallions.
11 prend delà cccafion de rendre au poëme de
JVÎ. du Rôulet les éloges que cet auteur avoir donnés
à fa mufique : « c’eft, dit—i l , l’avantage que j ai
cru trouver dans les paroles de Topera a Iphigénie,
dont la poëfie m’a paru avoir toute l’énergie propre
à m’infpirer de la bonne mufique. » Il revient enfûite
a ce qui le regarde. Quoiqu'il n ait jamais été dans
le cas d’offrir fes ouvrages à aucun théâtre, i l ne peut
favoir mauvais gré à l’auteur de la lettre, d’avoir pro-
pofé fon Iphigénie à l’académie de mufique. Il eft
probable en effet que le Bailli avoit pris fes précautions
pour que M. Gluck ne lui fût pas mauvais
gré de cette démarche; Mais dans le projet de fe
préparer un parti en France, voici le meilleur tour
d’adreffe, fi le but avoit été un peu moins vifible. '
« J’avoue que je l’aurais produite (Iphigénie)
j> avec plaifir à Paris, parce que par fon effet, ôc
» avec l’aide du fameux M. Fouffeau de Genève,
» que je me propofois de confulter, nous aurions
}j peut-être enfemble, en cherchant une mélodie
» noble, fenfible & naturelle, avec une déclamation
m exaéte félon la profodie de chaque langue, & le
» cara&ère de chaque peuple, pu fixer le moyen que
n j’envifage de produire une mufique propre à toutes
» les nations, & de faire difparoître la ridicule diftinc-
n tion des mufiques nationales. L’étude que j’ai faite
» des ouvrages de ce grand homme fur la mufique j
n la lettre, entre autres, dans laquelle il fait Tanalyfe
» du monologue de TA rmide de Lulli ( c’eft la lettre
j> de Rouffeau fur la mufique françoife) prouvent
la fublimité de fes tonnoiflances & la fureté dé
« fon goût, & m’ont pénétré d’admiration. Il m’en
v eft demeuré la perfuafion intime que s’il avoit
n voulu donner fon application à l’exercice de cet
» art, il auroit pu réalifer les effets prodigieux que
n l’antiquité attribue à la mufique. Je fuis charmé
» de trouver ici Toccafion de lui rendre publiquement
» ce tribut d’éloges que je crois qu’il mérite. »
Les chofes ainfi difpofées, & Topera ayant promis
de recevoir Iphigénie, M. Gluck vint à Pai is. Il y
paffa environ fix mois à tout préparer pour la représentation
de fon- ouvrage & pour fon fuccès. Il avoit
tout à créer dans fes aéleurs, & en quelque forte
dans le public. Les études, les leçons & les répétitions
particulières lui fervirent pour le premier objet :
les répétitions publiques furent un moyen puiffant
qu’il employa pour le fécond. On fait toute la rumeur
qu’elles excitèrent, toute l’affluence qu’elles
attirèrent, & ce qu’y offrait de piquant le genre
de la mufique, nouveau pour la plupart des François
, & les fingularités de l’auteur, plus nouvelles
peut-être encore.
Qu’on fe râpe lie l’état ou étoit avant lui ce fpec-
tacle, la froideur des aéleurs & des a&rices, Tim-
F R A
mobilité des choeurs, l’inhabileté de Torcheffre; que
Ton fonge à la chaleur qui anime aujourd’hui toutes
ces parties , & de quelle aélivité morale, & de quelle
force phyfique il étoit befoin pour opérer une telle
métamorphofe : on reconnoîtra que M. Gluck étoit
précifément l’homme- néeefïaire pour opérer cejte
heureufe î évolution.
Iphigénie donnée pour la première fois le 19 avril
1774, eut le plus grand fuccès, malgré dallez vives
oppefitions de la part de quelques vieux François
qui la trouvoient trop italienne , & de quelques
amateurs exclusifs de la mufique italienne, qui lui
reprochoient avec plus de raifon trop de tournures
françoifes. Il eft vrai que chacun de ces deux partis
pardonnoit à l’ouvrage en faveur de ce que le parti
contraire y trouvoit à reprendre ; & c’étoit là peut-
être ce que M, Gluck s’étoit propofé en fe rapprochant
dans fon premier opéra du genre qu’il entre-*
prenoit de détruire.
Il y porta un coup plus fort & plus hardi en faifant
parodier d’iiaiien en françois fon Orphée. C ’eft "affu-
rément le mei!leur & le plus pur de fes ouvrages,
quoique, à i’exception du rôle d'Orphée, la mélodie
en général y foit de beaucoup inférieure à la mélodie
italienne. Si le ftyle de ce beau rôle eft tout à fait
italien, on en fait la caufe; on fait que le chant du
premier air Objet de mon amour f P tango il mio ben
cojîj celui des trois couplets que chante .Orphée pour-
appaifer les démons; celui enfin du charmant rondeau
du troifième aéte, font de Guadagni, pour qui
fut fait ce rôle. C ’eft un fait très-connu, & il eft
aifé d’apercevoir entre ces morceaux vraiment italiens
& tous les autres morceaux dé M. Gluck, une
différence qui dit allez qu’ils ne font pas de la mêçne
main. •
L’air qui eft à la fin du premier a&e n’eft point
dans la partition italienne. Cet aéle s’y termine froidement
par du récitatif. Les amis de M. Gluck l’engagèrent
à y ajouter un air, & même un air de
bravoure. Il feignit de fe rendre avec peine, pro-
teftant toujours du mépris qu’il avoir pour ce genre,
& de fon extrême facilité. Le très-bel air L ’efpoir
renaît dans thon a rn e , fut fait fi rapidement, que les
amis ne revenoient ni de leur admiration, ni de leur
furprife. Il s’éleva des doutes fur cet air; on prétendit
qu’il étoit de Bertoni, & il eft vrai qu’il y a un
ancien air de Bertoni, dont le motif & les roulades
font tout à fait femMable*. Pour prouver la priorité
en faveur de M. Gluck, il fallut [alors avouer que
ce morceau fait avec tant de rapidité , vu la facilité
du genre, étoit un air italien tiré d’un autre opéra
de M. Gluck, & parodié en françois. Les copies de
l’air de Bertoni que j’ai vues, portent une date
encore antérieure à celie que M. Gluck afligra lui-
même à l’air qu’il avoit donné d’abord pour une production
nouvelle. Tous ces petits traits qui ont peu
d’importance par eux mêmes, en acquièrent dans l’hiftoire
toire d’un homme célèbre, & doivent trouver place
dans celle des révolutions-de l’art.
Cependant les journaux, les pamphlets fècondoient
l’effet des repréfentations. Tous les jours nouveaux
éloges, nouvelles exagérations. « Toutes lés mufiques
que je connois, écrivoit l’abbé Arnaud, font
à celle de M. Glück, ce que les tableaux de genre
font aux tableaux d’hifioire, ce que Tépigramme &
le madrigal font au poëme épique. » Tout ce qu’il
écrivit alors étoit monté fur ce ton.
Alcefte parut ; & comme fon fuccès s’établit plus
difficilement que celui d’Iphigénie & d’Orphée, les
panégyriftes redoublèrent d’enthoufiafme ôc d’em-
phafe. Le Souper des Enthousiafles, brochure de
l’abbé Arnaud, paffa toutes les bornes. Il alla juf-
qu’à y faire entendre que ceux qui n’aimoierit pas
Alcefte étoient dos gens qui voyoient d’un. oe'I sec la
vertu malheureuse , que de véritables traits de générosité
& de grandeur d’âme ne touchoient point, u Remarquez,
» difoit-il encore, qu’Alcefle plaît principalement
« à de bonnes gens, à des pères de famille, à des
» mères fend res, à de bons amis, à des jeunes gens .
» fenfibles. »> Voilà de quels moyens on fe ferVok
pour ramener le public à ceropcra, rempli de grandes
beautés, mais dont la trifte-ffe & la monotonie «voient
d’abord écarté le grand nombre des fpe&ateurs. C ’étoit
rendre fervice à l’a t que de faire fentir aux François
inattemifs les beautés auftè.res des deux premiers
a&esvmais ne pas changer de ton en louant le troifième,
céroit égarer leur jugement, c’étoit corrompre
le goût à fa naiffance.
Je ne dirai rien de Cythere affligée, dont les ennemis
de M. Gluck ne fe'fouviennent plus, & dont fes
amis nç parlent jamais. Au refte, comme le fuccès
de cet opéra n’eut rien ajouté à fa réputation, fa
çhute ne devoir pas y porter atteinte.
Après Iphigéni'e, Orphée & Alc.-.fte, la révolution
muficale étoit bien avancée : on eflaya de remettre
au théâtre quelques opéra françois, mais il ne fut
plus poffible de les entendre. Pour avoir entièrement
caufe gagnée, il ne reftoit qu’à faire de la nouvelle
mufique fur quelques anciens poëmes déjà traités par
Rameau ou par Lulli, afin que les mêmes-vers
paroiffant fous deux mufiques dffé;entes, on pût
fe décider avec plus de connoiffance.de caufe, &
prononcer fans appel ce qui déjà n’étoit plus en
queftion. M. Gluck fe détermina à faire Arnidé,
Ce fut pendant qu’il y travaillent à Vienne que
M. Piccinni vint en France. Il arriva en janvier 1777,
précédé d’une grande réputation, mus ne s’étant fait
annoncer par aucun des moyens qu’a volt employés
M. Gluck. Le gouvernement, qui déjà l’avoitappelé
avant la mort de Louis X V , lui affuroit un trare-
menr , lui promettoit faveur & protection. Père
d’une famille nombreufe, qu’il amenoit avec lui,
Mufique, Tomel.
tout entier à fon art, étranger à toute intrigue, à
toute ambiion , aux moeurs , aux goûts, aux u fa g es,
à la langue du pays qu’il venoii habiter, il pii fia
une année entière , renfermé dans un cercle Borné
d’amateurs & de gens de lettres, étudiant notre langue
avec Taâi.ité d’un jeune homme, y faifant des progrès
rapides, ïludieux fur-tout de la déclamation &
de la profodie, ô c partageant fes journé:s entre la
compofition de fon premier ouvrage & la leéluré
de nos poëtes, de nos orateurs & de nos philofoph.es
les plus célèbres.
A pc ine avoit-il commencé fon opéra de Roland ,;
que les parti fans de M. Gluck, & M. G'uclc lui-
même, lui décla.èrent la guerre. Ces deux artiffes
pouvoiént être rivaux fans être ennemis,-ô c le ca-
raâère de M. Piccinni rendoit l’union facile entre
eux; l’art y eut gagné fans doute, & de miférabies
divifions n’euffent pas troublé les jouiffances de
eet art conciliant & paifible. On fut injurie & ex-
clufif de part & d’autre, félon la coutume : on écrivit,
on s’injuria , on fe dét-efta cordiale ment, le tout peur
des notes;, en erhbrouil a la queftion, & Ton n’en
cria'que plus fort quand on fui parvenu à ne plus
s’entendre.
Dans,cette guerre, comme dans routes les autres,
le tort e.ft du côté d s agreffeurs. Ceux qui fe trouvoient
inopinément ôc injulLment attaqués n’eurent
pas le choix, & fe virent forcés de fe défendre.
O r , que cette agreffïon vint de M. Gluck lui- même,
voici ce qui le prouve évidemment. '
D abord il fit courir le b oit qu’il aveit commencé
a compofer Roland,• b entôt -on publia même que
cet opéra étoit fini, ce qui donna lieu à ce bon mot
que le journal de Paris s’empreffa de recueillir.-« Bavez
vous, difoit quelqu’un à l’amphithéâtre, que
Gluck arrive avec la mufique d’ A rmide & de Roland
? — De Roland ! dit fon voifin •: mais M. Piccinni
travaille aéluellement à le mettre en mufique.
— Eh bien! répliqua Tamre,. tant-mieux : nous
aurons un Orlandç Ôc un Orlàndino. i>
Peu de temps après, parut- dans l’Année littéraire,
une lettre de M. G u :k , qui contient la vérit.-ble
déclaration de guerre. « Vous m’exhortez, écrivo t-il
au bailli du Roulet, à continuer de travailler fur ies
paroles de Topera de Roland; -cela n’eft plus fi.ifabie,
parce que quand j’ai appris que 1 adminiftration de
l opera, qui n’ignoroit pas que je faifo's Roland,
avoit donné ce même ouvrsge à M. Piccinni j’ai
b:ûîé tout ce que j’en avois d.ja fait, qui peut-être
ne valoit pas grand’chofe; ôc en ce cas le public
-doit avoir ob igation à M. Marmontel d’avoir empêché
qu’on ne lui fit entendre une m uvaife rr.u-
fiquè ; d ai leurs je ne fuis plus un homme fait pour
entrer en concurrence. M. Piccinni auroit trop d’a-
vantage-fur moi ; car outre fcn mérite perfonne1, qui
eft affurémeut très-grand, il auroit celui de b nou-
K k k k