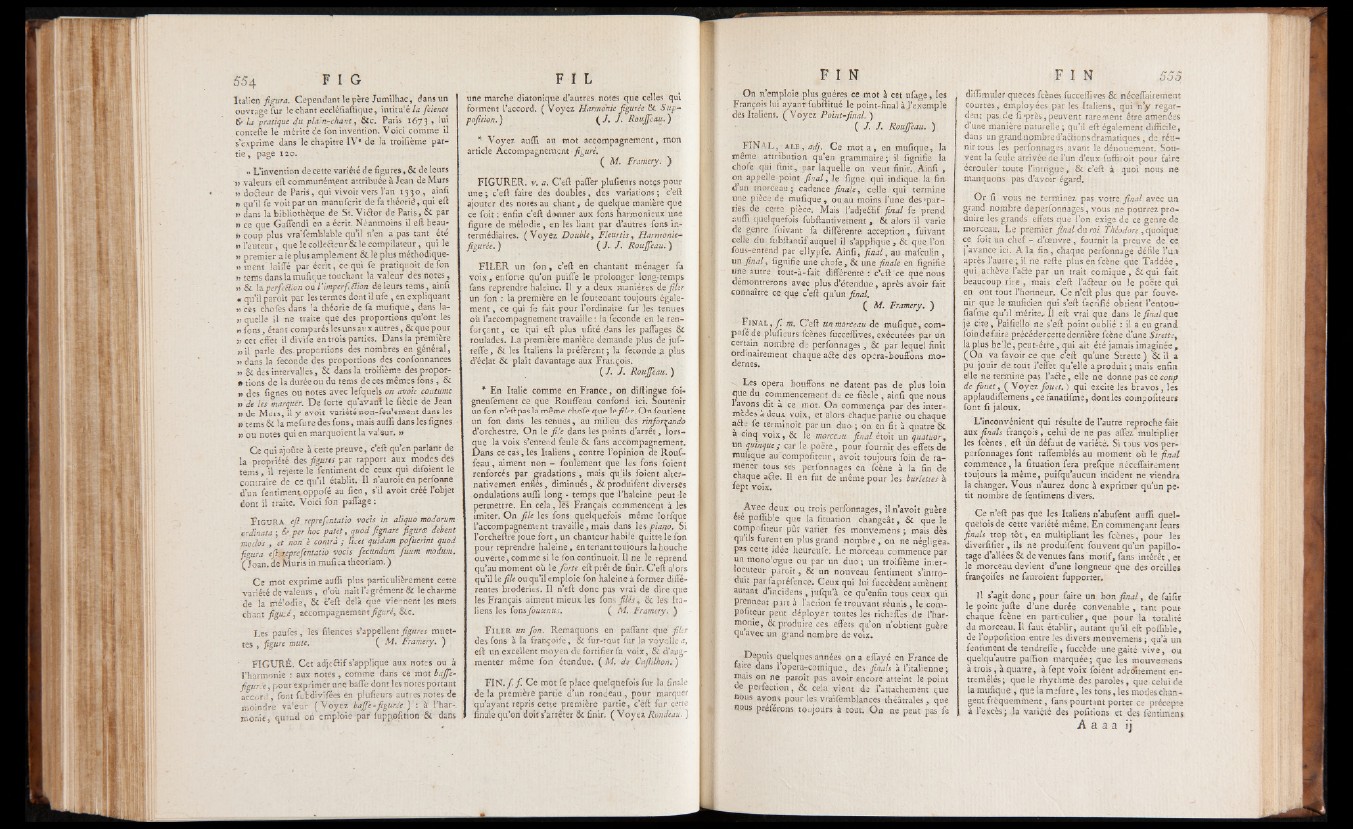
5 5 4 F I G
Italien figura. Cependant le père Jumilhac, dans un
ouvrage fur léchant eccléfiaftique, intitu'é la fcience
& la pratique du. plain-chant, & c . Paris 1673 , lui
contefte lé mérite de fon invention. V o ici comme il
s’exprime dans le chapitre IV * de la troifième par-
t i e , page 120.
«« L ’invention de cette variété de figures, & de leurs
•„ valeurs eft communén\ent attribuée à Jean de Murs
» do&eur de Paris, qui vivoit vers l’an 1330 , ainfi
» qu’il fe voit par un manufcrit de fa théorie, qui eft
v dans la bibliothèque de St. V i& o r de Paris, & par
n ce que Gaffendi en a écrit. Néanmoins il eft bèau-
J, Coup plus vra:femblable qu’il n’en a pas tant été
» l’auteur, que le colleéteur & le compilateur, qui le
» premier a le plus amplement & le plus méthodique-
» ment laiffé par é c r it , ce qui fe pratiquoit de fon
» tems dans la mufique touchant la valeur des notes,
„ & W perfection ou Timperftfion de leurs tems, ainfi
« qu’il paroît par les termes dont il u fe , en expliquant
„ ces chofes dans la théorie de fa mufique, dans la-
„ quelle il ne traite que des proportions qu’ont les
„ fons, étant comparés les uns aux autres, & q u e pour
„ cet effet il divife en trois parties. Dans la première
„ ü parle des proportions des nombres en général,
» dans la fécondé des proportions des confonnances
„ & des intervalles, & dans la troifième despropor-
n tions de la durée ou du tems de ces mêmes fon s, &
„ des fignes ou notes avec lefqueis on avoir coutume
n de les marquer. D e forte qu’avant le fiècle de Jean
„ de Murs, il y avoit variété non-feu’ ement dans les
» tems & la mefure des fon s, mais auffi dans les fignes
„ ou notes qui en marquoientla valeur, n
C e qui ajoute à cette preuve, c’eft qu’en parlant de
la propriété des figures par rapport aux modes des
tems , il rejette le fentiment de ceux qui difoient le
contraire de ce qu’ il établit. Il n’auroit eu perfonne
d’un fentiment oppofé au fien, s’il avoit créé l’objet
dont il traite. V o ic i fon paffage :
F igura, efi reprefentatio vocis in aliquo modorum
et dînât a ; & per hoc patet, quod fignare figura debent
modo s 3 et none contra ; licet quidam pofuerint quod
figura efi^zeprefcntatio vocis fecundum fuum modum.
( Joan. de M ûris in mufica theoriam.)
C e mot exprime auffi plus particulièrement cette
variété de valeurs , d’où nait l’zgrément & le charme
de la mé’odie, & c’eft delà que viennent les mots
chant figuré, accompagnement figuré, & c .
Les paufes, les filences s’ appellent figures muettes
, figure mute. { M. Framery. )
F IG U R É . C e t adje&if s’applique aux notes ou à
l’harmonie : aux notes , comme dans ce mot bajfe-
fi-gurie, pour exprimer une baffe dont les notes portant
accord , font fufcdivifées en plufieurs autres notes de
moindre v a ’eur (V o y e z baffe-figurée.) : à l’harmonie,
quand oh emploie par fuppofition & dans
F I L
une marche diatonique d’autres notes que celles qui
forment l’accord. ( V o y e z Harmonie figurée & Sup~
pofition.) (J» / . Roujfeau. )
* V o y e z auffi au mot accompagnement, mon
article Accompagnement figuré.
( M. Framery. )
F IG U R E R , v. a. C ’eft paffer plufieurs notçs pour
une *, c’eft faire des doubles, des variations ; c’eft
ajouter des notes au chant, de quelque manière que
ce foit : enfin c’eft donner aux fons harmonieux une
figure de mélodie, en les liant par d’autres fons intermédiaires.
( V o y e z Double, Fleurtis, Harmonie-
figurée. ) ( J. / . Roujfeau. )
F IL E R un f o n , c’eft en chantant ménager fa
voix , enforte qu’on puiffe le prolonger long-temps
fans reprendre haleine. Il y a deux manières défiler
un fon : la première en le foutenant toujours également
, ce qui fe fait pour l’ordinaire fur les tenues
où l’accompagnement travaille : la fécondé en le renforç
an t," ce qui eft plus ufité dans les paffages &
roulades. L a première manière demande plus de ju f-
te ffe , & les Italiens la préfèrent ; la fécondé # plus
d’éclat 6c plaît davantage aux François.
( / . J. Roujfeau. )
* En Italie comme en France, on diftingue foi-
gneufement ce que Rouffeau confond ici. Soutenir
un fon n’eftpas la même chofe que le filer. O n foutient
un fon dans les tenues, au milieu des rinforçando
d’orchestre. O n le file dans les points d’arrê t, lorsque
la voix s’entend feule & fans accompagnement.
Dans ce c a s , les Italiens , contre l’opinion de Rouffeau
, aiment non - foulement que les fons foient
renforcés par gradations , mais qujils foient alter-
nativemen enflés, diminués, ôcproduifent diverses
ondulations, auffi long - temps que l’haleine peut ;le
permettre. En cela, lés Français commencent à les
imiter. On file les fons quelquefois même lorfque
l’accompagnement travaille, mais dans les piano. Si
l’orcheftre joue fo r t , un chanteur habile quitte le fon
pour reprendre haleine, en tenant toujours la bouche
ouverte, comme si le fon continuôit. Il ne le reprend
qu’au moment où le forte eft prêt de finir. C ’eft alors
qu’il le file ou qu’il emploie fon haleine à former différentes
broderies. Il n’eft donc pas vrai de dire que
les Français aiment mieux les fons filés, & les Italiens
les fonsfouienus. ( M. Framery. )
F il e r un fon. Remaquons en paffant que filer
des fons à la frahçoife, & fur-tout fur la voyelle a,
eft un excellent moyen de fortifier fa vo ix , & d’augmenter
même fon étendue. ( M. de Cafiilhon. )
F IN . f i fi C e mot fe place quelquefois fur la finale
de la première partie d’un rondeau, pour marquer
I qu’ayant repris cette première partie, c’èft fur cette
finale qu’on doit s’arrêter ôc finir. ( V o y e z R o n d ea u , )
F I N F I N . 5 5 5
On n’emploie plus guères ce mot à cet ufage , les
François lui ay ant fubftitué le point-final à ,1’exemple
des Italiens. ( V o y ez Point-final. )
( J. J. Roujfeau. )
FINAL, a l e , adj. C e mot a , en mufique, la
meme attribution qu’en grammaire; il fignifie la
chofe qui finit, par laquelle on veu t finir. Ainfi ,
on appelle point final, le ligne qui indique- la fin
d un morceau ; cadence finale, celle qui termine
une piece de mufique, ou au moins l’une des »parties
de cette pièce. Mais l’adje&if final fe prend
suffi quelquefois fubftantivement , & alors il varie
de genre fuivant fa différente acception, fuivant
celle du fubftantif auquel il s’applique , & que l’on
fous-entend par ellypfe. A in fi, final, au mafeulin ,
un final, fignifie une chofe, & une finale en fignifie
une autre tout-à-fait différente : c’ eft ce que nous
démontrerons avec plus d’étendue, après avoir fait
connaître ce que c’eft qu’un final.
( M. Framery. )
F in a l , f. m. C ’eft un morceau de mufique, com-
pofe.de plufieurs fcènes fucceflives, exécutées par un
certain nombre de perfonnages , & par lequel finît
ordinairement chaque aéle des opera-bouffons modernes.
\ Les opéra bouffons ne datent pas de plus loin
que du commencement de ce f iè c le , ainfi que nous
lavons dit a ce mot. On commença par des intermèdes
a deux v o ix , et alors chaque partie ou chaque
a£te fe terminoit par un duo ; on en fit à quatre ÔL
a cinq v o ix , & le morceau final étoit un quatuor,
un quinque ; car le p o ëte, pour fournir des effets de
mufique au compofiteur, avoit toujours foin de ramener
tous ses perfonnages en fcène à la fin de
chaque aéle. Il en fut de même pour les burlettes à
fept voix.
A v e c deux ou trois perfonnages, iln ’avoit guère
été poflibîe que la fituation changeât, & que le
compofiteur pût varier fes mouvemens ; mais dès
quils furent en plus grand n ombre, on ne négligea«
pas cette idée heùreufe. Le morceau commence par
un mono'ogue ou par un duo ; un troifième interlocuteur
p a ro ît, & un nouveau fentiment s’introduit
par fapréience. Ceux qui lui fuccèdent amènent
autant d’incidens, jufqua ce qu’enfin tous ceux qui
prennent part à l'action fe trouvant réunis , le compofiteur
peut déployer toutes les richsffes de l’harmonie,
& produire ces effets qu’on n’obtient guère
qu avec un grand nombre de voix.
Depuis quelques années on a effayé en France de
i§ire dans l’ôpera-comique, des finals à l’italienne;
mais on ne paroît pas avoir encore atteint le point
de perfection, & cela vient de /l’attachement que
nous avons pour les vraifemblanees théâtrales , que
hous préférons toujours à tout. O n ne peut pas fe
diffimuler queces fcènes fucceflives & néceflairement
courtes, employées par les Italiens, qui h*y regardent
pas de fi*près, peuvent rarement être amenées
d’une manière naturelle; qu’il eft également difficile,
dans un grand nombre d’aéiions dramatiques , de réunir
tous les perfonnages. avant le dénouement. Souvent
la feule arrivée de l’un d’eux fuffiroit pour faire
écrouler toute l’intrigue, & c’eft à quoi nous ne
manquons pas d’avoir égard.
O r fi vous ne terminez pas votre, final avec un
grand nombre de perfonnages, vous ne pourrez produire
les grands effets que l’on exige de ce genre de
morceau. L e premier final du roi Théodore, quoique
ce foit un ch ef - d’oeuvre , fournit la preuve de ce
j’avance ici. A la f in , chaque perfonnage défile l’un
après l’autre ; il ne refte plus en fcène que Taddée ,
qui achève l’aéle par un trait comique, êcqui fait
beaucoup rire , mais c’eft l’a&eur ou le poëte qui
en ont tout l’honneur, Ge n’eft plus que par fou venir
que le muficien qui s’eft facrifié obtient l’entou-
fiafme qu’il mérite.- Il eft vrai que dans le final que
je c ite , Paifiello ne s’eft point oublié : il a eu grand
foin de faire précéderçette dernière fcène d’une S trett:y
la plus be’.le, peut-être, qui ait été jamais imaginée,
( O n va favoir ce que c’eft qu’une Strette ) & il a
pu jouir de tout l’effet qu’elle a produit ; mais enfin
elle ne termine pas l’aéte, elle ne donne p a scecoup
de fouet t ( V o y e z fouet.) qui excite les bra vo s, les
applaudiffemens , ce fanatifme, dont les compofiteur«
font fi jaloux.
L ’inconvénient qui résulte de l’autre reproche fait
aux finals françois, celui de ne pas affez multiplier
les fcènes , eft un défaut de variété. Si tous vos per-
perfpnriages font raffemblés au moment où le final
commence, la fituation fera prefque néceflairement
toujours la même, puifqu’aucun incident ne viendra
la changer. Vous n’aurez donc à exprimer qu'un petit
nombre de fçntimens divers.
C e n’eft pas que les Italiens n’abufent auffi quelquefois
de cette variété même. En commençant leurs
finals trop t ô t , en multipliant les fcène s, pour les
diverfifier , ils ne produifent fouvent qu’un papillotage
d’allées 8t de venues fans motif, fans intérêt, et
le morceau devient d’une longneur que des oreilles
françoifes ne fauroient fupporter.
Il s’agit donc , pour faire un bon final, de faifir
le point jufte d’une durée convenable , tant pout
chaque fcène en particulier, que pour la totalité
du morceau. Il faut établir, autant qu'il eft poflibîe,
de l’oppofition entre les divers mouvemens ; qu’à un
fentiment de tendreffe, fuccède une gaîté v i v e , ou
quelqu’autre paffion marquée; que les mouvemens
a trois, a quatre, a fept v o ix foient adroitement entremêlés;
que le rhythme des paroles, que celui de
la mufique , que la m efure, les tons, les modes changent
fréquemment, fans pourtant porter ce précepte
à l’excès ; la variété des pofitions et des fentimens
A a a a ij