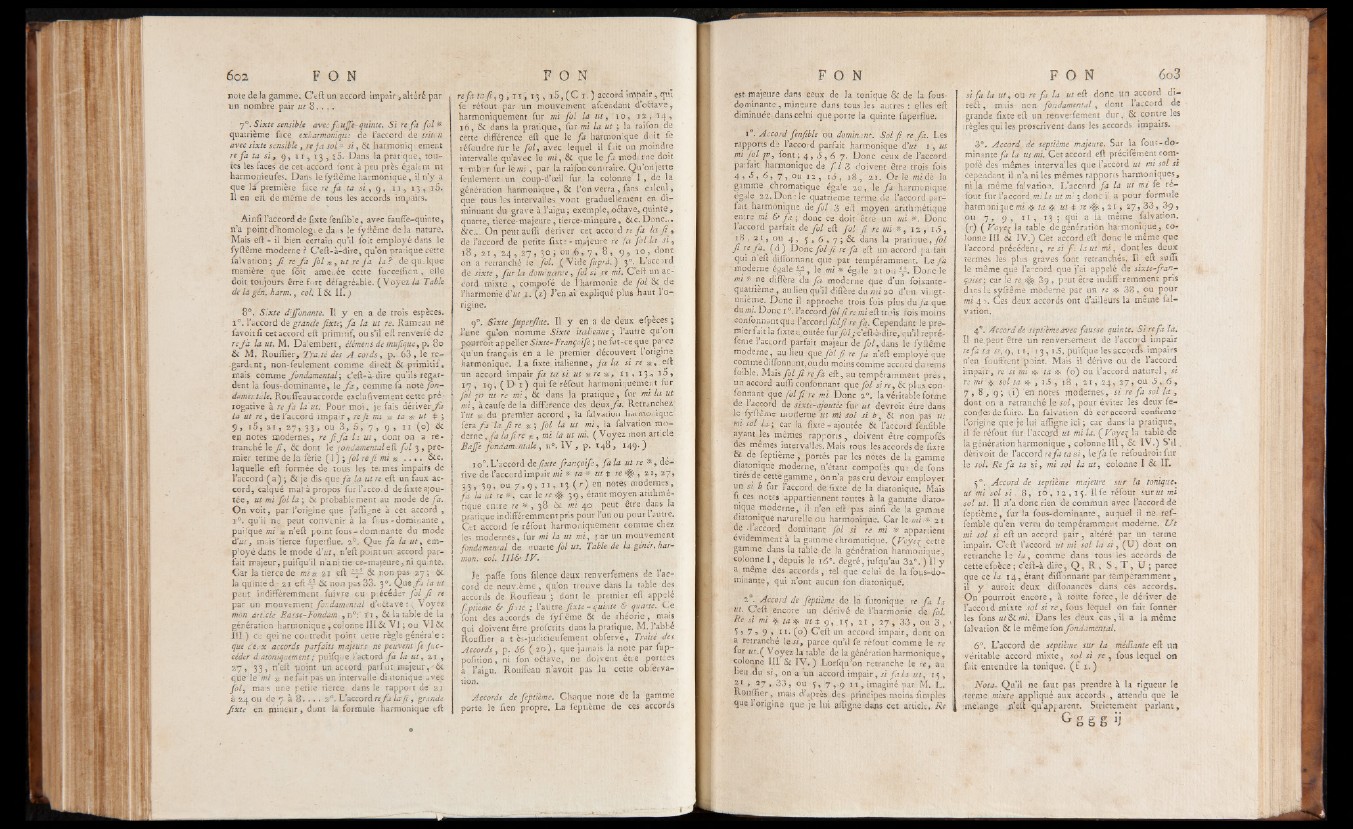
note de la gamme. C ’eft un accord impair, altéré par
un nombre, pair ut 8 .. . .
70.Sixte sensible avec foufie-quinte. Si re fa fol ^
quatrième face exharmonlque de l’accord de triten
avec sixte sensible , r e ft sol*■ s i , & jiarmohiq ement
re fa ta s i, g , n , 13 , j 5. Dans la prarque, toutes
les faces 'de cet accord font à peu près égale m nt
harmonieufes. Dans le fyflême harmonique, il n’y a
que la première face re fa ta s i , 9 , 1 1 , 13 , 15.
Il en eii de même de tous les accords impairs.
Ain fi l’accord de fixte fenfible, avec fauffe-quinte,
n’a point d’homologre dans le fyflême delà nature.
Mais efl - il bien certain qu’il foit employé dans le
fyflême moderne ? C’eft-à-dire, qu’on pratique cette
falvation; f i re fa fo l » , ut re fa la ? . de qu.lque
manière que foit amenée cette fuccefticn, elle
doit toujours être fort défagréable. ( Voyez la Table
de la gén. harm., col. I & II. )
8°. Sixte d'jfonante. Il y en a de trois espèces..
1°. l’accord de grande fixte; f a la ut re. Rameau ne
favoitfi cet accord eft primitif, ou s’il eft renverfé de
re fa la ut, M. Da ! ember t , élémer.s de mufique, p. 80
& M. Rouflier, Traité des A.cords, p. 63, le re-
- gardant, non-feulement comme dbeét & primitif,
mais comme fondamental; c’eft-à-dire qu’ils regardent
la fous-dominante, \z fa > comme fa note fondamentale.
Rouffe au accorde exclufivement cette prérogative
^re fa la ut. Pour moi, je fais dériver yiz
la ut re, de l’accord impair, re f i mi » ta » ut $ ;
9 , i 5 , 2 1 , 27, 3 3, ou 3, 5 , 7 , 9 , i l (o) &
en notes modernes, re f i fa d a ut, dont on a retranché
le f i , & dont lé fondamental efl fo l 3 , premier
terme de la férié ( 1 ) ; fo l re f i mi » . . . . &c.
laquelle eft formée de tous les te, mes impairs de
l’accord (a ) ; & je dis quq fa la ut re efl un faux accord,
calqué mal'à propos furl’acco.d de fixte ajoutée,
ut mi fol la ; 6l probablement au mode de fa.
On voit, par l’origine que j’afligne à cet accord ,
i ° . qu’il ne peut convenir à la fous - dominante ,
puifque mi » n’eft point fous-dominante du mode
d'ut, ma is'tierce fuperflue. 20. Que fa la ut, employé
dans le mode d'ut, n’eft point un accord parfait
majeur, puifqu’il n’a ni tierce-majeure,, ni quinte.
Car la tierce de mi-» 21 eft & .non pas 27,; &.
la quinte d - 21 eft non pas 33. 30. Q u e la ut
peut indifféremment fuivre eu précéder fol f i re
par un mouyement fondamental d’oêtave : ( Voyez
mon article Basse-Fondam , n°:~ ï i , ôt la table de la
génération harmonique , colonne III & V l ; ou V lô t
I l l ) ce qui ne contredit point cette règle généra’e :
que deux accords parfaits majeurs ne peuvent fe juc-
eédtr diatoniquement ; puifque l’actord fa la ut, 21 ,
2 7 , 33, n’eft point un accord parfait majeur,•'&
que-le m l » défait pas un intervalle diatonique avec
fo l, mais une petite tierce dans le rapport de 2.1
à 24 ou de 7 à 8. . . . 2°. L’accord refaire f i , grande
fixte en mineur, dont la formule harmonique eft
refit ta f i , g , 1 1 , 1 3 , , (C i. ) accord impair, qui
fe réfout par un mouvement afcer.dant d octave,
harmoniquement fur mi fol la ut, 10, 12 , 1 4 ,
16 , & dans la pratique, fur mi la ut ; la raifon de
cette différence eft que le fa harmonique doit fe
téfoudre fur le fo l, avec lequel il f ût un poindre
intervalle qu’avec le mi, & que le fa mod.\rne doit
t omber fur le mi, par la raifon cont raire. Qu’on jette
feulement un coup-d’oeil fur. la colonne I , de la
génération harmonique , & l’on verra , fans calcul,
que tous les intervalles vont graduellement en diminuant
du grave à l’aigu; exemple,oélave,quinte,
quarte, tierce-majeure, tierce-minçure, &c.Donc...
&c... On peut aufli dériver cet accord re fa la f i y
de l’accord de petite fixt; - majeure re fa fo lia s i,
18 | 2 1 , 24 , 2 7 ,30 ; ou <6-, 7 , 8 , 9 , 10^, dont
on a retranché le fol. fWide fuprà. ) 30. L’accord
de sixte , fur la dominante, fol si re mi. C ’eft un accord
mixte , compofé de l'harmonie de fol & de
l’harmonie d'ut 1. (z) J’en ai expliqué plus haut 10-
' rigine.
90. Sixte foperflue. Il y en a de deux efpèces ;
l’une qu’on nomme Sixte italienne ; l’autre qu’on
pourroit appeller Sixte-Françoife ; ne fut-ce que parce
qu’un françois en a le premier découvert l’origine
harmonique. I a fixte italienne, fa la si re » , : eft
un accord impair/« ta si ut »re » , 11 , 13., i 5 ,
17 , 19, (D i ) qui fe réfout harmoniquement fur
fol iv ut re mi, & dans la pratique, fur mi la ut
mi, àcaufede la différence des deuxj^t. Retranchez
Y ut » du premier accord , la falvation harmonique
fera fa la f i re »', fol la ut mi, la falvation moderne
,fa la fire » , mi la ut mi. (Voyez mon article
Baffe fondamentale, n°. IV , p. ï 48 3 I 49‘ )
io°. L’accord de fixte françoife, fa la ut re de-
rive de l’accord impair mi * ta % ut-tç. re ^ , 21, 27,
33 j '3 9 ’ ou 7* 9 ’ 11 ’ 13 •( r ) notes modernes,
fa la ut re car le re 39, étant moyen arithmétique
entre re * , 38 & mi 4® • P^ut etre dans la
pratique indifféremment pris pour l’un ou pour l’autre.
Cet accord fe réfout harmoniquement comme chez
les.modernes, fur mi la ut ml, par un mouvement
fondamental de quarte fol ut. Table de la gêner. h a r -
mon. col. HI& IV .
Je paffe fous filence deux renverfemens de l’accord
de neuvième, qu’on trouve dans la table des
accords de Rouffeau ; dont le premier efl appelé
fpti'eme & fixte ; l’autre fixte - quinte & quarte. Ce
font des accords de fyfême & de théorie, mais
qui doivent être proferits dans la pratique. M. l’abbé
Rouflier a t ès-jurficieufement obfervé, Traité des
Accords, p. 66 ( 20), que jamais la note par fup-
pofition, ni fon oélavç, ne doivent être portées
I à l’aigu. Rouffeau n’avoit pas lu cette obferva-
tion.
Accords de feptièrne. Chaque note de la gamme
porte le fien propre. La fepnème de ces accords
est majeure dans ceux de la tonique & de la fous-
dominante , mineure dans tous.les autres : elles eft
diminuée dans celui que porte la quinte fuperflue.
i°. Accord fenfible ou domtrumt. Sol f i re fa . Les
rapports de l’accord parfait harmonique d’ut 1 , ut
mi fol jp, font ; 4 , 6 ,6 7. Donc ceux de l’accord
parfait harmonique de fi A 3 doivent être trois fois
4 î *5 » 6 , 7 , ou 12 , 1,5 , 18 , 2 i. Or le mi dé la
gamme chromatique égale 2G,. le fa harmonique
égale 22. Donc le quatrième terme de l’accord parfait
harmonique de fol 3 eft moyen arithmétique
entre mi & fa ; donc ce doit être un mi *. Donc
1 accord parfait de fo l eft fo l f i re mi %, 12 , i<5,
18 , 2 t., ou 4 , 5 , 6 , 7 ; & dans la pratique , fo l
f i Tf f f (8 ) Donc fo l f i re fa eft un accord ..pa fait
qui n eft diffonnant que par tempéramment. Le fa
' moderne égalé , le mi * égale 21 ou Donc le
mi & ne diffère du fa moderne que d’un foixante-
quatrieme, au lieu qu’il diffère du mi 20 d’un vingt-
unième. Donc il approche trois fois plus du fa que
du mi. Donc 1 °. l’accord fol f i re mi eft trois fois moins
confonnantque l’accord fo l f i re fa. Cependant le premier
fait la fixte ajoutée fur fol yc’eft-à-dire, qu’il repré-
ferue 1 accord parfait majeur de fo l, dans le fyflême
moderne, au lieu que fol f i re fa n’eft employé que
comme diffonnant,ou du moins comme accord du tems
foible. Mais fo l f i refa eft , au tempéramment près,
un accord auffi confonnant que fol sire, & plus confondant
que fol f i re mi. Donc 2°. la véritable forme
de 1 accord de sixte-ajoutée fur ut devroit être dans
le fyfteme moderne ut mi sol si b , & non pas ut
mi sol la-; car la fixte - ajoutée & l’accord fenfible
ayant les mêmes rapports , doivent être compofés
des memes intervalles. Mais tous les accords de fixte
& de feptieme , portés par les notés de la gamme
diatonique moderne, n’étant compofés q.u; de fons
tires de cette gamme, on n’a pas cru devoir employer
si b fur l’accord de fixte de la diatonique. Mais
fi ces notes appartiennent toutes à la gamme diatonique
moderne, il n’en eft pas ainfi de la gamme
diatonique naturelle ou harmonique. Car le;//zi # 21
de .1 accord dominant fo l si re mi x appartient
évidemment à la gamme chromatique. (Voyef cette
gamme dans la table de la génération harmonique,
colonne 1, depuis le 16e. degré, jufqu’au 32e. ) Il y
a même des accords, tel que celui de la fous-dominante
, qui h’ont aucun fon diatoniqué.
20. Accord de feptieme de la futonique re fa la
ut. C’eft encore un dérivé de l’harmonie de fol.
Re si mi # ta # ut t 9 , 15, 21 , 2 7 , 33 , ou 3 ,
5 > 7 » 9 » 1 ( ° ) C ’eft un accord impair, dont on
a retranché le ri, parce qu’il fe réfout comme le re
fur Voyez la table de la génération harmonique,
ï.olo^ è & IV . ) Lorfqu’on retranche le re, au
lieu au s i, on a un accord impair, si fa la ut , 15 ,
21 , 2 7 , 33, ou 5 , 7 , 9 1 1 , imaginé par M. L.
Rouflier, mais d’après des principes moins fi m pies
que l’origine que je lui affigaé dans cet article, Re
si fa la ut, ou re fa la ut eft donc un accord di-
reél, miis non fondamental, dont 1 accord de
grande fixte eft un renverfement dur, & contre les
règles qui les proscrivent dans les accords, impairs.
3°. Accord de septième majeure. Sur la fou;-dominante
fa la ut mi. Cet accord eft préciférnent compofé
des mêmes interva’les que l’accord ut mi sol si
cependant il n’a ni les mêmes rapports harmoniques,
ni Ja même falvation. L’accord fa la ut mi fe refout
fur l’accord .mi la ut ml ; donc il a pour formule
harmonique mi & ta & ut t re ^ , 2 1 , 27, 33, 3 9 ,
ou 7 , 9 , i i , 13 • qui a la même falvation.
( r) ( V’oye^ la table de génération harmonique, colonne
IIÎ & IV.) Cet accord eft donc le même que
l’accord précédent, re si f 1 la ut mi, dont les deux
termes les plus graves font retranchés. Il eft auflï
le même que l’accord que j’ai appelé de sixte-française;
car le re. ^s 3.9 , p?ut être indifféremment pris
dans le syftême moderne par un re & 3 8 , ou pour
mi 4 3. Ces deux accords ont d’ailleurs la même falvation.
4®. Accord de septième avec fausse quinte. Sire fa la.
Il ne.peut être un renversement de l’accord impair
refa ta si, 9, 11, 13,16, puifque les accords impairs
n’en fouffrent point. Mais il dérive ou de l’accord
impair , re si mi ta # (o) ou l’accord naturel. si
re mi # sol ta # , 16 , 18 , 2 1 , 24 , 27, ou 6 ,. 6 ,
7 , 8 , 9 ; (i) en notes modernes, ri re fa sol la ,
dont on a retranché le sol, pour éviter les deux fécondés
de fuite. La falvation dè cet accord confirme-
l’originè que je lui afligne ici; car dans la pratique,
il fe réfout fur l’accord ut mi la. ( Voye{ la table de
la génération harmonique , colonne I I I , & IV.) S’i l .
dérivoit de l’accord refa ta s i , \efa fe réfoudroit fur
le. sol. Re fa ta si , mi sol la ut, colonne I & IL
50. Accord de septième majeure sur la tonique.
ut mi sol s i . 8, 1 0 , 1 2 , 1 5 . 11 fe réfoüt sur ut mi
sol ut. Il n’a donc rien de commun avec l’accord de
feptièmë, fur la fous-dominante, auquel il ne ref-
femble qu’en vertu du tempéramment moderne. Ut
mi sol si eft un accord pair, altéré par un terme
impair. C ’eft l’accord lit mi sol la s i , (U) dont on
retranche le la, comme dans tous les accords de
cette efpèce ; c’eft-à dire, Q , R , S , T , U ; parce
que ce La 14 , étant diffonnant par tempéramment,
il y auroit deux diffonanccs dans ces accords.
On pourroit encore, à toute fotee, le dériver de
l’accoid mixte sol si re., fous lequel on fait fonner
les fons ut 3c mi. Dans les deux cas , il a la même
fal vation & le même fon fondamental.
6°. L’accord de septième sur la médiante eft un
véritable accord mixte., sol si re , fous lequel on
fait entendre la tonique, ( f 1 .)
Nota. Qu’il ne faut pas prendre à la rigueur le
;terme mixte appliqué aux accords , attendu que le
•mélange n’eft qu’apparent. Strictement parlant,
G g g g